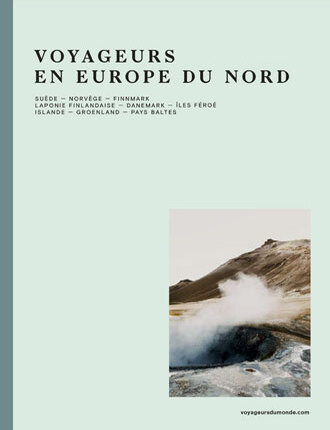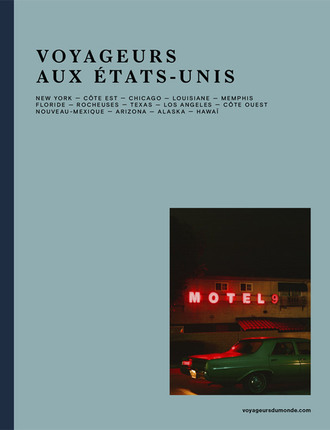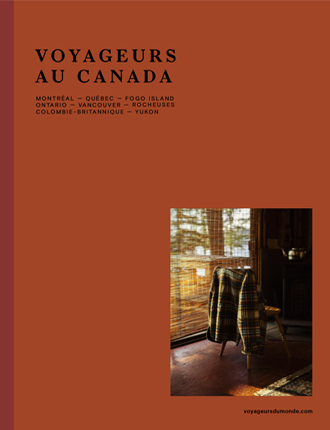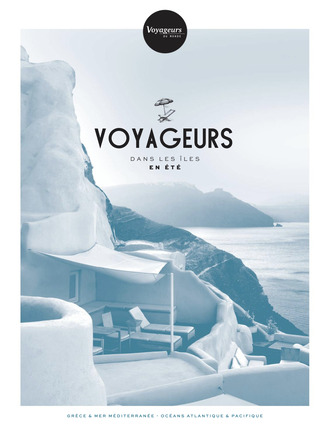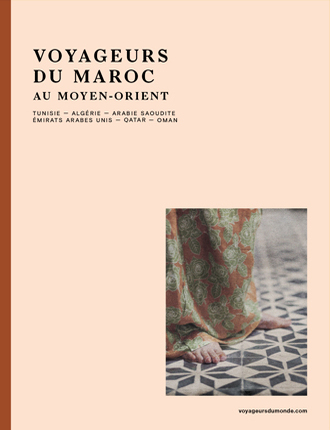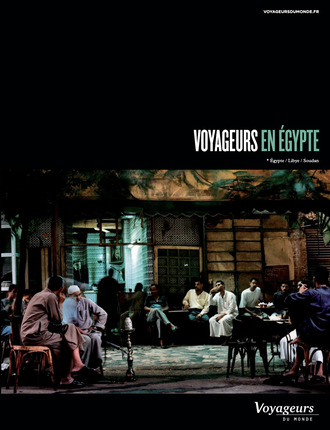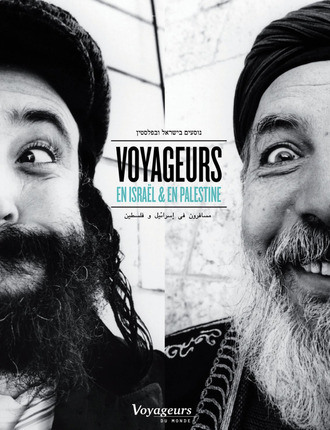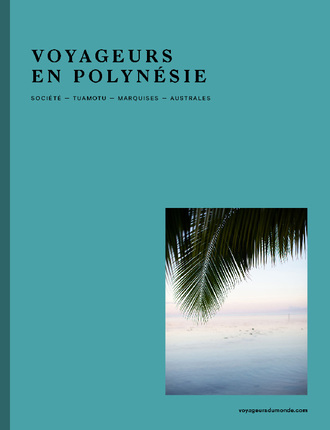Monument de la littérature mondiale, chef d’œuvre intemporel, On the Road, de Jack Kerouac, est un hymne à la liberté absolue, une incitation à larguer les amarres. Un chant profond, un chant puissant. Celui d’une jeunesse éternelle à portée de main. Il faut écouter Kerouac. Et partir. Sur la route.
Il faudra trouver un motel. Plus tard. Pour l’instant, il n’y a que la route. Une ombre tenace perce encore dans la nuit. Les montagnes du Colorado s’éteignent à peine. Le soleil a brûlé un long moment sur les sommets. Je roule depuis des jours. Rien d’autre ne compte. Rouler encore. La plaine ressemble à une longue étoffe qui tremble sous le vent. La vitesse, les rafales, les étoiles qui étincellent, la lune renversée, la pluie parfois, et tout cet espace, toute cette immensité. Aussi le bruit du moteur, le souffle des bâches d’un Mack qui tangue à toute allure. Une vie nouvelle, une vie ailleurs, qui se donne jusqu’à l’horizon. Puis se dérobe. Pousser l’accélérateur à fond, augmenter le volume de la radio. KRBC joue Monk et Bird. Nocturnes jazz. « Mon pote, tu t’imagines de quoi ça aurait l’air, un orchestre de jazz dans ces marais, avec de grands noirs balaises gémissant des blues et buvant du tord-boyaux, et nous faisant des signes ? »…
Je trouverai un motel, à l’aube, dormirai trois ou quatre heures, puis reprendrai le volant. Je reprendrai la route. Je suis sur la piste d’un rêve de gosse. Je veux rejoindre les pages de Jack Kerouac. Me perdre dans la légende américaine. J’ignore ce que je vais trouver. J’imagine qu’il y aura des visages, des regards habités, et des paysages si vastes, une impression de liberté telle qu’elle pourrait rendre dingue… Une échappée américaine. Je suis ici depuis trois semaines, et je conduis seul, la nuit. La radio pour toute compagnie. Je laisse ce monde étrange me hanter lentement. Des musiques, des messages. Des informations inutiles, des chansons dédicacées pour un amour enfui, une épouse infidèle. Le feulement du moteur, la sirène des flics, la plainte des chiens sauvages qui se perd dans la nuit… Je pense à Neal, à Dean Moriarty, à la petite Laura, à Carlo, à Chad, à Terry, à tous les autres… Mes frères d’âme par delà les années. Je pense à Jack Kerouac. « Quelque part sur le chemin, je savais qu’il y aurait des rencontres, des visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare. ». Je roule.
Je me souviens. Une semaine plus tôt, la gare de Denver. Phil et Maria attendent le Greyhound qui les ramènera dans le Nebraska. Elle a cette façon de tenir son homme près d’elle… Ils ont dépassé la soixantaine, sont vêtus comme des hobos, elle porte ses cheveux blancs, coupés courts, sous une casquette de denim élimé. Lui, il évoque une manière de héron sous son grand manteau à chevrons. Il joue de l’harmonica dans le hall, les yeux clos. Ces deux-là sont ensemble depuis plus de quarante ans. Tout à coup, alors qu’un haut-parleur appelle les voyageurs à se présenter Porte 9, Maria jette un œil aux cols blancs qui se rendent à leurs bureaux : « Et qu’est-ce qu’ils y connaissent à l’amour, à la liberté, tous ces gens pressés ? » Phil s’arrête de jouer un instant. Il sourit lentement. Il me fait pense au vieux Dean Moriarty, « le père que nous n’avons jamais trouvé, je pense à Dean Moriarty »…
Je croise parfois ces bus argentés qui brillent au couchant, s’arrêtent dans les stations services pour de courtes pauses. Voyager en Greyhound aujourd’hui, c’est se placer au plus près de l’Amérique de Kerouac. C’est l’Amérique de Mark et Brian. Ils viennent d’avoir 17 ans, et se croient eux aussi « sur la route ». Et même s’ils ne sont pas à l’arrière d’un pick-up, les cheveux au vent, et même s’ils ne conduisent pas une voiture volée comme dans le roman, « rien à apprendre des truands. Il braqua la bagnole au cœur de la route », leur voyage ressemble encore assez à l’aventure. Ils viennent de Glendale, Arizona, vont à New York comme on part pour la terre promise : « Parce que c’est là que ça se passe, man… ». Dans leur grande salopette Oskosh, avec leurs baskets usées, ils prennent le temps de quelques détours, le temps de se perdre sans un cent en poche : « On a dormi dans la rue plusieurs fois ! », se marre Brian. Et tant pis s’ils ont changé le piano de Monk, qui accompagnait leurs aînés, pour le rap du Wu Tang Clang. Ils restent les lointains héritiers de Kerouac et Cassidy, ils sont l’écho des voix beat. Le sillage doré des fifties, d’une Amérique qui n’existe plus mais dont nous rêvons encore, dont nous cherchons toujours la trace dans une station-service, au bord des freeways, ce fracas en mouvement. Un rêve de liberté, un rêve américain. Un rêve qui passe, et qui demeure cependant. « Il avait une Chevrolet 38. On s’entassa dedans et on mis les voiles pour une destination inconnue »…
Je me place dans le sillage du bus de 20 heures, celui pour Chicago, sur la 67 North. J’imagine les passager sur les banquettes enfoncées. L’Amérique des Greyhound s’assoupit. Celle de « Tous ces gens qui rêvent dans son immensité –et dans l’Iowa, je le sais, les enfants sont en train de pleurer dans ce pays où on laisse les enfants pleurer ».
C’est parce qu’ils ne voulaient plus pleurer que les enfants de la Beat Generation sont partis sur la route. Derrière eux, ils laissent un monde qu’ils détestent et méprisent. Ce monde « square », conventionnel et conformiste. Le monde des bourgeois, des salauds. De la famille. Ils veulent de l’air, de la vitesse, du vent, l’ivresse des alcools et des drogues. Ils veulent de la musique. Leur musique. Be bop. Ils veulent vivre. Dean, Marylou, Sal… « C’étaient trois enfants de la terre qui voulaient affirmer leur liberté »… Vivre, tout simplement. Mais vivre vraiment. « La route, c’est la vie », écrit encore le grand Jack.
Comme il avait raison… Talpa, Mora, Sapello… La 518 East traverse les Sangre de Cristo Range. Le soleil se lève sur le Nouveau-Mexique, et des chevaux sauvages font trembler les collines. Je roulerai encore longtemps. Je suivrai le Rio Chama, vers Abiquiu, pour gagner les San Juan Mountains. Des jours et des nuits de chemins détournés, de pistes parfois, de motels et de fast foods aléatoires. Je garde l’argent pour l’essence. Je suis fauché, pourtant je veux avancer encore. Je ne possède rien, je suis détaché de tout. Libre. Enfin. Je me rappelle Jack Kerouac. « Nous allons tête baissée au devant d’une nouvelle et folle aventure sous le ciel »...
Par
Stéphane Guibourgé
Photographies : Manny Crisostomo/ZUMA/REA