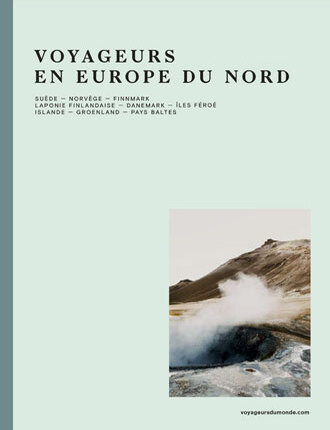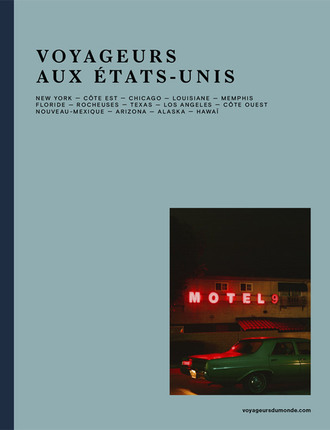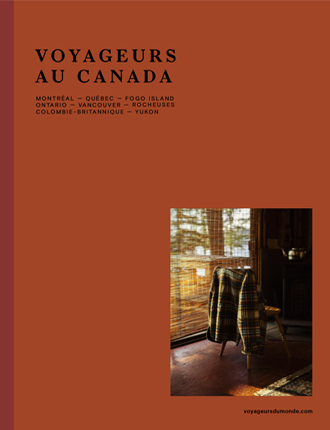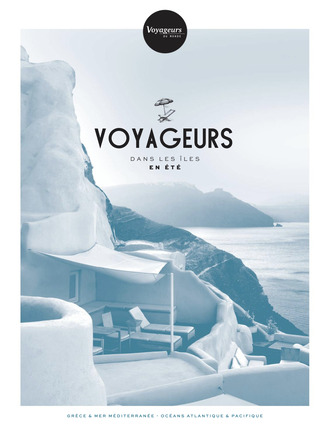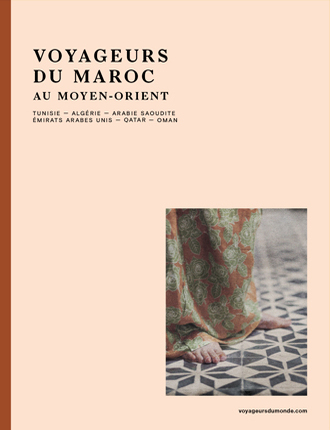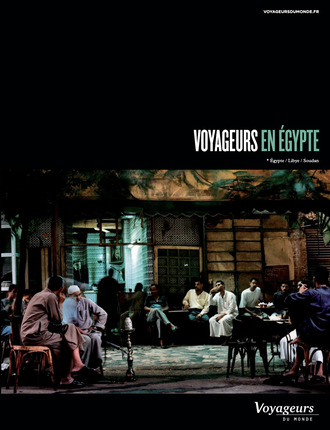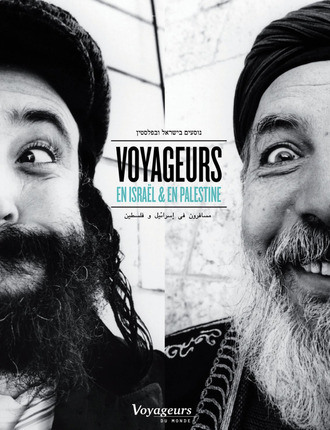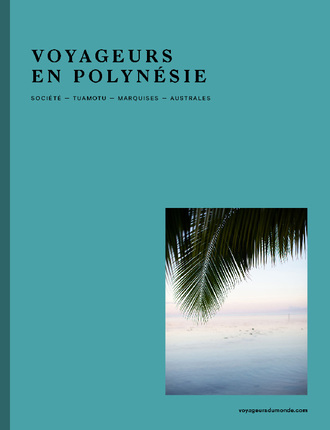Dans les campagnes et les villes, au bord de la rivière, dans les squares et les jardins publics, sur les toits-terrasses des maisons, à l’ombre des mosquées, sur les tombes des poètes, et jusque dans les lieux les plus improbables, au bord des autoroutes, juste derrière la rambarde de sécurité, ou sur les ronds-points au cœur du trafic, en Iran, on pique-nique. Le pique-nique y est un véritable phénomène social – c’est l’une des pratiques qui m’a le plus frappée lors de mon premier voyage.
A la maison, dans les familles traditionnelles, les repas se déroulent aujourd’hui encore assis au sol, sur une sofreh, grande nappe sur laquelle on dispose les plats et les mets – avec toujours plus de couverts que de convives, pour toujours pouvoir accueillir l’éventuel hôte de passage, hospitalité iranienne oblige. Quand la sofreh s’étend à l’extérieur de la maison, elle est comme une reconstruction de l’espace intérieur à l’extérieur, et l’on emporte en pique-nique brasero, samovar, narguilé – et même quelques coussins pour s’allonger après le repas. Amandes, pistaches, raisins secs, et nougats (que l’on appelle ici gaz) accompagnent le thé que l’on boit en guise d’apéritif. La glacière garde au frais concombres, tomates, citron vert, fromage frais, bouquets d’herbes, coriandre et menthe : de quoi préparer la salade shirazi. Sur le brasero mijotent le khoresh fesenjaan, ragoût de poulet, jus de grenade et noix pilée, et le riz safrané.
C’est en rentrant d’Iran que j’ai découvert que la tradition du pique-nique y était ancienne, plus qu’ancienne, ancrée depuis l’époque de Zarathoustra, que cette pratique si prégnante dans l’Iran d’aujourd’hui est la survivance d’un rite préislamique. Selon la tradition zoroastrienne, le monde a été créé en douze jours ; le 21 mars, on célèbre norouz (« le nouveau jour »). Les festivités se déroulent pendant douze jours, et le treizième jour (nommé sizdah-be-dar, littéralement « le jour à l’extérieur ») est un jour funeste, le chaos menace : il faut fuir la ville. On quitte la maison, on va déjeuner dans la nature, à proximité d’une source ou d’un arbre, et c’est en Iran un gigantesque pique-nique national – toutes les familles quittent leur domicile pour déjeuner en plein air, et, pour mettre à distance la malédiction du treize, célèbrent le présent, célèbrent le printemps.
Aujourd’hui, dans un pays où l’espace public est sous contrôle, dans un pays où la dichotomie entre privé et public est totale, où la rue est sous surveillance, lieu de tabous et d’interdits, et où l’espace privé est celui de la liberté, de l’exaltation d’une liberté joyeuse, excessive parfois, l’espace du pique-nique est comme un espace intermédiaire, un entre-deux – lieu de mixité, de rencontres, où le privé se donne à voir et partager, et où les frontières entre les hommes et les femmes s’atténuent.
Parmi les pique-niques auxquels j’ai été conviée, je garde le souvenir vivace d’une journée au bord de la rivière, dans les montagnes au nord de Téhéran. Dans ces montagnes, stations estivales, on gagne en fraîcheur : on quitte la touffeur du Téhéran pollué pour l’air frais d’altitude, on gagne en fraicheur intellectuelle et sociale, loin du regard inquisiteur des Gardiens de Révolution. On respire un air plus libre. Ce jour-là, le prétexte à l’excursion était la visite d’une roseraie. Nous étions une quinzaine de femmes, des jeunes filles venues avec leur mère et leurs tantes, des amies. Après un peu plus d’une heure de route, nous apprenions que le jardin était fermé pour la journée. Aucune des femmes qui m’accompagnaient n’en a paru contrariée – « qu’importe, allons pique-niquer ! ». Nous nous sommes installées dans un espace aménagé au bord d’une rivière, sur de grandes banquettes de bois recouvertes de kilims. A mon grand étonnement, toutes ont enlevé leur voile avant de déballer les victuailles – c’était la première fois que je voyais des femmes dévoilées dans un espace public, et il m’a fallut un moment pour cesser de craindre l’arrivée d’un bassidji qui vienne mettre un terme à la fête, et me laisser gagner par l’insouciance. De jeunes hommes étaient employés là ; après le déjeuner – somptueux, comme d’habitude – mes amies leur ont commandé des narguilés et du tabac à la pomme. Elles ont exigé une chaîne-hifi, et les jeunes hommes se sont empressés de s’exécuter, et de monter le son. Nous avons fumé et dansé l’après-midi entière. Puis nous sommes remontées en voiture, avons noué nos voiles sur nos cheveux, et sommes rentrées à Téhéran.
Je savais qu’en Iran, il y a le dedans, le dehors, le privé et le public, ce jour-là pour la première fois, j’ai entrevu un interstice.
Par
MARION OSMONT