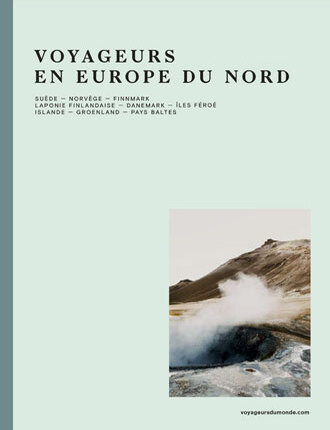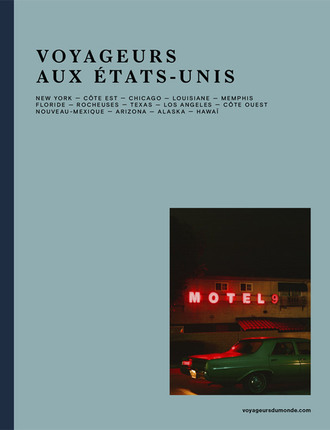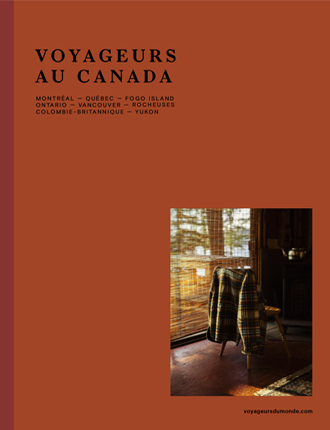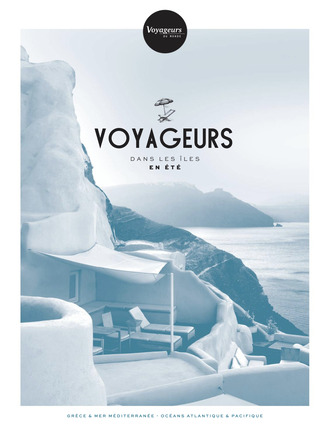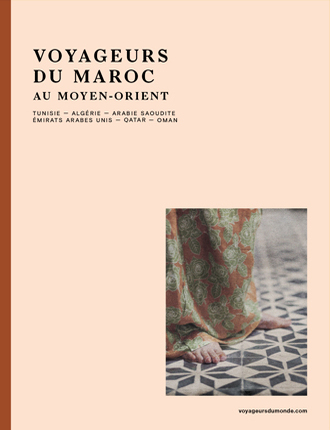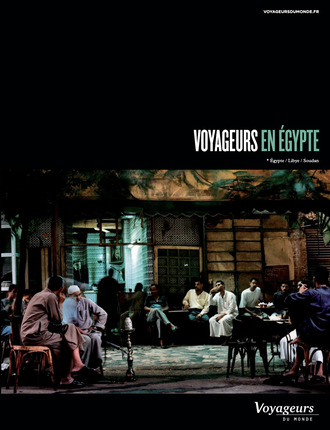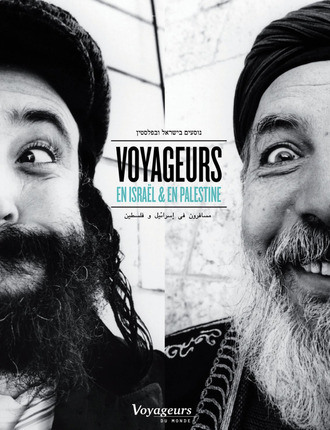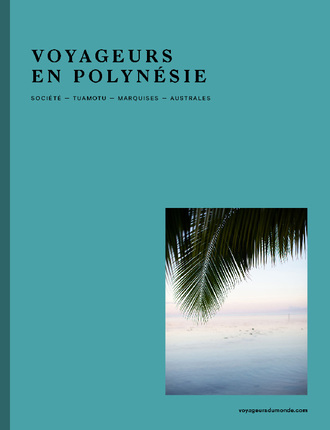Après neuf jours de transatlantique et 3 321 milles (6 150 kilomètres) depuis Le Havre, le porte-conteneur Widukind arrive en vue de Manhattan. La nuit tombe, la ville brille de tous ses feux. Magique. L’équipage et les passagers savourent la perspective d’une pause à terre. Elle sera de courte durée.
Là-bas, sur la ligne d’horizon, les lumières de New York dessinent un halo d’or pâle. A 20 heures, la côte se trouve à portée de jumelles, elle se rapproche vite. Manhattan impose le jour en pleine nuit, grandiose bouquet de néons blancs strié de rayons rouge, jaune, bleu, argent, tours sans fin qui s’en vont gratter le ciel de leur flèche surlignée d’étoiles. Une vedette approche à vive allure du porte-conteneurs. L’échelle de corde est déroulée à tribord, le pilote grimpe et déboule sur la passerelle de commandement. La procédure est obligatoire pour tout bâtiment arrivant ici, vitesse limitée à 10 nœuds, identification requise. Le jeune homme, la trentaine, coupe courte, regard clair et profil sportif, il pourrait sortir de West Point, s’empare du téléphone : « Officier Sullivan à bord de Widukind, code Charlie, Quebec, India, Kilo, Seven (CQIKS), je répète, Charlie… ». L’équipage de quart, capitaine, second et autres chefs, se tient à carreau devant ce jeunot, style gendre idéal. La preuve, plus personne n’ose fumer en sa présence, ça pourrait valoir une amende ou pire, une remarque. Trois heures de sevrage à tenir.
Creux de 10 mètres
Le pont du Verrazano lance son arche de lumière entre Staten Island à bâbord et Brooklyn, juste en face, 4 176 mètres de grâce, la porte d’entrée maritime des Etats-Unis et de New York. D’un côté, l’Atlantique, ses colères, son infini, de l’autre, l’Amérique, ses éphémères et ses folies. Au milieu, le chenal de navigation entre bouées rouges et vertes. Le pilote scrute. Let’s go !
Pour l’équipage (dix-neuf marins) comme pour les quatre passagers payants, la pause sera la bienvenue. Aux portes du continent, la tempête a de nouveau frappé. Le capitaine Orencio Cortez avait prévenu : « Nous arriverons après-demain à New York mais avant, ça va taper dur, plus fort que la précédente dépression. Une journée de très gros temps, tout le monde à l’intérieur ». Taper dur était la formule juste. Sur l’écran météo, une boule rouge colère tourbillonnait dans son écrin orange foncé au large des côte américaines. Impossible de lui échapper. Des creux de 10 mètres, un vent de 110 km/h, des rafales jusqu’à 140 km/h, une gîte à rendre périlleux le moindre mouvement pendant que valdingue tout ce qui n’est pas attaché ou enfermé, des vagues croisées hautes comme des montagnes, dont les crêtes d’écume rageuse se jettent sur Widukind, les déferlantes balayent les piles de containers. Jamais le capitaine n’avait été aussi tendu. Une cigarette allume l’autre, sa jambe droite bat la mesure de son inquiétude, « très grosse tempête », commente-t-il. On apprécie. Le navire tangue, penche, plonge, se cabre. Il tient bon et garde son cap. Et puis, une quinzaine d’heures plus tard, la violence des éléments baisse d’un ton, puis de deux, avant que sur l’écran, l’océan retrouve le bleu pâlichon qui le ferait presque passer pour un paisible lagon.
Contrôles minutieux
Verrazano passé, chenal dégagé. Depuis la passerelle, l’officier Sullivan scrute l’avant puis lance des ordres brefs. Vitesse, cap. Le capitaine Orencio Cortez opine, l’homme des machines exécute en rappelant la consigne pour montrer qu’elle a été correctement entendue, suivie d’un « Sir ! ». L’éducation et les préséances de la Navy sont passées par là. Deux-cent soixante-dix conteneurs attendent Widukind à Port Elizabeth, l’immense zone portuaire du New Jersey, contigüe à l’aéroport de Newark. Plusieurs milliers d’hectares tapissés de hautes piles de boites blanches, vertes, bleues, rouges, hérissés de grues, 40 mètres et plus, sorties d’une fiction de sur-créatures spatiales, bordés par 80 quais. Géant. L’Amérique fait toujours plus grand qu’ailleurs.
L’accostage ici, à une heure de Manhattan, n’est pas une bonne nouvelle pour les passagers qui rêvaient d’un peu de tourisme. Le déroulé des opérations portuaires, en l’occurrence de 4 heures jusqu’à midi, ne s’y prête guère. Certes, la présence d’un cargo à quai, toujours calculée au plus juste à cause de son coût très élevé, n’est pas à l’abri d’une indisponibilité ou d’une panne de grue, des horaires des dockers, de l’absence d’un officier des douanes. Sans parler du temps passé devant les fonctionnaires de l’immigration, bardés de téléphones, matraques, colts, gilet pare-balles, torches, micros et autres menottes, invariablement tâtillons à l’égard des membres d’équipage comme des passagers, tous méticuleusement contrôlés à bord, un à un.
Avant cette épreuve administrative, le porte-conteneurs poursuit sa lente avancée. Il glisse devant Manhattan, Liberty Tower, hommage, Empire State Building, respect, Chrysler Building, admiration, pierre et fenêtres à croisillons, verre avec acier, façades claires, opaques, bleutées, noires… Les jumelles passent de mains en mains, la belle flambe, éblouit, bluffe. Flashes, selfie.
Red Hook, le port de Brooklyn
L’officier Sullivan n’a que faire de ces émerveillements. Lui, c’est son cadre habituel de vigilance. Cap, vitesse, « Sir ! ». La statue de la Liberté salue les arrivants, les gratte-ciel s’éloignent doucement, Widukind ne stationnera pas à la pointe, là où sont accueillis les prestigieux transatlantiques de la Cunard, Queen Mary 2 en particulier, avec photo aérienne en guise de tapis rouge. Il s’engage sur l’un des bras qui pénètrent dans le New Jersey, cet autre front de mer dont le skyline veut rivaliser en hauteur et majesté avec celui de Manhattan. Cap, vitesse, « Sir ! ». Pointe enfin le quai 62. L’immense grue est en place, tous projecteurs allumés, les gyrophares signalent que les hommes vont saisir les cordages, d’autres prêts à assurer le défilé des conteneurs à charger. Deux remorqueurs bordés d’épaisses protections se sont collés à la coque du bateau et le poussent au millimètre vers le quai en suivant les instructions du pilote. Amarrage. Vers 23 heures, le capitaine Cortez ordonne de couper les machines. L’officier Sullivan peut prendre congé, mission, une de plus, accomplie. Il range son GPS, son téléphone et son écran de contrôle. Un sourire, le premier depuis qu’il a esquissé un bonjour très formel : « Je file vite, ma femme doit accoucher demain. C’est notre premier enfant ! ». Widukind est arrivé à New York City.
Ses passagers doivent maintenant s’armer de patience. Arrivés ne signifie pas libérés, autorisés à fouler le sol des Etats-Unis d’Amérique. Port Elizabeth est une sorte de no man’s land où tout individu non-badgé semble être considéré comme une menace pour la sécurité intérieure du pays. Débarquer exige, dans l’ordre : trouver un officiel habilité au transport des personnes, il les conduira du bateau jusqu’au poste d’immigration situé à 20 mn en voiture, revenir, attendre que les deux douaniers montés à bord s’abstiennent de toute fouille et autorisent les sorties du navire, à nouveau se faire accompagner jusqu’aux grilles du port, présenter ses papiers tamponnés, enfin trouver un taxi par ses propres moyens dans une zone où jamais personne ne lève la main. Uber a gagné. En patientant, méditer sur cette cascade de contrôles, passeport en main, histoire de vérifier des données déjà inscrites sur l’écran de l’immigration depuis l’attribution du visa obligatoire par l’ambassade américaine. Et un dernier au retour, juste pour le plaisir.

©Jean-Pierre Chanial
Sachant que Jersey Gardens, la seule zone d’activité du coin (hamburgers des grandes chaînes américaines et plusieurs boutiques), est à 10 minutes, Manhattan à une heure, les calculs sont vite faits.
Meatpacking ou Williamsburg
Les opérations portuaires sont effectuées durant la nuit. Vent, neige, Jour de l’an, fête nationale, elles ne s’interrompent jamais. Au petit matin, le cargo changera de zone. Un nouveau pilote le dirige vers Brooklyn et le modeste port commercial de Red Hook où une centaine de conteneurs complèteront le chargement. Le voyage dure à peine deux heures mais il est intense, magnifié par les voiles bleutés de l’aube. Miss Liberty, Manhattan, le pont de Brooklyn et un quai tracé juste en face du skyline où les hommes en blanc, casqués, gilet fluo sur le dos, bottes de travail, sont à poste. La vue sur New York est sublime, unique. Les dockers ont le regard ailleurs, ils commencent déjà leur ouvrage. A midi, le second du navire informe qu’il est possible de débarquer. Ouf. Retour impératif à 18 heures. Ensuite, l’échelle de coupée sera relevée. Appareillage deux heures plus tard.
Le processus de sortie du port doit être scrupuleusement suivi. Contrôle par officier habilité pour escorter jusqu’aux grilles de la zone portuaire, contrôle, guichet de sortie, contrôle, taxi. Il est évidemment possible d’arrêter là le périple. Merci pour ce voyage, séjour à New York et retour à la maison. Aucun passager payant ne l’a imaginé. Il reste quelques heures pour plonger dans le cœur de la ville. Meatpacking ou Williamsburg ? Shopping ou musée ? Balade le long de la High Line ou ascenseur direct vers l’observatoire de la Liberty Tower après pause silence autour des bassins sans fond de Ground Zero ? Chelsea Market ou Bud pression dans un sports bar ? Comme on veut, mais vite. Charlie, Quebec, India, Kilo, Seven n’a aucune patience. Pas de quartier pour les étourdis. Déjà, rendez-vous est pris : dans 43 heures exactement, un pilote, des conteneurs soigneusement rangés et des grues haut-perchées attendent Widukind à Savannah (Georgia), 669 milles nautiques, 1 239 km plein sud. Le retard n’est pas une hypothèse envisageable.
> ARTICLE SUIVANT : UN CARGO ARRIVE À SAVANNAH
Par
JEN-PIERRE CHANIAL
Photographie
STEFAN BUNGERT/LAIF-REA