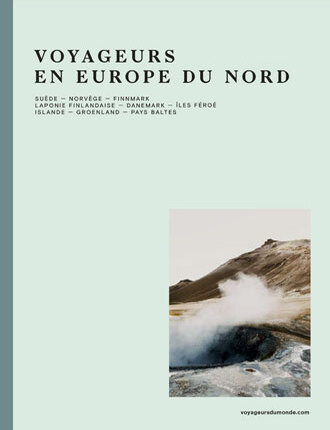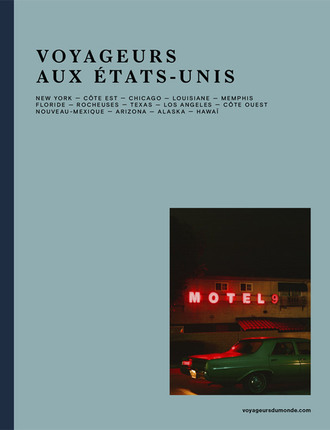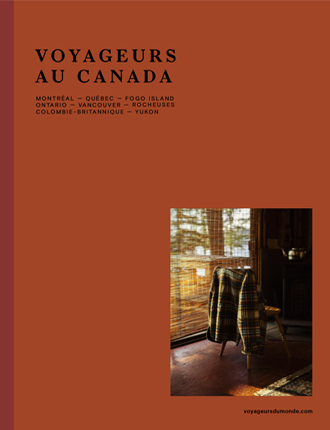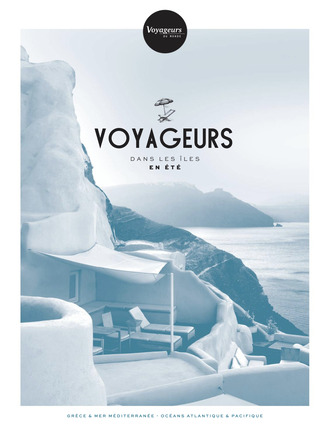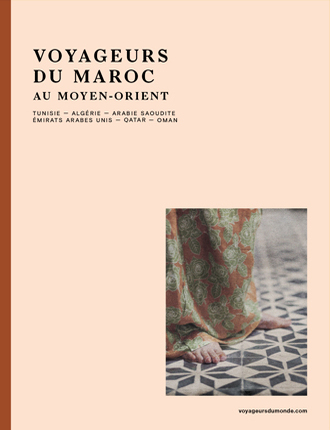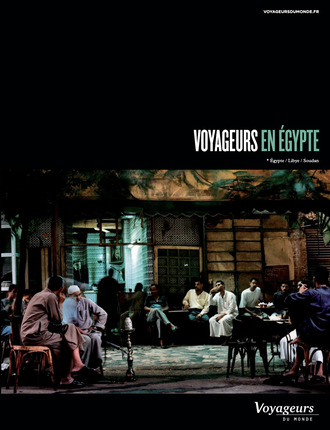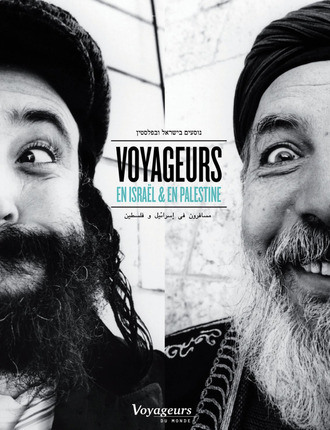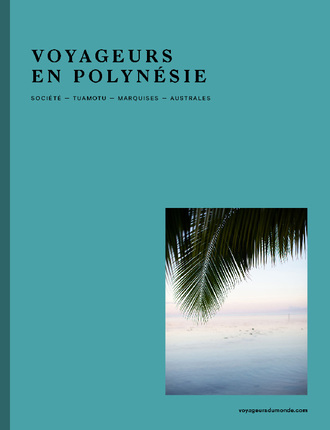Du vert pour l’espoir. Du jaune pour les rayons du soleil. Du noir pour ne pas oublier les peines passées et présentes. Les couleurs du drapeau jamaïcain ont déferlé sur le monde en même temps que le reggae et la philosophie rasta portée par les chansons de Bob Marley et les Wailers. Pourtant, « Jamrock » ne s’adresse pas qu’aux fans de musique. C’est une culture à part, des paysages au vert insoupçonné, des falaises qui se jettent dans la mer et, surtout, des gens qui cultivent et transmettent les good vibes. Récit d’un voyage en Jamaïque.
KINGSTON
Le reggae crépite sur la platine. Joint vissé dans un coin du bec, l’œil amusé, ce disquaire d’Orange Street nous observe attentivement fouiller dans son bric-à-brac poussiéreux. Au plafond, quelques vinyles suspendus se balancent dans l’air chaud brassé par le ventilateur. Au mur, la figure d’Haïlé Selassié Ier, Messie des rastas, est entourée d’une sélection hétéroclite de jaquettes. Autour du vieux comptoir en bois, des centaines de vinyles s’entassent en piles bancales sans aucun ordre apparent. Pourtant, lorsque nous lui demandons s’il a des vinyles des I-Threes, le vendeur nous signale un tas précis. Là, au milieu de quantité de compilations et albums hors d’âge, nous dégottons effectivement un vinyle de Marcia Griffiths, membre du groupe formé avec Rita Marley et Judy Mowatt. Nous voyant sortir d’un carton l’album Kaya (Bob Marley & The Wailers, 1978), le maître des lieux sort de sa réserve : « Tiens, vous avez de la chance, on n’en a quasiment plus. La plupart des disques de Bob Marley sont au Japon ».

Eléonore Dubois
Nous nous frayons un chemin dans les rues embouteillées du centre de Kingston. Derrière la vitre défile le quartier de Downtown et, bientôt, Devon House, grande bâtisse de style colonial entourée de jardins bien tenus. Elle fut construite à la fin du XVIIIe siècle par l’un des premiers millionnaires noirs de Jamaïque. À l’arrière, plusieurs commerces ont mis à profit l’espace et l’atmosphère élégante des lieux. Nous poussons la porte d’un glacier renommé et en ressortons de gigantesques cornets à la main. S’engage alors une véritable course contre la montre ou plutôt contre les 35°C ambiants. Une famille venue profiter du calme du parc semble s’amuser de notre mésaventure. Sur le banc voisin, deux écolières en uniforme bavardent. Un rasta passe. Dans une main, une jolie sculpture en bois ; dans l’autre, un peu d’herbe de son « jardin ». Tout est à vendre.
Nous remontons Hope Road. Juste après la résidence du premier ministre se dresse, au fond d’une cour, le Bob Marley Museum, mythique maison du chanteur où il avait l’habitude de recevoir ses amis, jouer au football, composer et enregistrer ses disques sous le célèbre label Tuff Gong Records. Malgré les touristes venus du monde entier et la boutique de souvenirs, le lieu n’a rien perdu de son âme. Le studio d’enregistrement du rez-de-chaussée semble encore vibrer de l’énergie positive de « Skip ». Dans la cuisine, les murs portent toujours les stigmates de la tentative d’assassinat qui le visa en 1976. Le mythe est intact.
Pourtant, Kingston nous fait vite comprendre que, s’il a mis son île sous les projecteurs du monde entier, Bob Marley est loin d’avoir le monopole du talent en Jamaïque. Nous le voyons sur les murs de Water Lane qui racontent l’histoire musicale du pays. De chaque côté de la rue piétonne, fresques et tags colorés reviennent sur les origines du mento, du ska, du rocksteady, du dub, du dancehall et du reggae, bien sûr. Des styles musicaux inventés en Jamaïque qui résonnent chaque jour dans les clubs et les fameux soundsystems, vertigineux empilements d’enceintes faisant cracher les décibels et danser la jeunesse jusqu’au petit matin.

Eléonore Dubois
LES BLUE MOUNTAINS
Nous quittons la capitale en direction des montagnes. Notre guide, Roger, un ancien ranger du parc national des Blue Mountains, est venu nous chercher à l’aube – les embouteillages peuvent être féroces à Kingston – mais la chaleur est déjà intense. Alors que nous nous éloignons du centre, il propose de faire halte pour le petit déjeuner. Nous le suivons jusqu’à un petit local à la décoration minimaliste. Trois tables entourées de chaises de jardin en plastique, deux reproductions de tableaux décolorées par le soleil. Au fond, à peine visible derrière sa petite guérite, une jeune femme souriante prend les commandes : poulet, ackee et morue salée, calaloo, banane plantain bouillie et dumplings frits. L’énergie nécessaire pour affronter les Blue Mountains, et le trajet pour y arriver. L’ouragan Beryl a mis K.O. la route principale, il nous faut emprunter les chemins de traverses, des pistes creusées et accidentées comme le lit d’une rivière. Roulant au pas, notre Jeep se fraie un chemin et nous brinquebale sans ménagement à quelques mètres du vide. Notre guide, heureusement, a dû être pilote de rallye dans une autre vie.
.jpg )
Zach/Adobe Stock
Alors que nous prenons de l’altitude, la végétation s’étoffe, l’air se rafraîchit un peu. Ici et là, des plantations de café et, à flanc de montagne, quelques maisons de bric et de broc. Nous nous arrêtons devant une cabane précaire, aux murs de tôle, de bois usé et de parpaings nus. À l’intérieur, deux incandescences luisent dans la pénombre : le feu sur lequel grillent les grains de cafés et l’énorme joint du rasta-torrefacteur. Assis sur une chaise, il remue régulièrement les grains dont se dégage une agréable odeur de noix grillée – le fameux café des Blue Mountains. Sous son bonnet, on soupçonne des dreadlocks vieilles comme le monde. Rien ici, si ce n'est ses tennis flambant neuves, ne donne d’indication temporelle. Pour torréfier le café, il utilise les mêmes ustensiles que les générations précédentes. Il sait aussi, explique-t-il, cuisiner « ital », un régime végétarien sans sel ni ingrédient transformé, base du mode de vie rasta. Il nous verse un café dans des tasses dépareillées puis retourne à sa tâche. Au fond de la pièce, on distingue par une ouverture des versants tapissés de plantes tropicales, généreuses, nourricières.
La nature des Blue Mountains donne de drôles de pommes en forme de poires et des plantes aux mille vertus. C’est du moins ce que pensent les Maroons, descendants d’esclaves noirs africains ayant fui l’esclavage. Et ce que nous explique Maurice, guide dans la région, alors que nous cheminons le long du Rio Grande. De ponts suspendus en sauts de cabri au-dessus des eaux émeraude de la rivière, nous parvenons à un petit hameau isolé, composé de maisonnettes en cours de construction. Il commence à pleuvoir sérieusement. Malgré l’averse et les gargouillis du Rio, nos oreilles perçoivent des notes de reggae que les montagnes se renvoient en écho. Sous leur parapluie, des petites filles endimanchées passent avec leurs parents. La musique est de plus en plus forte. Sous le ciel gris se détache soudain le jaune et le vert criards d’un bâtiment ouvert aux quatre vents. Devant, un soundsystem artisanal que bricolent à mains nues deux hommes trempés, la tête collée aux décibels. Au sec, une dizaine de clients observent sans parler, une Red Stripe à la main. La musique est trop forte pour permettre une quelconque conversation. À côté des platines du DJ, le sol est couvert d’un impressionnant enchevêtrement de câbles et de téléphones : privé d’électricité après le passage de l’ouragan, tout le monde est venu recharger son portable.

Eléonore Dubois
Nous reprenons la route. Loin des enceintes tonitruantes, mais toujours dans les Blue Mountains, nous profitons en fin de journée du calme olympien d’une retraite tropicale historique, installée en pleine jungle, à moins d’une heure de la capitale. Au premier étage de cette bâtisse coloniale inspirée des anciennes maisons de planteurs, notre balcon s’ouvre sur une immensité verte et vallonnée où s’épanouissent les caféiers. Le charme des lieux nous enveloppe et nous porte du lit au hamac, de la piscine au spa, du jardin au bar. On sirote un rhum vieux au son des standards de ska égrenés par l’orchestre.
LA CÔTE NORD
Nous sommes descendues de la montagne et avons rejoint le littoral. Au nord, nous prenons un bain de lumière face au sable blond et aux eaux turquoise. L’oisiveté est tentante mais pas incontournable et la plage cède vite la place aux cascades et aux rivières que l’on descend en rafting. À Port Antonio, on se frotte à la vie locale, au marché, à l’artisanat et aux patties, chaussons de pâte feuilleté garnis de viande, de crevettes ou de légumes. Un peu plus à l’est planent les ombres de James Bond et de Ian Fleming, son créateur, qui vécut du côté d’Oracabessa. Depuis notre nouveau lieu de villégiature, nous accédons directement à de merveilleux fonds marins à explorer en plongée ou, plus simplement, avec masque et tuba. Les tortues de mer se croisent sous nos paddles alors que l’on glisse jusqu’au spa, posé au bord du lagon. Massage, sunset et vodka martini, en l’honneur de 007, Jerk chicken et lointaine rumeur de reggae, en l’honneur de la Jamaïque.

Eléonore Dubois
Du côté d’Ocho Rios. Nous posons nos valises dans un hôtel plein de délicieux anachronismes, ayant vécu son âge d’or avec Maryline et le gratin des Fifties. Un panorama marin 100 % caribéen associé à une atmosphère élégante et British en diable. Afternoon tea et croquet sous les cocotiers. D’instinct, on s’habille pour aller dîner. Les tables sont dressées sur la terrasse, les lumières sont douces, la cuisine raffinée, la musique live bienvenue. Nous nous frottons au luxe au sens jamaïcain du terme : un service irréprochable, un souci sincère du bien-être des hôtes et une décontraction qui ne verse pas dans la familiarité mais a imprégné le langage. Ya, Mon.
À l’aube de notre départ, sur la presqu’île de Port Royal, nous nous attablons à la terrasse d’une institution réputée pour ses fruits de mer. Les chats errants guettent, à distance, les gestes maladroits. Nous songeons avec nostalgie, déjà, à cette Jamaïque vécue, touchée, entendue ; et à celle qu’il nous reste à voir : Teasure Beach, ses anses et ses cactus, Negril, ses falaises et sa fameuse 7-mile beach… Après un peu d’attente, la serveuse nous apporte le menu assorti d’un incontournable « Mi soon come ». Elle revient bientôt. Eh bien, nous aussi.
Par
ÉLÉONORE DUBOIS
Photographie de couverture : loveyousomuch - Stock Adobe