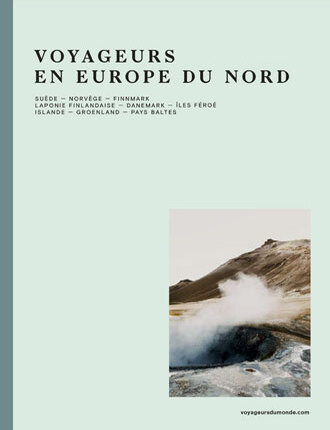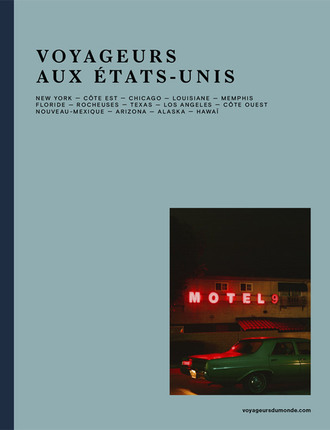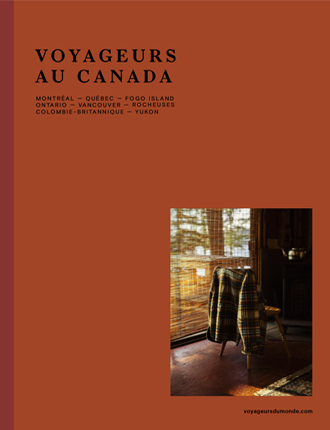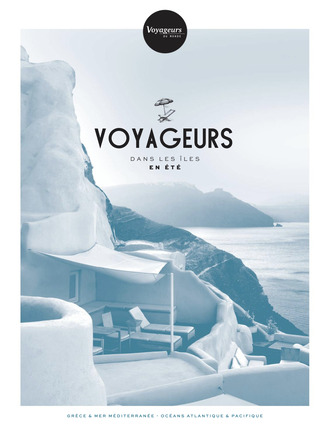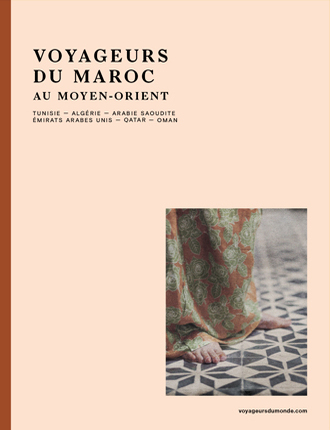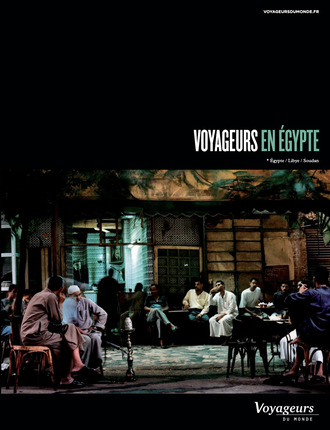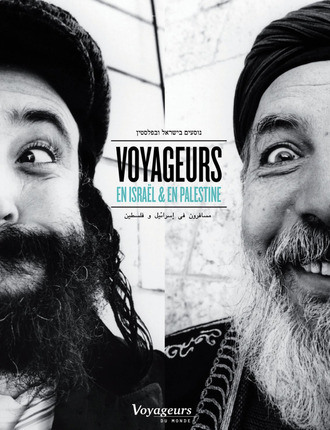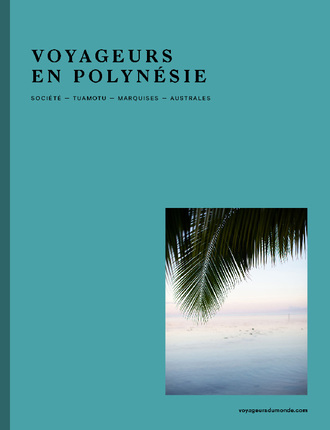À l’ombre des acacias fleuris et des chapelles manuélines, l’île de Mozambique, ancienne escale portugaise, offre une autre expérience du temps. Longtemps livrée à l’abandon, elle s’éveille aujourd’hui d’un long sommeil. Palais rénovés, ouvertures de villas, plages hypnotiques : l’ex-capitale du Mozambique revient sur le devant de la scène.
C’est un entrepôt de noix de cajou converti en hôtel. Une vaste résidence du xixe siècle devenue maison d’hôte. Une boutique de pagnes à l’abandon transformée en restaurant. L’ancienne guérite des douanes, suspendue au‑dessus des eaux polychromes de la baie, changée en bar à bières. L’île de Mozambique s’offre à l’évidence une nouvelle jeunesse. Sur cette flèche de corail – longue de trois kilomètres, large de cinq cents mètres –, la plupart des rues sont désormais pavées et les plages peignées. L’ancienne escale sur la route des Indes, perdue au large de l’Afrique orientale, émerge d’un long sommeil. L’ilha – ainsi que l’appellent les Mozambicains, comme s’il n’y avait qu’une île au monde – n’a pas l’intention de se travestir, consciente que son avenir passe par le respect de son passé.

Comment oublierait‑elle ses souvenirs quand l’océan en apporte, chaque matin, une nouvelle moisson ? Au pied des murs blanchis à la chaux de l’église San Antonio, il suffit de faire quelques pas pour trouver d’anciennes pièces de monnaie, des missangas (perles de verre) ou des éclats de porcelaine Ming. Autant de trésors issus des épaves qui reposent au large. Les enfants de l’île collectionnent ces souvenirs roulés par l’océan, dans l’espoir de les revendre. L’un d’eux, Ntuli Menuzio, 12 ans, tente sa chance auprès des étrangers. « Le tout pour deux mille meticais (environ 30 €) ! », s’époumone-t-il en agitant au creux de sa main des débris de porcelaine. Il essaie de les assembler à la manière d’un puzzle. « Les antiquaires de Londres et de Lisbonne vendent ça bien plus cher ! », argumente-t-il.

Avec ses mystères engloutis et ses chapelles manuélines, l’ilha offre une autre expérience du temps, faite de poésie et de silences sépia. L’ancien comptoir semble parfois douter de sa propre existence. Est-ce une île ou un souvenir ? Une saudade africaine ? Un délire de cosmographe ? L'intrépide Vasco de Gama, à la recherche d’un passage maritime vers l’Asie, a-t-il cru à un mirage quand l’île lui est apparue, à la fin du xve siècle ? Après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, le navigateur portugais filait sur l’océan Indien, alors le plus grand marché du monde : un réseau de ports, dominé par des armateurs musulmans, qui s’étendait de Sofala, au sud‑est de l’Afrique, jusqu’à Canton, en Chine. Sur les quais de l’île de Mozambique, l’or du Monomotapa et l’ivoire du Malawi s’échangeaient contre les cotonnades et les porcelaines d’Orient. À l’ombre des voiles, les Tamoules de la côte de Coromandel côtoyaient des vendeurs de chevaux yéménites et des pirates malgaches.

L’escadre de Vasco de Gama pleurait de joie : les nefs étaient sur la bonne route, celle des Indes, le pays des gemmes et des épices. Un sultan, Moussa-el-Bik, régnait alors sur l’île – par contraction, son nom aurait baptisé le pays tout entier : Mozambique. Prenant d’abord les navigateurs portugais pour des Turcs, il leur réservera un accueil fastueux : borderies d’or, trompettes d’ivoire, velours de La Mecque… « Il nous priait de lui montrer les arcs de notre pays et les livres de notre loi », notait un membre de l’escadre. Vasco de Gama s’efforcera d’entretenir l’ambiguïté, mais les croix sur les voiles délavées trahissaient l’évidence. Les deux camps ont fini par s’accrocher. Les caravelles s’éloigneront dans des volées de bombarde. « Malgré ces incidents, l’ilha demeure un modèle de tolérance, souligne Hafiz Jamu, chef d’une grande confrérie soufie de l’île. Elle a vu défiler tant de monde… Avant l’arrivée des Portugais, les sultans de la côte recevaient des marchands zoroastriens ou des chrétiens syriaques. Faisant écho à ces siècles, le soufisme que nous pratiquons aujourd’hui, originaire de Zanzibar et des Comores, est très souple. »

À 45 ans, Hafiz est l’une des figures les plus respectées de l’île. La demeure qu’il a héritée de ses parents, surnommée la « maison des merveilles », est ouverte à tous, y compris aux oiseaux de passage. « L’ilha est, sans doute, le seul endroit au monde où vous trouverez une mosquée portant le nom d’un saint chrétien ! remarque le jeune homme coiffé d’un calot brodé. Ici, il n’est pas rare de voir un cheikh assister à une messe de Noël… » On pourrait ajouter que l’assistant du brahmane, officiant dans le temple hindou de l’île, est musulman : lorsqu’on lui pose une question, il balance la tête à la manière indienne ! Hafiz nous conduit à l’étage de la maison, où s’alignent des cavités formant une rangée sur un mur. « Ces niches servaient autrefois aux pigeons voyageurs, précise-t-il. Mon père les envoyait vers le continent pour annoncer l’Aïd. Les gens pensaient que c’était de la magie. Ils avaient raison : une forme d’enchantement plane sur cette terre… » « L’île est belle, très belle, quel dommage qu’elle aime tant les conquérants », dit une chanson populaire. Les Portugais s’en empareront, au début du xvie siècle, plaçant la nouvelle colonie sous l’administration du vice-roi des Indes, basée à Goa. Cette précieuse escale, sur la route des épices, sera plusieurs fois envahie, assiégée, pillée, en particulier par les Hollandais. « Vers quels nouveaux désastres médites-tu d’entraîner ce royaume et ces hommes ? prophétisait un vieil homme dans Les Lusiades, recueil de poèmes épiques de Luis de Camões, glorifiant l’expédition de Vasco de Gama. Quelle gloire iras-tu leur promettre ? Quels éloges ? Quels triomphes ? » D’un siècle à l’autre, le comptoir restera ouvert à tous les vents du monde. Aujourd’hui encore, les 10 000 habitants de l’île semblent réunir l’ensemble des peuples de la planète. Ils vivent côte à côte, parfois sous le même toit : brahmanes du Pendjab, pêcheurs bantous, prêtres bossus du Portugal, négociants français d’huile de coprah…

À l’approche du crépuscule, les enfants courent sur l’ancien ponton des douanes pour s’élancer dans les eaux turquoise de la baie. Des baleines à bosse passent parfois au loin, en quête d’un refuge contre la houle. Amana Graça, qui dirigeait autrefois la capitainerie de l’île, a ouvert un petit bar sur la jetée : O Pontão. On s’y assoit à la nuit tombée pour écouter des histoires de gloire et de fortune. « Les siècles sommeillent là, près de nous, dans les profondeurs, raconte-t-elle, en étendant son bras vers l’océan. En dix ans, plus de 80 épaves de bateaux ont été repérées dans les parages. La plupart de ces navires battaient pavillon portugais. Leurs cales regorgeaient de lingots, de pierres précieuses, de ducats vénitiens… » De quoi aiguiser la convoitise des chercheurs de trésors. Chaque année, des pièces inestimables, dont les conditions d’acquisition demeurent troubles, sont vendues sur le marché international. « Beaucoup d’épaves n’ont pas encore été découvertes, assure l’ancienne capitaine de l’île. Mais les pêcheurs qui connaissaient leur emplacement ont tous disparu… » Un groupe de chercheurs américains serait pourtant sur le point de retrouver l’Aurore, navire marchand échoué dans les parages à la fin du xviiie siècle, avec 400 esclaves à son bord. Un membre de l’équipage – sorti indemne du désastre – deviendra célèbre : le corsaire français Robert Surcouf, alors âgé de 25 ans. À cette époque, l’escale portugaise s’était déjà émancipée de Goa pour devenir la capitale du Mozambique. Ses relations commerciales avaient changé de nature : la demande d’esclaves dépassait désormais celle d’or et d’ivoire. De tous les pays d’Afrique, le Mozambique sera l’un des plus durement touchés par la traite des Noirs. En dépit de l’abolition officielle de l’esclavage par le Portugal, en 1836, le « commerce » se poursuivra, sous une forme clandestine, jusqu’au début du xxe siècle.

Encore aujourd’hui, une coupure traverse l’île : au nord, la « ville de pierre et de chaux », qui s’inspire de l’architecture de l’Algarve ; au sud, la ville de Macuti, faite de paillotes et d’allées sableuses. D’un côté, l’espace, les palais, les riches demeures d’armateurs. De l’autre, des cases construites à la hâte dans le lit d’anciennes carrières. Seuls les acacias et les figuiers sauvages ignorent cette frontière. Les édifices coloniaux du Nord ont connu d’étonnantes reconversions. Le couvent de São Domingos fait office de tribunal. Le greffier, qui réside avec sa famille au rez‑de‑chaussée, conserve l’histoire du bâtiment dans un vieux carnet d’écolier. Une partie de l’immense hôpital João de Deus – longtemps le plus important de la côte orientale africaine – sert de logement aux étudiants. Entre ses murs ruisselant de bougainvilliers, l’établissement n’offre plus que les services d’un dentiste et ceux d’un médecin généraliste. Plus au Nord, des boutiques colorent à nouveau la rue des Arcades, où les notables défilaient autrefois, habillés à la dernière mode de Londres. Sur une place voisine, se cache la meilleure table de l’île, le Karibu. Ce restaurant, installé dans un ancien commerce gujarati en pierres de taille, aligne son menu sur la pêche du jour : langouste au pili-pili, curry de crevettes, thon au sésame. Face à l’église de la Miséricorde, un bar aux grandes baies vitrées laisse s’échapper des notes de Thelonious Monk. C’est le nouveau visage de la ville, où près de la moitié des rues ont déjà été repavées. Un patrimoine unique qui a, un moment, encouragé l’acteur américain Danny Glover à tourner ici son film sur Toussaint Louverture, révolutionnaire haïtien de la fin du xviiie siècle. Il préfèrera finalement le Venezuela. Mais le message a été entendu : l’ilha est à nouveau capable de séduire le monde…


Le soir, dans les ombres mauves de Macuti, des femmes dansent le tofo, tradition soufie mêlant apports arabes et bantous. Quelques hommes, agenouillés à leurs pieds, donnent le rythme sur des tambourins en peau d’antilope. Les paroles, reprises en chœur, abordent les difficultés du quotidien : la politique, la corruption, les déceptions amoureuses… Une rivalité féroce oppose les groupes de tofo. Au marché municipal, les danseuses s’adressent des défis par le subtil langage des pagnes : telle superposition de tissus exprime le mépris, tel assemblage de couleurs rappelle un échec… Difficile d’ignorer ces duels : les fofocas (ragots) font plusieurs fois le tour de l’île en une journée ! Le tofo est plus qu’un simple passe-temps : les femmes makhuwa – l’ethnie majoritaire de la région – chantent avant tout leur liberté. « Nous évoquons tous les sujets, sans nous soumettre à aucune loi ! », confie Jeanine, chef de file d’Estrela vermelha (Étoile rouge), le groupe le plus célèbre de l’île. La formation – dont le nom, avant l’indépendance, faisait référence à l’islam – a pourtant été rebaptisée pour plaire au pouvoir marxiste-léniniste ! Le tofo est aussi une source d’inspiration pour les pom‑pom girls qui enflamment les gradins du terrain de basket, derrière les banians entourant la forteresse São Sebastião. « Nos adversaires courent à la défaite ! chantent-elles. Ça nous chatouille la langue / Personne ne nous fera taire /Nos paroles s’envolent comme des oiseaux ! » Le sport profite de l’espoir collectif qui porte, aujourd’hui, l’ancien comptoir. Le nombre d’équipes de basket a quadruplé en quelques années. Les parties de football, quant à elles, se multiplient aux quatre coins de l’île, le plus souvent avec des ballons artisanaux, simples sacs plastiques ficelés ensemble. À ce rythme, les habitants verront bientôt renaître les compétitions de natation dans la belle piscine de la promenade orientale. L’ancienne escale portugaise est en passe de conjurer son déclin, qui semblait pourtant irréversible depuis la fin du xixe siècle. L’ilha s’était, en effet, éclipsée de la scène mondiale. Le canal de Suez, ouvrant une voie directe vers l’Inde, lui avait d’abord ôté son rôle de plaque tournante entre l’Europe et l’Asie. Elle avait ensuite perdu son titre de capitale au profit de Lourenço Marques (l’actuelle Maputo). En 1960, de peur que l’île ne sombre dans l’oubli, les autorités coloniales avaient jeté un pont de trois kilomètres entre la pointe méridionale de Macuti et le continent. L’Unesco tentera, à sa manière, de rappeler la capitale déchue à la mémoire des vivants, en l’inscrivant au Patrimoine mondial de l’humanité.


Après l’indépendance, l’île est devenue le symbole honni de l’époque coloniale. Abandonnée à son sort, elle ne séduisait alors qu’une poignée de voyageurs et d’artistes passionnés d’histoire, comme la photographe britannique Moira Forjaz. Dans les années 1970, elle tombera amoureuse de l’île, au premier coup d’œil. Les clichés de cette époque sont encore archivés dans la petite maison blanche qu’elle habite, au cœur de la ville. D’une image à l’autre, on découvre une femme makhuwa au visage couvert de musiro (masque protecteur contre le soleil) ; Samora Machel, le premier président de la République populaire du Mozambique ; ou encore Jean-Luc Godard, invité à Maputo en 1978 pour aider à la création d’une télévision nationale.


Le cinéaste français a conseillé la jeune photographe dans un projet de film sur l’exil. Au milieu de son patio bleu paon, Moira dévoile quelques passages de sa correspondance avec Godard – « Ce sont tout de même des lettres privées ! », se défend-elle. L’auteur d’À bout de souffle s’émerveille des malentendus linguistiques, selon lui propices à l’imagination. Puis il s’interroge : les films doivent-ils être à l’image du « script confus » de la vie ? Autant de fulgurances poétiques que l’ilha – à la fois distraite et séduisante, lumineuse et somnambule – illustre à merveille. Depuis quelques années, Moira se réjouit de voir l’ex-capitale gagner les faveurs du pays tout entier. Avec le temps, à mesure que la période coloniale s’éloigne, les Mozambicains se laissent enfin séduire. À Maputo, on ne compte plus les hommes d’affaires qui rêvent d’une résidence dans la « ville de pierre et de chaux »…
Par
ALEXANDRE KAUFFMANN
Photographies
JULIEN MIGNOT