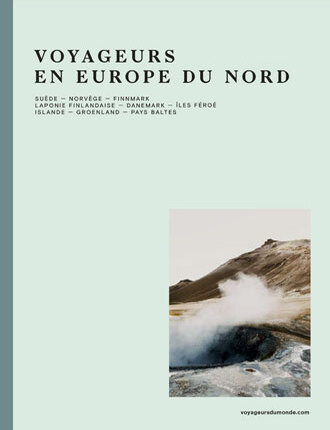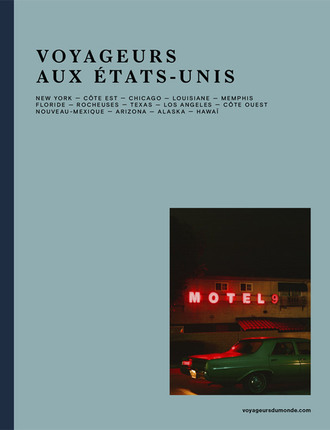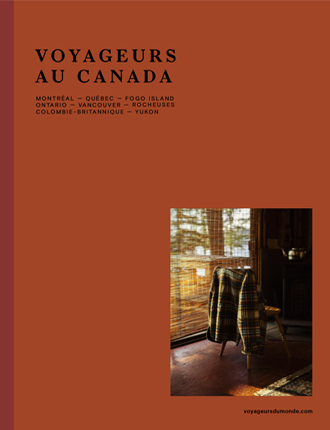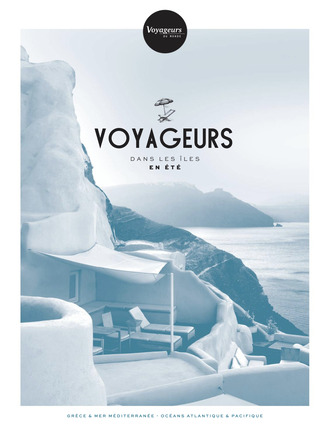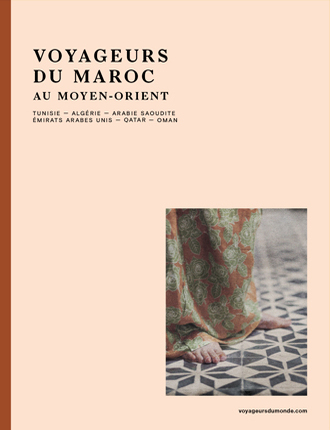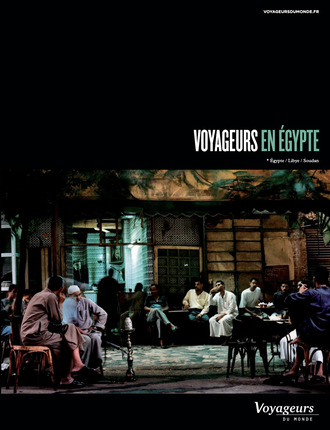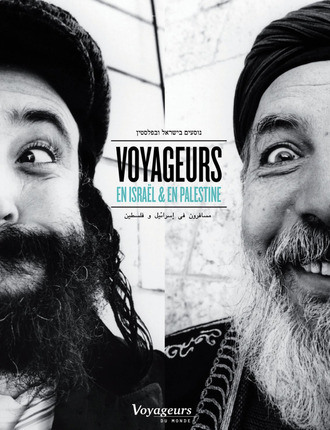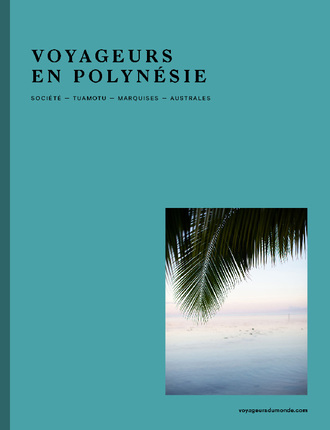Au-delà des clichés qui parfois polluent le paysage brésilien vu de la France, il est deux domaines qui scellent l’élan de sympathie qu’ici on éprouve pour là-bas : le foot, considéré comme un art dès qu’un Brésilien taquine le ballon, au point que les Français acceptent avec philosophie de perdre contre les “vert et jaune” (même si la France a souvent gagné ces derniers temps !). Embarquez pour un voyage musical au Brésil.
L’autre domaine est bien évidemment la musique. De bossa en frevo, de samba en lambada, de forro en maxixe, que d’histoires, souvent d’amour, parfois de dépit, et dans les deux sens. Je vous propose de remonter le temps jusqu’au début du siècle passé, et d’égrener les succulentes aventures qui ponctuent le temps, défiant les modes au point de parfois les précéder. La réalité oblige à dire que la France empruntera plus au Brésil que celui-ci ne piochera dans notre hexagone. Mais de ritournelles éphémères en mélodies classieuses, les échanges franco-brésiliens ne manquent pas de rebondissements.
Commençons par un énorme malentendu de l’histoire, on est en 1989. L’année du bicentenaire de la Révolution française... et de la Lambada ! Un “coup” monté par deux producteurs français, avec une boisson gazeuse, “ze” chaîne de télé en France et une “major” du disque. Kaoma, un groupe fabriqué à Paris, une frénétique danse à deux exportée du nord du Brésil, et une chanson... bolivienne ! Oui, vous avez bien lu : la Lambada est une ritournelle andine “empruntée” par des Brésiliens et revendue “made in Brasil” chez nous. Une sorte de quiproquo vite submergé par une déferlante planétaire : on danse la lambada dans tous les bals du monde, mais aussi dans les ateliers de Peugeot en grève et même sur les gravats du mur de Berlin, fin 89. Un Brésil chromo et popu à la fois, loin de celui des grands maîtres de la MPB (Musique Populaire Brésilienne). Rebelote en 1996 sur un mode mineur avec le groupe Carrapicho et son « Tic tic tac », n°1 au top 50, mais seulement en France, soit disant pour propager la culture amazonienne… Tu parles !
Cette relation amoureuse entre la France et la musique brésilienne commence au début du siècle (le vingtième) par, déjà, un autre malentendu, cette fois-ci, une escroquerie, “La Matchiche”. Un énorme tube dû à Félix Mayol. A une époque où n’existaient ni disque ni radio, un tube se mesurait en vente de partitions et en exécutions dans les bals, il restait un “hit” pendant des années. Cette Matchiche, présentée comme un “air populaire tiré du folklore espagnol” était en fait un extrait d’un opéra brésilien de Carlos Gomes, “Guarani” (1860), et son nom était la version francisée d’une danse des bals cariocas, le Maxixe (prononcez machiche). C’est ainsi que sans le savoir, la France entière a fredonné brésilien : “C'est la danse nouvelle, mesdemoiselles / cambrez la taille, petite taille / ça s'appelle la matchiche, prenez vos miches / ainsi qu'une Espagnole des Batignolles”.

Douglas Engle/ARCHIVOLATINO-REA
1918, Rio de Janeiro, un drôle de tandem représente très officiellement la France durant la fin de la Première Guerre mondiale : ministre plénipotentiaire (ambassadeur) Paul Claudel, oui, l’écrivain, Conseiller Culturel, Darius Milhaud, le compositeur. Celui-ci traîne dans les bouges de Rio et il tombe sur un tango brésilien (à l’époque ça existe), “O boi no telhado”. Le titre l’amuse, et de retour en France, il compose la musique d’un ballet inspiré par Jean Cocteau, le titre en est la traduction littérale “Le bœuf sur le toit”. Il s’est au minimum inspiré de ce qu’il a entendu à Rio (certains parleront de plagiat, mais ça n’ira pas plus loin, cette fois). Rebondissement inattendu, en 1921, s’ouvre à Paris un club de jazz du même nom. Et c’est ainsi que l’équivalent de la jam session, en français, deviendra... un bœuf !
En 1922, le Brésil conquiert quasiment la nuit parisienne. Duque, un danseur brésilien très en vogue de Montparnasse à Montmartre fait venir Pixinguinha, flûtiste et leader des Batutas. Au programme, choro, ce swing instrumental urbain de l’époque, et le samba naissant (en portugais, le genre musical est masculin !). Bookés pour deux semaines, ils vont rester six mois à l’affiche, au Shéhérazade, le triomphe de la saison, toute la presse en parle. Duque offre à Pixinguinha un sax, grâce auquel il deviendra un musicien emblématique au Brésil dans le demi-siècle qui va suivre. Seulement voilà, les musiciens ont le blues du pays. Les Batutas rentrent à Rio et là... pardon... le samba laisse place nette à une autre danse latino américaine, qui explose à Paris, le tango. De retour à Rio pour l’Exposition Universelle commémorant les 100 ans de l’indépendance du Brésil, Pixinguinha et ses Batutas font tube (en français) avec “Saramba” : “Le samba se danse, toujours en cadence / petit pas par ci, petit pas par là, / il faut de l’aisance, beaucoup d’élégance / les corps se balancent, dansez le samba”... Le Brésil a manqué son rendez-vous, il attendra son heure.

Zack Canepari/PANOS-REA
Dans un registre différent, le compositeur Heitor Villa Lobos qui révolutionne la musique dite classique avec ses amis intellectuels modernistes, tout en s’inspirant du choro, s’attaque au public européen et spécialement parisien, qu’il conquiert dans les années 20 et 30 avec notamment ses « Bachianas Brasileiras n° 5 ». Parrainé par Arthur Rubinstein, il fréquente l’avant garde des compositeurs, comme Edgar Varese. Il reste un des grands maîtres du 20° siècle, des deux côtés de l’Atlantique.
Dans les années 30, la chanson française en désir d’épices pioche dans le fond musical tropical, Cuba, les Antilles françaises et, bien sûr, le Brésil. Nom générique, le typique ! Même Maurice Chevalier s’y met, avec sa “choupeta” (la tétine) qui n’a plus de brésilien que le nom : “Une choupetta, savez-vous c' que c'est qu' ça ? / c'est un mot rigolo qui vient de Rio d' Janeiro / là-bas, chaque enfant, bercé par sa maman / s'amuse à chanter après avoir pris sa tétée”. Ca ne vole pas haut, dans l’entre-deux-guerres.
En été 42, un orchestre français s’évade de la morosité… et de l’Occupation. Ray Ventura et ses Collégiens passent clando les Pyrénées et, d’un coup de bateau, se retrouvent au programme du Casino de Urca de Rio, au pied du Pain de Sucre. Le big band français fait d’abord pâle figure à côté des rutilantes formations du cru. C’est le benjamin de l’orchestre, Henri Salvador, qui avec son imitation désopilante de Popeye, sauve l’honneur de la France. “Le Popeye”, titre la presse carioca. Mais Ray Ventura, le boss joue (et perd) la paie de l’orchestre à la roulette et le big band est bientôt “rapatrié sanitaire dans le Paris nazifié. Ils rentrent tous...sauf Henri Salvador qui, prudemment, vit quelques belles années entre Rio et Belo Horizonte, chantant de bar en bar. Il ne réintègre Paris qu’en 46 ! Sans avoir laissé d’autres traces que ses premiers enregistrements en tant que chanteur (avec Ray Ventura).

Oliver Tjaden/LAIF-REA
Les années post Libération voient la France, suivant les USA, s’enticher de rythmes afro-cubains, le mambo et le cha-cha-cha et brésiliens, samba et baion. Dario Moreno, Turc, devient icône de tout ce qui est latino ou brésilien (de loin, ça se confond !), voir “Si tu vas à Rio” et “Brigitte Bardot” (la chanson adaptée d’un tube de Carnaval) ; justement, Brigitte Bardot (la vraie !) danse un furieux mambo dans ”Et Dieu créa la femme” et s’affiche à Buzios, le Saint Trop’ brésilien. La variété française des années 50 et 60 continue de piocher dans les tubes do Brasil, comme Gloria Lasso, Ray Ventura, Jacques Hélian, et une certaine Rose Mania, avec son “Cavaquino”. Pendant un moment, tout est samba. Encore une fois, beaucoup de pacotille. C’est l’époque où une certaine jet set remplit un long courrier pour Rio de Janeiro à l’initiative du producteur Eddie Barclay. Ca flambe !
C’est alors que nous arrive de Copacabana et Ipanema, les plages chic de Rio, une brise tropicale nettement moins folklorique, la bossa nova, avec son peintre minimal, João Gilberto, son architecte de l’épure, Antonio Carlos Jobim et son poète amoureux, Vinicius de Moraes. Une sorte de samba susurrée sans débauche de percussions. Et c’est la BO d’un film français tourné à Rio, “Orfeu Negro”, de Marcel Camus, qui remporte la Palme d’Or à Cannes en 1959. Le genre musical, adopté par les tenants du jazz cool US (Stan Getz, Gerry Mulligan) devient un label planétaire. Le Président Kubitschek, qui inaugure la nouvelle capitale, Brasilia, est surnommé... « le Président Bossa Nova ». Bon, ce n’est pas pour autant qu’Henri Salvador a inventé la bossa nova, comme certains l’ont proclamé. Jobim a bien été charmé par Salvador et “Dans mon île”, ballade créole figurant dans la BO d’un obscur film italien, mais l’influence est pour le moins lointaine. Au moment où la bossa nova part à la conquête de la France, voilà que les Beatles et la tornade britiche relèguent cette douce brise au rancart.
Pas pour longtemps. Au Festival de Cannes, en 1966, cette fois, un autre film français est primé, “Un homme et une femme”, de Claude Lelouch, et son leitmotiv sonore s’incruste durablement dans les oreilles, un certain chabada-bada, dû à Francis Lai et Pierre Barouh. Ce dernier, un fondu de Brésil, va initier des générations de Français à la musique brésilienne. Il faut dire qu’à Paris se sont installés Vinicius de Moraes, poète, conseiller culturel à l’ambassade du Brésil et grand noceur, et le génial guitariste Baden Powell avec lequel Pierre Barouh a enregistré la fameuse “Samba Saravah”. Saravah, justement, un label d’allumés créé par Barouh (où éclateront Higelin et Brigitte Fontaine, entre autres), et aussi un incroyable film tourné au Brésil par le même, avec des séquences musicales d’anthologie. Autour de tout ce monde bohème gravite un petit peuple dingue de samba et de bossa, d’où de mythiques nuits blanches sous l’étoile du Brésil.
Une autre génération déboule au Brésil, plus contemporaine voire plus sulfureuse, qui fait figure de contre pouvoir (au moins artistique), face à la dictature militaire qui s’installe. Parmi eux, Chico Buarque, véritable conscience en ces années de censure, chanteur et poète essentiel et, curieusement, souvent adapté en français à tort et à travers, parfois détourné voire malmené : Vassiliu (“Qui c’est celui-là ?”), Zanini (“Tu veux ou tu veux pas ?”), Dalida (“La banda”) et, pire encore Sheila (qui transforme le poignant “Funeral do lavrador” (Enterrement d’un paysan) de Buarque en un grand-guignolesque “Oh mon dieu qu’elle est mignonne” !!!). Heureusement, Barouh, Nougaro et Moustaki se montrent plus inspirés dans leurs adaptations occasionnelles et sauvent l’honneur de la chanson française.

Espen Rasmussen/PANOS-REA
La dictature militaire brime la création au Brésil, et engendre un exil souvent politique, parfois artistique et à l’occasion les deux. En 1971, les Tropicalistes Gilberto Gil et Caetano Veloso, qui ont été exilés et catapultés en Angleterre par les militaires pour avoir défié l’ordre moral, passent par Paris, où ils sont ovationnés par des milliers de compatriotes en exil. Ils vont donner une impulsion novatrice, à la fois pop et afro à l’image de la musique brésilienne, ici. Par ailleurs se crée une scène brasilo-parisienne, de nombreux groupes se forment. Le jazz et la samba fusionnent avec Nana Vasconcelos puis Tania Maria. Et en 79 a lieu le premier festival brésilien de Paris à la Halle Baltard de Nogent sur Marne : quinze groupes quasiment tous basés à Paris, dont Les Etoiles et Alceu Valença, six mille spectateurs, un triomphe pour les nouveaux producteurs de Garance ! Par contre, dans l’autre sens, c’est léger : Le français a perdu depuis les années 40 sa prédominance en tant que langue étrangère, alors quand le Brésil chante en français, ça se remarque, Caetano Veloso reprend “Dans mon île” d’Henri Salvador et João Gilberto, le pape de la bossa, “Que reste t’il de nos amours”. Toujours le patrimoine. Décidément, l’échange est foncièrement déséquilibré...
1981, ce sont les années Mitterrand, et plus encore les années Jack Lang, tant le Ministre de la Culture s’est entiché de Brésil. O intercambio (l’échange) bat son plein. Tous les grands du Brésil écument les scènes d’Europe, de l’Olympia à Montreux. Gilberto Gil chante « Touche pas à mon pote » (en français dans le texte à la Fête de SOS Racisme place de la Concorde). De méga festivals Brésiliens à Nice en 84 et à Paris en 90 / 91, et puis les années France Brésil en 86 avec “Couleurs Brésil” au Zénith et à la Grande Halle de La Villette. Un mouvement plus tout à fait à sens unique, “France Métisse” voit tourner au Brésil la scène afro-caraïbe, avec Kassav’, Manu Dibango, Salif Keita, Ray Lema. Et puis la pub surfe sur l’air du temps et s’approprie des airs oubliés, comme cette chanson exhumée du répertoire de Chico Buarque (encore !), “Essa moça ‘ta diferente” (cette fois en VO), qui fait onduler les bulles d’une boisson gazeuse (une autre que pour la lambada) : aussi incongru que si on vantait un produit français sur du Brel au Brésil !!! Mais du coup, c’est un méga tube, un an avant la lambada ! On exporte aussi le Trio Elétrico, camion à musique du carnaval de Bahia, à Toulouse en 86 puis sur les plages françaises en 90. Derniers phénomènes du siècle dernier qui se perpétuent jusqu’à aujourd’hui : la capoeira (à la fois art martial et danse), héritée des esclaves noirs, qui fait son trou dans nos villes et a la cote jusque dans les banlieues, et les batucadas qui prolifèrent partout en France, dans l’esprit des Ecoles de Samba de Rio ou des Blocs Afro de Salvador...
Nouveau siècle, nouvelles ouvertures. Cette fois, c’est le gouvernement Lula et son ministre de la Culture pendant cinq ans, Gilberto Gil, qui portent la parole... en musique. D’autres scènes brésiliennes prennent de l’ampleur par chez nous : thématiques, comme l’electro de Marcelinho Da Lua, la drum n’ bass de Marky et Patife (des sommités mondiales du genre) ici et Laurent Garnier là-bas, le hip hop / samba de Marcelo D 2, voire le Baile Funk des périphéries ; géographique, avec la confirmation d’un pôle créatif dans le Nordeste, Recife, avec la venue régulière de Lenine, DJ Dolores, le Spok Frevo Orquestra, plus Silverio Pessoa et Renata Rosa, qui flirtent avec les rythmes (et artistes) occitans et Manu Chao, qui arpente régulièrement le Brésil. En règle générale, les échanges sont plus équilibrés avec les artistes français : à l’année du Brésil en France (2005) a répondu celle de la France au Brésil (2009), avec notamment des tournées mixant les artistes des deux pays, comme Station Brésil de João Pessoa à São Paulo et un hommage à Gainsbourg, dans un théâtre pauliste, avec les Brésiliens de l’Orquestra Imperial plus Caetano Veloso accueillant Jane Birkin et Jean Claude Vannier, l’arrangeur seventies de Gainsbourg. Impérissable, aux dires de ceux qui y ont assisté.
Par
REMY KOLPA KOPOUL
Photographie de couverture : Bernd Jonkmanns/LAIF-REA