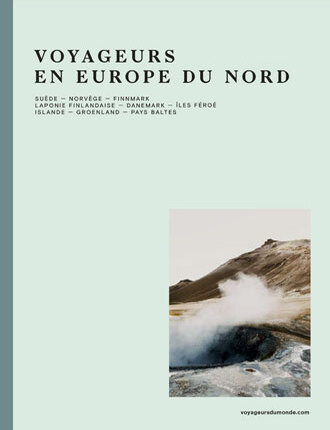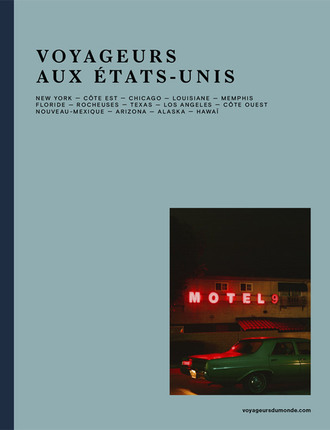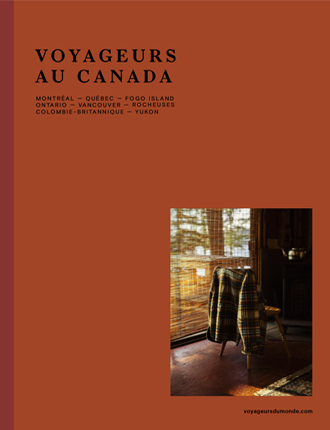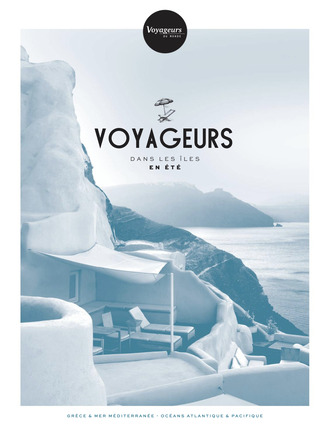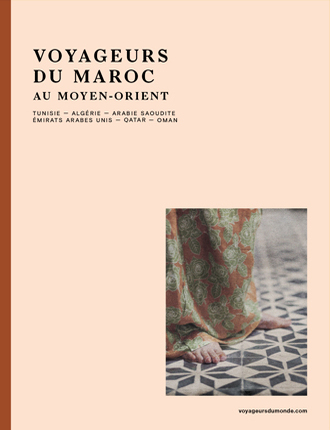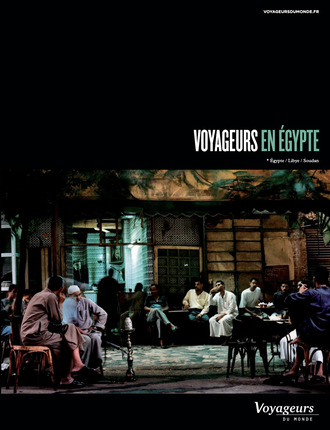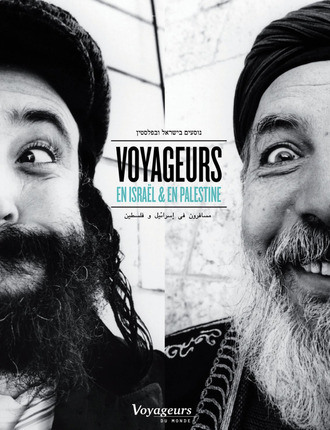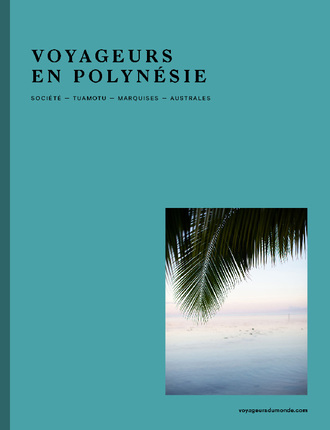Né à Lisbonne dans les quartiers de l’Alfama et du Bairro Alto, le fado est inséparable de l’âme lisboète. Chant d’une ville et emblème du Portugal, il est plus qu’un cliché : une pratique vivante qui imprègne la culture portugaise.
Un châle noir, une guitare, une voix et des sentiments.
Le Mississipi a le blues, le Brésil a la saudade, le Portugal a le fado. À l’origine, il y a le fado des marins, qui mettent en musique le fatum, la fatalité, le destin qui les emporte loin de la Mère patrie. Un chant atlantique qui dit la nostalgie de l’immigrant, le sentiment vagabond du marin en exil. Complainte d’amour, de misère et de mort, le fado se développe au début du XIXe siècle dans le port de Lisbonne, dans les quartiers populaires de l’Alfama, de la Mouraria et du Bairro Alto. Les bas-fonds chantent le vague à l’âme, le mal d’aimer, la pauvreté, le désir d’ailleurs, les drames de la destinée.
Le fado a une structure – la poésie, la profondeur des sentiments, les sonorités de la guitarra, la guitare portugaise dotée de douze cordes – et une dramaturgie – le costume, le châle noir, les yeux clos. Il a des figures tutélaires, Maria Severa Onofriana, Alfredo Duarte et Amalia Rodrigues. La première est une prostituée, connue sous le nom de « la Severa », née en 1820, assassinée en 1846. Elle est la maîtresse d’un aristocrate, Dom Francisco de Paula de Portugal, et cette union fait que le fado, originaire des bas-fonds, se développe dans les beaux quartiers, séduits par cette histoire d’amour impossible. Alfredo Duarte « Marceneiro », né en 1891, ébéniste de métier et acteur né, incarne, lui, le fado des années 1920, il lui donne ses rites et sa gestuelle. Enfin, et bien sûr, l’icône absolue, Amalia Rodrigues, née dans une famille pauvre en 1920, analphabète, brodeuse, repasseuse puis vendeuse d’oranges, elle rejoint des chorales populaires et se retrouve en quelques années propulsée monstre sacré du fado. Elle se produit dans tous les hauts lieux du fado lisboète, du Café Mondego au Solar da Alegria. Elle impose par la poésie de ses chants la présence du Portugal à travers le monde.
À l’origine musique des marins et des dockers, des prostituées et des marchands ambulants, des marginaux, le fado rassemble bientôt tout un peuple et devient indissociable de la culture du Portugal, petit pays qui fut à la tête d’une empire immense, marqué par un sentiment de perte – le poète lisboète Fernando Pessoa le disait : « Le fado, c’est la fatigue de l’âme forte, le regard de mépris du Portugal vers le Dieu en qui il a cru et qui l’a aussi abandonné. »
.jpg )
Pedro Simões / Wiki Commons
Fado, futebol, Fatima
De 1926 à 1974, le Portugal est soumis à la dictature de l’Estado Novo, « État nouveau » de Salazar : culte du chef et empire colonial, travail, famille et catholicisme. Le pouvoir autoritaire met au pas le fado, soucieux de contrôler une musique populaire qui, porteuse de fronde sociale, se déploie dans les tavernes, loin de toute surveillance. Les fadistes doivent soumettre leurs textes à un comité de censure pour se voir accorder une carte professionnelle, les amateurs n’ont pas l’autorisation de se produire. Bientôt la musique des dockers et des canailles est érigée en art national et chargée d’exalter les valeurs morales de la nation. L’ancien chant des bas-fonds devient un spectacle bourgeois, sans plus aucune portée sociale. Le 25 avril 1974, après quatre décennies de dictature, une chanson, Grandola Vila Morena, chanté par José Afonso et diffusée sur les ondes de radio Renaissance, déclenche le putsch et devient l’emblème de la Révolution des œillets – ce n’est pas un fado. Pendant presque deux décennies, le fado est attaqué par les postrévolutionnaires et présenté comme un vestige des temps réactionnaires, outil de propagande moralisatrice et catholique. Ils décrient l’ère du « très F », « triple 3F » : fado, futebol, Fatima – un chant, un sport, un miracle. Entre 1974 et 1990, les maisons de fado sont délaissées ; le fado ne survit que dans l’intimité familiale.
Fado queer
À partir des années 1990, le fado est progressivement réhabilité, notamment grâce à Carlos do Carmo. Né en 1939, fils de la chanteuse célèbre Lucilia do Carmo, il démontre que le fado n’a pas été complice avec la dictature, mais en a été la victime. Il devient le maître incontesté du fado moderne et joue un rôle central dans le renouvellement du genre sans en renier les fondamentaux. Il permet à une nouvelle génération d’émerger : Mariza, Camané, Cristina Branco, puis à leur suite Ricardo Ribeiro et Carminho incarnent un fado vivant et ancré dans son époque. En 2011, le fado est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Un pied dans le passé, un pied dans le présent, flirtant parfois avec le jazz, le rock ou l’électro, le fado ne cesse de se renouveler. Gisela Joao casse les codes – exit le noir, les robes longues et le châle, elle est toute de blanc vêtue, mais produit un chant viscéral, impérieux. Guitare électrique, bas résille, paillettes et mini-jupe, Tiago Lila et Joao Caçador confrontent le fado avec l’univers flamboyant des drag-queens ; elles produisent un fado queer qui se réapproprie très librement le répertoire traditionnel, qui s’ancre dans le patrimoine tout en ouvrant grand les fenêtres.
Aujourd’hui comme hier, le fado est au cœur de la culture portugaise. On va l’écouter, dans ses formes patrimoniales ou les plus avant-gardistes, dans les maisons de fado de Lisbonne ou de Coimbra.
Par
MARION OSMONT
Photographie de couverture : Lucy Laucht