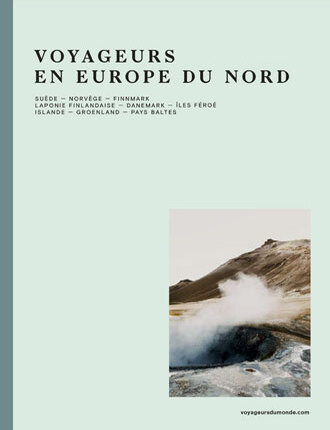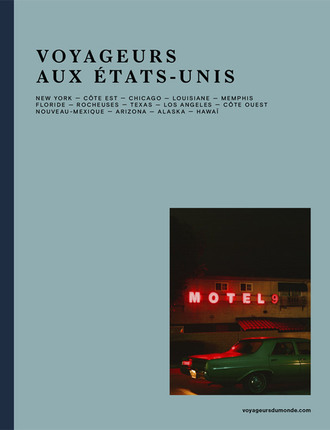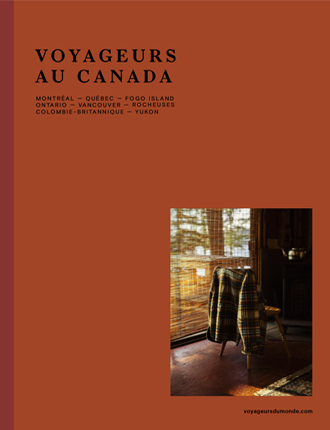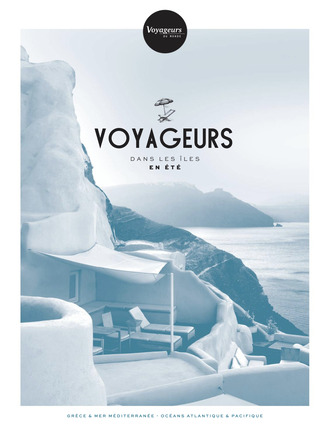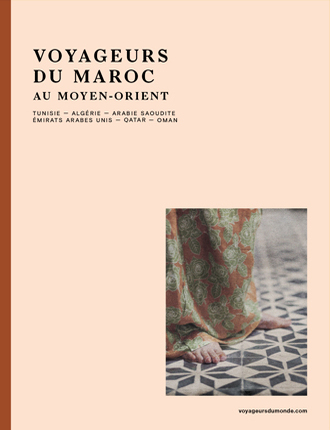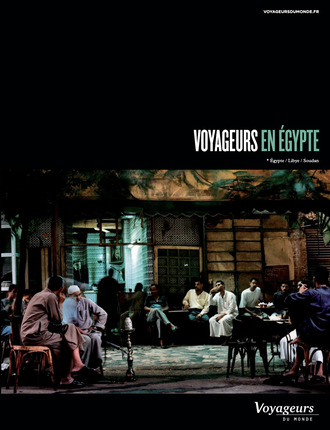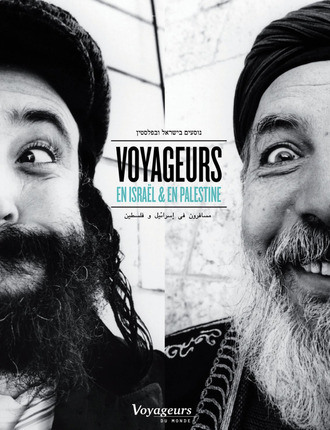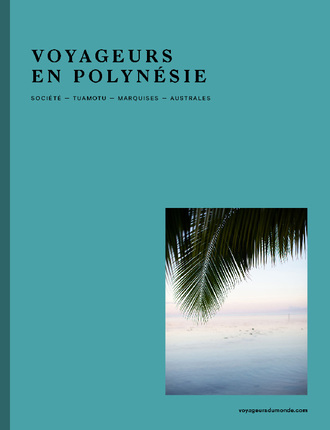Loin de la Costa Smeralda, il est une autre Sardaigne, âpre et silencieuse : la côte occidentale qui, du cap Caccia au cap Spartivento, se dessine sur près de 400 kilomètres. Tournée vers le grand large, elle a transformé avec le temps l’oubli en une richesse inestimable, gardant intacts la légende des millénaires et le cœur fraternel des habitants.
Il faut la gagner par la mer, comme ses premiers habitants venus d’Orient. Vivre la nuit au large en se souvenant des pirates et des Maures assoiffés. L’aube, à l’approche de Porto Torres, comme le premier matin. Avec le jour s’éprendre de la grande plaine des brigands roussie par les soleils, avant d’atteindre la mare di fuori (“la mer extérieure”) que plus rien ne retient. Alors on sent, avant même de savoir, le parfum de la terre antique “allée avec la mer, comme une éternité”.

Depuis la ville de Fertilia, conçue par Mussolini, s’étend la plaine piquée de champs de vigne et d’oliviers. Au pied d’une colline, presque incidemment, un champ de pierres et les vestiges d’une tour : le nuraghe Palmavera. Le soleil est fort et blanc. Le lieu, déserté. Un labyrinthe de murets dessine les bases des maisons disparues. Au centre d’une couronne de pierres, le souvenir d’une fontaine, et, tout autour, les bancs de pierre circulaires. À chaque pas, le présent desserre son étreinte. Il n’y a que le ruissellement des grillons et l’odeur prégnante des aiguilles de pin qui tapissent le sol. Un temps d’arrêt devant l’entrée du dôme. L’ombre est salutaire. On y entre en se baissant comme un orant. Ce faisant, on enjambe les millénaires et l’imaginaire. C’était il y a plus de 1 500 ans avant J.-C. Sous la voûte de pierres sèches, les chefs de clans réunis, le devin et ses oracles, le sacrifice d’un cœur de bouc... Forteresse, bastion de défense, habitation ou lieu de culte, aucune trace écrite ne vient donner de réponse certaine. Seules les pierres contiennent le secret.

Que s’est-il passé il y a quatre mille ans qui aurait englouti la civilisation nuragique, l’unes des plus anciennes d’Europe ? Un gigantesque cataclysme provoqué par la colère de Zeus, comme le suggère Platon ? Un tremblement de terre ?
Un raz-de-marée provoqué par la chute d’un astéroïde ? L’énigme reste entière, qui soulève l’hypothèse la plus extraordinaire : la Sardaigne serait la mythique Atlantide, ce continent disparu “en une seule nuit et un seul jour néfastes”, écrit Platon. Et les colonnes d’Hercule, délimitant le monde connu des anciens Grecs et au-delà desquelles se trouvait la mystérieuse Atlantide, se situeraient non pas à la hauteur du détroit de Gibraltar, mais dans le canal de Sicile, entre les côtes italienne et tunisienne… La terre aurait tremblé, la mer avalé les villages et les S’ard (“danseurs des étoiles” en langue antique) auraient trouvé refuge dans les montagnes, creusé des cavités, les “maisons des fées”, pour les vivants et pour les morts… Mythe ou réalité, les habitants des rivages ont hérité d’une grande méfiance envers la mer, et longtemps les villages lui tournaient le dos. Elle reste celle qui porte les ennemis à bord de navires chargés de chevaux.

Il faut peu de temps pour gagner le cap Caccia au fond de la baie de Porto Conte. Du haut du promontoire, le regard embrasse le golfe profond d’Alghero. Ses falaises abritent un vaste réseau de grottes, dont les grandioses cavernes de stalactites de Neptune. On y accède en empruntant un immense escalier à flanc de paroi.
« La Sardaigne serait la mythique Atlantide, ce continent disparu en une seule nuit et un seul jour néfastes. »
Vers Bosa, par la route de la côte. À main gauche, des massifs entiers couverts d’un maquis robuste et odorant – lentisque et romarin, arbousier et genêts. À main droite, la mer qui se prend dans chaque virage. Et haut dans le ciel, le vol du vautour griffon. Son ombre, plus puissante encore, lisse les pierres.

Bosa ? “Lungo il fi ume…” (“Le long du fleuve, tout droit”), nous indique un passant le bras tendu vers l’embouchure du Temo. Je l’entends comme un oracle… Sur la rive gauche, au-dessus d’une rangée de barques, se pressent les anciens entrepôts de tannerie. Sur sa rive droite, la citadelle, coiffée d’une forteresse du XIIe siècle. Et en toile de fond, la crête rousse des montagnes hirsutes. Depuis la cathédrale, l’ascension de la ville aux couleurs vives. Immuables, les dentellières se tiennent sur le pas des portes pour profiter du passage, s’il y en a, dans une immobilité un peu tragique.
Le jour s’éteint avec le chœur des fauvettes dans les frondaisons des palmiers, le long de la rivière. Au temps des Romains, les S’ard dialoguaient d’un village à l’autre à l’aide des oiseaux. L’arrivée du faucon signifiait : “Viendra un voyageur, qu’il soit comme moi-même”. L’arrivée du merle : “Viendra un homme dangereux à ne pas tuer”. Le corbeau : “Tue celui qui viendra”… Qu’en est-il de la fauvette sarde ?

On l’aperçoit de loin. Sur le massif de Montiferru, la basilique Santa Maria della Neve surplombe le village de Cuglieri. De part et d’autre de ses deux campaniles, les petites maisons épousent l’arrondi de la pente. Ici, comme partout en terre sarde, les jours vont au son du tocsin et selon le calendrier des célébrations. De la semaine sainte aux Rameaux, de Santa Maria à Sant’Efi sio, il n’est de village qui n’ait son saint, ni de saint sa fête. Alors, tous les habitants vont en procession au rythme des fanfares ou des chants polyphoniques – qui laissent parfois entendre la quintina, cette voix immatérielle née de l’harmonie des chants...

La voix encore. C’est celle des aînés qui transmet contes et légendes. Ainsi, l’été, jusque tard dans la nuit, on peut entendre en langue sarde les joutes poétiques et ferventes des plus vieux… À la sortie du village, se cache la source sacrée Tiu Memmere. On dit que ses eaux apportent la fertilité. On s’y rend la nuit de la Saint-Jean, depuis l’église du saint, en silence et à pied, sans jamais se retourner et en veillant à marcher sur les côtés de la route – le centre est réservé aux âmes mortes. Dans ce pays où “les étoiles sont les syllabes du créateur”, où l’eau des montagnes féconde la terre et les femmes, où l’on se souvient des fêtes païennes qui rythment les saisons, le sacré n’est jamais loin.
À la hauteur du Cap Nieddu, la terre est aux brebis. Antonello, issu d’une famille de bergers de père en fils, a 50 ans, un troupeau de trois cents têtes et des chiens redoutables. Il fabrique des fromages de pecorino et ne saurait renoncer à “tant de richesses”. “C’est un vieux métier, c’est un beau métier, même pendant les mois d’hiver. Et l’hiver dure longtemps.” Son amie Piera dit de lui : “Il est comme le vent et les pierres. Comme l’île tout entière. Léger et robuste.”

La route retrouve la mer à la hauteur de S’Archittu et de Santa Caterina di Pittinuri. Ici, les falaises blanches sont défendues par des tours sarrasines. Là, une petite église médiévale dialogue avec les stèles des divinités. Plus loin, le site de Cornus révèle les ruines de la ville punique, théâtre des batailles entre les Carthaginois et les Romains vainqueurs …
Nous gagnons la péninsule du Sinis. Au pied de la colline de Mont’e Prama s’étend un vaste terrain de fouilles sur une ancienne nécropole. Tout commence avec une grosse tête en grès, aux yeux en forme de cercle, découverte en 1974 par deux agriculteurs alors qu’ils labouraient leur terrain. Les cinq mille fragments découverts ont été assemblés dans les années 2000, ressuscitant une trentaine de statues, hautes de 2 m, datant de l’ère nuragique : guerriers, pugilistes, archers…. Les recherches se poursuivent. Une armée est en marche, qui vient du fond des âges.

Passons le chemin de terre légendaire qui court vers San Salvatore – chaque année, des milliers de jeunes hommes, pieds nus, s’élancent dans la corsa degli scalzi (“la course des nu-pieds”) en hommage à leurs ancêtres qui sauvèrent la statue du saint pendant une attaque de pirates… Passons, éblouis, les plages de quartz blanc, lacs de sel, criques aux dégradés de bleu…
À l’extrémité de la presqu’île, dans la solitude d’un petit village de pêcheurs, l’église de San Giovanni – d’une humilité presque blessante – est la dernière halte avant le territoire de Tharros, ancien comptoir phénicien où veillent une tour espagnole et deux colonnes corinthiennes. L’air est chargé des remous des marais. Dans le port de Cabras, les plus valeureux prennent la mer. Avec la nuit, leurs embarcations fi lent sur l’étang. Ils vont par deux, un compagno pour ferrer le poisson, un autre pour manœuvrer la barque. Le jour transformera les œufs des mulets en “or de Cabras”, la boutargue. Francesco ne craint rien. La mer, il préfère ne pas la nommer mais il dit l’avoir fait sienne et avoir dompté ses fantômes.

De Bosa à Cabras, de Tresnuraghes à Cuglieri, de Sennariolo à Santa Caterina, chaque village traversé est un pays à lui seul. Sur ces terres que la mer tient en respect, où règnent le loup et le sanglier, le myrte et l’asphodèle, les habitants portent en eux une sorte de patience ou de souffrance en commun, comme une fraternité passive…
Dans le soir, la promenade est lente. Le rythme s’étiole. Il ne faut pas manquer de saluer d’un sera (“bonsoir”) un peu traînant les vieilles femmes assises sur un banc et les hommes assis sur un autre. Un peu surpris mais sans défiance, ils tarderont parfois mais finiront par répondre à votre salut. “Sera.” Leur enseignement est simple, patient et généreux. L’hospitalité est ici “une vertu première, grâce à quoi les paysans ouvrent leur porte à l’étranger qu’ils ne connaissent pas, sans lui demander son nom. Une vertu dont tous les villages se disputent la palme, tous fi ers d’être le plus amical et le plus ouvert au voyageur venu de l’extérieur, qui est peut-être un dieu déguisé”, écrit Sergio Atzeni, chef de fil de la Nouvelle Vague littéraire sarde.

Carbonia par l’autostrada SS 131 avant d’attaquer la montagne, recto verso. Un temps et une allure différents qui coïncident avec une autre géographie – intérieure et extérieure. La montagne abrite le plus grand parc géominier du monde et les villages fantômes d’Ingurtosu et de Montevecchio, qui exploitaient jusque dans les années 1960 le zinc, le plomb, l’argent. Restent les installations titanesques délabrées, les rails interrompus, leurs wagonnets immobilisés, et les veines de la terre murées.

À l’approche de la Costa Verde, la route renonce devant le chemin de terre avant d’atteindre Piscinas et son désert de sable. La légende raconte que les Phéniciens naviguant au large de la Costa Verde virent briller un ruban d’argent dans les collines. C’était un filon à ciel ouvert, exploité jusqu’à épuisement par les Romains…
INFO+
> Le bon moment : d’avril à octobre.
> Y aller : vol direct pour Olbia (de mars à octobre) et Cagliari (de juin à septembre) avec Easy Jet, à partir de 80 € A/R.
> Décalage horaire : GMT + 1, soit aucun décalage avec la France.
> Bon à savoir : il n’y a jamais plus de 2 heures de route entre deux étapes, cela laisse le temps de flâner dans les villages – en marge de la foule des touristes, l’ouest de la Sardaigne étant beaucoup moins fréquenté –, d’improviser une baignade au fil des criques, alors soyez toujours parés à sortir le paréo !
Par
VIRGINIE LUC
Photographies
PATRICK MESSINA