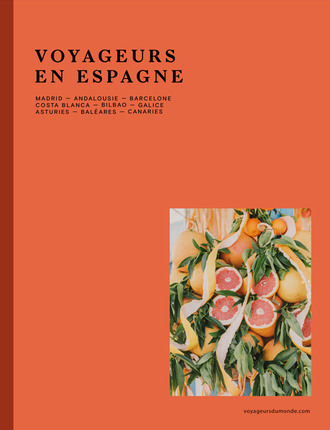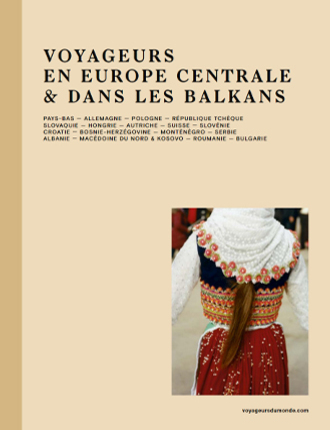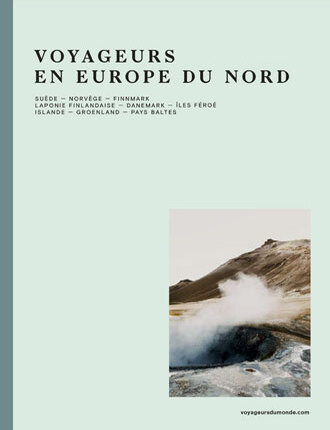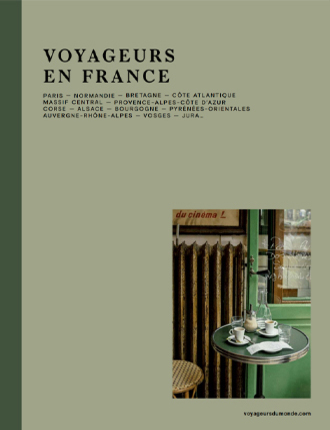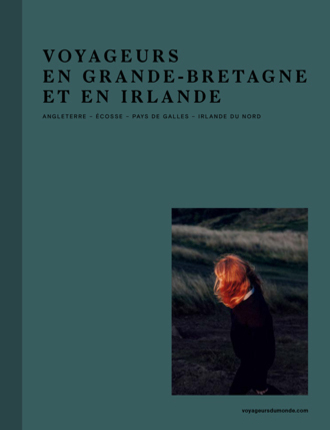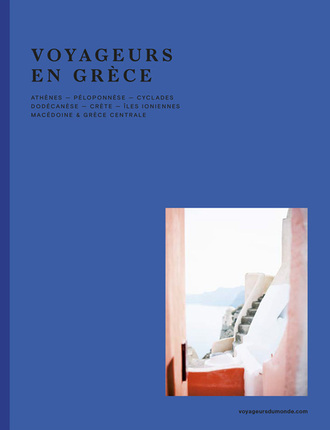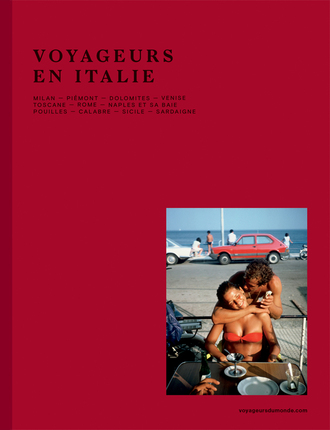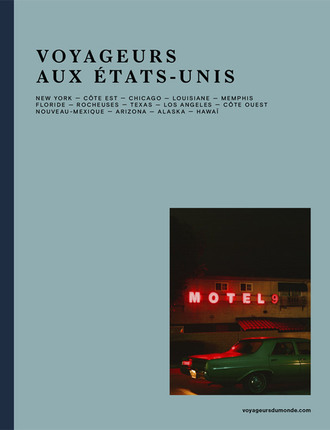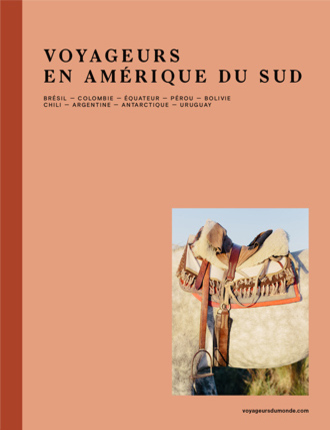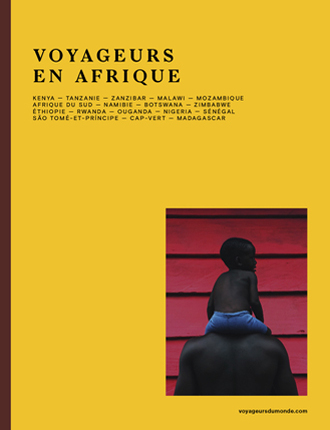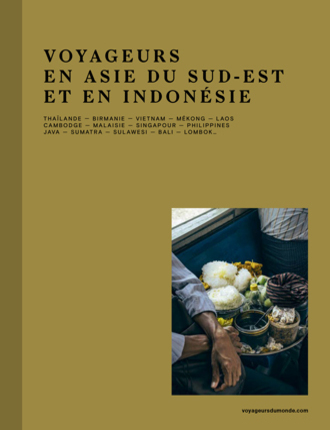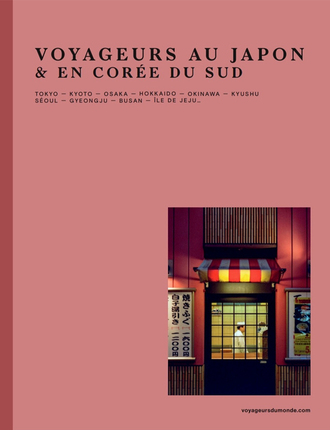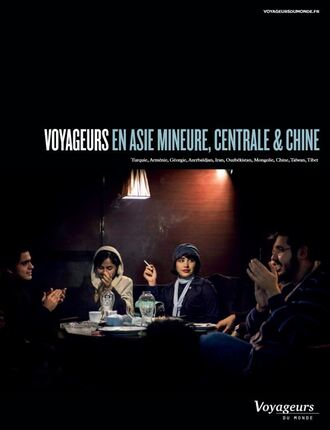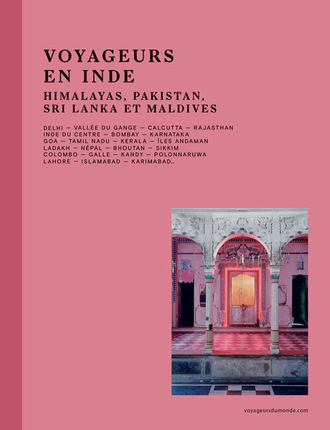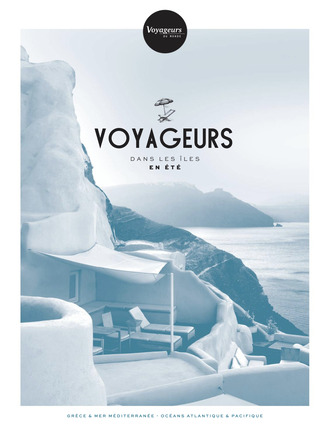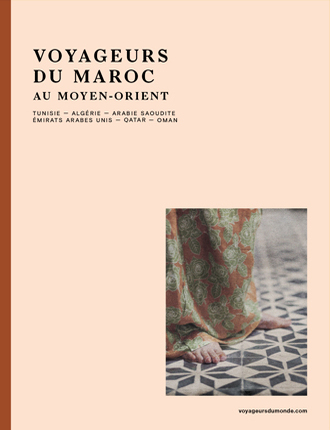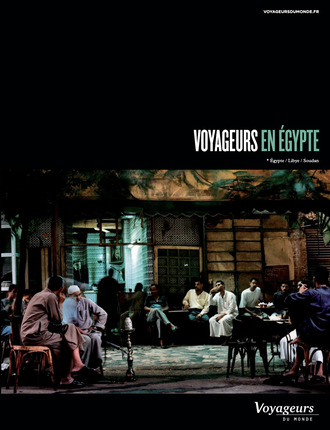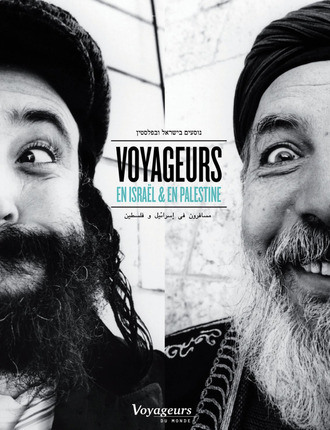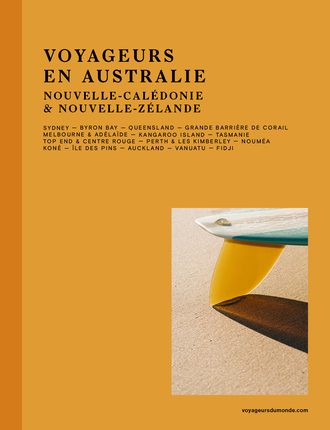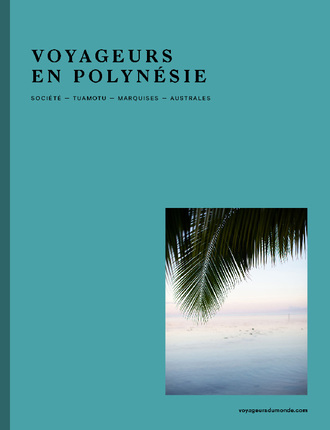Population
Langue officielle
Langues parlées
Peuples
Religions
Fête nationale
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
6 janvier : Épiphanie.
28 février : jour de l’Andalousie (uniquement en Andalousie).
1er mars : jour des Baléares (uniquement aux Baléares).
19 mars : San José, fête des pères.
Mars ou avril : Pâques.
23 avril : jour de Castille et Léon (uniquement en Castille et Léon) ; Saint Georges (Aragon, Catalogne, Baléares).
Mai : Pentecôte.
1er mai : fête du travail.
2 mai : jour de la communauté de Madrid (uniquement à Madrid).
15 mai : Saint Isidore (communauté de Madrid).
17 mai : jour des Lettres galiciennes (uniquement en Galice).
30 mai : jour des Canaries (uniquement aux Canaries).
25 juillet : Saint Jacques, jour de la Galice (uniquement en Galice).
15 août : Assomption.
8 septembre : jour des Asturies et de l’Estrémadure (uniquement dans les Asturies et en Estrémadure).
11 septembre : jour de la Catalogne (uniquement en Catalogne).
9 octobre : jour de la communauté de Valence (uniquement dans cette communauté).
12 octobre : fête nationale.
25 octobre : jour du Pays basque (uniquement au Pays basque).
1er novembre : Toussaint.
3 décembre : jour de Navarre (uniquement en Navarre).
6 décembre : jour de la Constitution.
8 décembre : Immaculée Conception.
25 décembre : Noël.
Politique
L’Espagne est une monarchie parlementaire constitutionnelle. Aux termes de la constitution de 1978, le roi est le chef de l’État et de chacune des 17 communautés autonomes. Ainsi au niveau des communautés ses prérogatives peuvent-elles varier. L’Espagne n’est ni un État unitaire, ni un État fédéral. L’État espagnol reconnait dans la personne du roi son plus haut représentant dans les affaires internationales et le chef de ses armées. Le pouvoir exécutif est assumé par le gouvernement sous la direction du président du gouvernement, nommé par le roi sur proposition du Congrès des députés. Le pouvoir législatif est détenu par un parlement bicaméral, les Cortes Generales, composé du Congrès des députés et du Sénat. Le premier est à 350 députés, élus pour 4 ans à la proportionnelle ; le second, à 266 sénateurs, élus pour 4 ans soit par les provinces, soit par les communautés autonomes. Le Sénat peut opposer son veto à une proposition de loi approuvée par le Congrès. Le pouvoir judiciaire est indépendant de l’exécutif et du législatif. Et il n’est pas divisé : tous les tribunaux sont compétents pour les normes de l’État espagnol et pour celles des autonomies. Un Tribunal constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois. Chacune des communautés autonomes dispose de son parlement, élu au suffrage universel, et de son gouvernement. Elle jouit donc d’une réelle autonomie législative et politique. Néanmoins, ces communautés ne sont pas des États fédérés, mais des collectivités décentralisées.
Histoire
Lorsqu’ils débarquent, au IIIe siècle avant J.-C., les Romains trouvent la péninsule peuplée de Celtibères. Les Phéniciens et les Grecs ont fondé des comptoirs. Les Carthaginois exploitent des mines et défient Rome. Ils sont battus. Il faudra 200 ans pour mettre tout cela au pas, mais l’Hispanie sera deux provinces romaines (Hispanie Citerior et Hispanie Ulterior) sous la République, puis trois sous Auguste, l’Ulterior étant scindée en Bétique et Lusitanie. Parallèlement, l’Hispanie citérieure s’étend jusqu’à couvrir, sous le nom de Tarraconaise, tout le nord, de la Catalogne à la Galice. La Pax romana finit par régner, garantie par les légionnaires, les voies, le développement urbain et l’essor économique. La future Andalousie fournissant même des empereurs, comme Trajan ou Hadrien. La tradition des 7 apôtres de l’Espagne, disciples de saint Jacques le Majeur et envoyés des saints Pierre et Paul, inscrit dans une filiation apostolique et romaine le christianisme péninsulaire.
Tandis que Rome agonise, les Wisigoths (entre autres Barbares) bâtissent un château en Espagne, Ve-VIIe siècles. Ils gèrent bien les affaires et font leur pelote. D’abord adeptes de l’arianisme, ils passent au catholicisme sous Récarède 1er, fin du VIe siècle. Cependant, au Maroc, l’expansion musulmane vient buter sur l’Atlantique. Il faut réorienter les énergies. En 711, Tariq ibn Ziyad, donnant au passage son nom à Gibraltar (Jabal Tariq), vient en Europe à la tête d’une armée berbère. Sept ans plus tard, ils sont à Barcelone. Et les musulmans en Espagne pour sept siècles. Al Andalus sera l’un des pôles d’une civilisation brillante. Les traces s’en trouvent partout. Les échanges entre intellectuels musulmans, juifs et chrétiens sont féconds. La fiscalité religieuse sait raison garder. L’hydraulique arabe est adoptée (certains réseaux d’irrigation fonctionnent encore). L’architecture s’adapte. Pour autant, on ne peut, de façon anachronique, tenir cette société pour égalitaire et tolérante ; elle était avant tout réaliste eu égard à sa démographie. La Galice et les Asturies ont résisté à la poussée omeyyade – bataille de Covadonga, 722. Charlemagne essaie quelques piques. Il y perd Roland, au col de Roncevaux. Vraisemblablement contre des montagnards basques. L’empereur à la barbe fleurie constitue néanmoins, à l’est, la marche d’Espagne, autour de Gérone et Barcelone. La Reconquista balbutie. Les seigneurs du nord mènent des opérations de brigandage patriotique. À la bataille de Clavijo, en 844, saint Jacques (Santiago Matamoros, « tueur de Maures ») intervient miraculeusement au côté des chrétiens. Il est consacré patron de l’Espagne potentielle séance tenante ; on découvre son tombeau à Compostelle dans la foulée. Les idées sont en place, le front est constitué, une communauté postulée. Le pèlerinage de Saint Jacques est lancé, randonnée pédestre, judiciaire et politique qui intéresse la chrétienté aux affaires de la péninsule. La Reconquête peut véritablement commencer.
Les royaumes catholiques grignotent les positions musulmanes dans la vallée de l’Ebre. Le pape proclame la croisade. En 1212, le roi de Navarre remporte la bataille de Las Navas de Tolosa (dans la province de Jaèn). Al Andalus est réduite à l’Andalousie. Castille, Navarre et Aragon se partagent le reste. En 1492, Grenade tombe. La Reconquista est accomplie. Il faut, c’est entendu, prendre beaucoup de recul pour proposer un schéma aussi simple. Le phénomène est long et complexe. Et ne pas oublier que les uns et les autres étaient engagés par ailleurs dans des configurations locales et des complications internationales ; dans des alliances opportunistes que justifiaient des conflits annexes ; dans les phases aigües et déprimées, les en avant, marche et les halte-là de l’histoire.
Quoi qu’il en soit, une nouvelle ère commence. En 1469, Isabelle de Castille a épousé Ferdinand II d’Aragon. Chacun restant roi chez soi. L’inquisition est mise en place. Les juifs en 1492 et les Maures en 1502 sont expulsés, à moins qu’ils ne se convertissent. Les musulmans convertis, les Morisques, le seront à leur tour entre 1609 et 1614. Le crypto-judaïsme marrane est pourchassé jusqu’au fond des Indes occidentales par les inquisiteurs. En 1516, Charles Quint (de Habsbourg), petit-fils de Ferdinand et Isabelle par leur fille Juana la Loca, devient roi des Espagnes, sous le nom de Charles 1er. Il annexe la Navarre à ses possessions. Philippe II, qui a au passage de témoin récupéré les Pays-Bas, poursuit sans nuances la politique de son père. L’exploitation de l’Amérique, découverte par Christophe Colomb en 1492, est engagée ; l’or, l’argent, les épices sont débarqués des galions. La Castille produit de la laine, que transforment les Flandres espagnoles. Les tercios semblent invincibles. La Réforme s’affirme-t-elle ? L’Espagne devient une citadelle catholique. Elle détruit la flotte turque à Lépante, 1571. Le commerce, l’esprit (réforme du Carmel, fondation et essor de la Compagnie de Jésus, néothomisme de l’école de Salamanque), les arts (Cervantes, Quevedo, Tirso de Molina, Gracian, Greco, Vélasquez, Ribera, etc.), tout fleurit. Mais la France prend ombrage de cette puissance ; elle n’aura de cesse qu’elle soit rabaissée. Mais la Grande y Felicisima Armada fait naufrage au large de l’Irlande. Mais les Pays-Bas ont entamé un long combat pour l’indépendance, qui aboutira en 1648. Mais trop d’excès nuisent à une saine gestion. Les fleurs fanent. Le Portugal – réuni en 1581 – se détache en 1640. À l’aube du XVIIIe siècle, Charles II meurt sans héritier. Exit les Habsbourg. La Guerre de succession d’Espagne met un Bourbon sur le trône. Le pays voit son influence se réduire comme peau de chagrin. La France et l’Angleterre imposent leurs différends. L’Espagne est à la remorque. Quelques tentatives de réforme échouent à redresser la situation. L’outremer paie les échecs continentaux.
Les Lumières brillent faiblement en Espagne. La monarchie catholique se délite au point que Charles IV en appelle à la France de Napoléon 1er. Plutôt que choisir entre les prétendants, l’empereur simplifie : il installe son frère Joseph à la tête du pays, 1808. L’aristocratie s’incline, le peuple se soulève. La guerre sera féroce. En 1813, les paysans et l’armée anglaise chassent les Français. Ferdinand VII, le fils rebelle de Charles IV, receint la couronne et fait le ménage. Rudement. Sans héritier mâle, la loi salique (qui écarte les femmes du trône) le gêne. Il l’abolit. Ce qui n’est pas du goût de son frère Carlos qui, à sa mort, en 1833, lève des troupes. Première guerre carliste et coup d’envoi d’un siècle de troubles, de révoltes, de chaises musicales au gouvernement. On verra une éphémère République en 1873-74. Entre temps, en Amérique, les colonies obtiennent leur indépendance les unes après les autres. L’inquisition est abolie en 1834. L’Espagne manque le train de la révolution industrielle. L’hispanophilie romantique la montre pour ce qu’elle est : pittoresque et pauvre. Sur place, un Nord plutôt libéral (ce que le pays compte d’industries est là) s’oppose à un sud agricole et conservateur.
En 1902, Alphonse XIII monte sur le trône. L’Espagne est neutre pendant la 1ère Guerre mondiale. Elle est tout de même secouée par la grippe espagnole, les trois années bolchéviques et la guerre du Rif. En 1923, à l’issue d’un coup d’État, Miguel Primo de Rivera (1870-1930) institue une dictature à visée sociale. Il est contraint de se retirer sept ans plus tard. En 1931, les élections donnent le pouvoir à une coalition antimonarchiste. Alphonse XIII se retire. La 2e République est proclamée et entreprend de moderniser le pays. Les élections de 1936 sont favorables au Frente popular, de gauche. Mais les institutions demeurent fragiles et mal armées face à la violence politique. Avec d’autres généraux, Francisco Franco (1892-1975) fomente un soulèvement militaire, qui rallie quelques régions. La guerre est engagée contre la République. Elle sera impitoyable, prototype de la guerre européenne à venir. En 1939, les Républicains sont vaincus. Ils fuient la répression par dizaines de milliers. Suivent 36 ans de dictature. Le pays reste à l’écart de la 2nde Guerre mondiale. Il reste aussi à l’écart de la reconstruction politique et économique qui la suit ; même si le régime, dans le contexte de la Guerre froide, gagne le camp occidental. Petit à petit, le régime s’empoussière. ETA (Euskadi ta Askatasuna, Pays basque et liberté) prend les armes. Au début des années 70, une partie de l’Église passe à l’opposition. En 1974, Franco, qui a rebooté la royauté en la personne de Juan Carlos de Bourbon (né en 1938), remet à celui-ci ses pouvoirs. Et meurt. Le nouveau monarque ouvre les fenêtres : les langues minoritaires sont officialisées, les Autonomies installées, les mœurs libéralisées. De nouvelles institutions sont mises en place, que le roi défend avec vigueur lors d’une tentative de coup d’Etat militaire en 1981. À cette occasion, Juan Carlos gagne ses peuples. Le pays rejoint le concert des nations. Il intègre la CEE en 1986. L’économie fait un bond. L’Espagne compte à nouveau.
Personnalités
Maria Zambrano, 1904-1991. Antonio Machado fréquentait la maison familiale, elle eut Federico Garcia Lorca comme camarade et José Ortega y Gasset comme professeur. De quoi former bien à la discipline intellectuelle et à la sensibilité poétique. Elle devait d’ailleurs promouvoir l’idée de raison poétique.
Averroès, Abdu’l-Walid Muhammad ibn Rouchd, 1126-1198, médecin et philosophe cordouan, commentateur d’Aristote. Son œuvre, l’une des plus belles illustrations de ce que l’Espagne musulmane a apporté à la culture européenne, sera transmise aux scolastiques latins par des traducteurs juifs.
Thérèse d’Avila, 1515-1582. La carmélite Teresa de Jesus fut une personnalité puissante, à la fois mystique, réformatrice, femme d’action et de raison. Elle a marqué profondément son ordre, son pays et l’Église catholique. Dont elle a été déclarée docteur en 1970.
Ignace de Loyola, 1491-1556. Basque, militaire converti et fondateur de la Compagnie de Jésus. Avec d’autres, parmi lesquels son compagnon navarrais François Xavier, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, il a donné son cachet religieux au Siècle d’or (et à la Contre-Réforme).
Olga Carmona, née en 2000. Si l’Espagne a emporté la coupe du monde de football féminin 2023, c’est à Olga Carmona qu’elle le doit. L’ailière gauche du Real de Madrid, capitaine de l’équipe nationale pour la finale contre l’Angleterre, ayant marqué à la 29e minute le but victorieux.
Manuel Benitez Pérez, El Cordobés, né en 1936, ne fut certes pas un torero classique et certains répugnaient à son style quelque peu baroque. Pourtant, l’hérésie parfois touche au cœur du grand art. L’Espagne sait admirer ces choses-là.
Ana Amaya Molina, dite Aniya la Gitana, 1855-1933. Admirée par ses pairs, par la reine Victoire-Eugénie, par Garcia Lorca, mais adulée par sa communauté gitane de Ronda, elle fut une grande voix du flamenco. Sans édulcoration, des cafés de sa jeunesse à l’Exposition internationale de Barcelone en 1930.
Julio Iglesias, né en 1943. Est-il l’Espagnol universel ? Il a incarné, en tout cas, un certain tact dans le mauvais goût, une certaine délicatesse dans la muflerie, une certaine tenue dans la savonnette, qui en font le latin lover quintessentiel.
Dolores Ibarruri, 1895-1989. Le No pasaran ! de la guerre d’Espagne, c’est elle. La Pasionaria a été 1er secrétaire puis présidente du parti communiste espagnol de 1942 à 1989. Elle est morte avec l’Union soviétique, après avoir incarné la rectitude d’une fidélité politique marmoréenne.
Pedro Almodovar, né en 1951. Il a mis dans des films pétaradants et colorés la renaissance postfranquiste, de la Movida à un certain spleen européen. Et leur a donné des visages inoubliables. En digne fils de Luis Bunuel et de Salvador Dalí.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
Pour les chauffeurs, nous vous conseillons, au minimum, l’équivalent de 5 euros par jour et par personne. Le double pour les guides.
En ce qui concerne le personnel local - serveurs, porteurs, etc. - les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Cuisine
La cuisine espagnole est l’une des plus savoureuses qui soient. Les cuisiniers dignes de ce nom sont intraitables sur la qualité des ingrédients. Poissons et fruits de mer sont ubiquitaires. Légumes et fruits, abondants et bon marché. L’élevage national fournit de belles viandes.
Des spécialités locales en veux-tu en voilà : tripes (callos) à Madrid ; merlu à la biscayenne au Pays basque ; paella valenciana ; fabada des Asturies, qui ressemble au cassoulet ; flamenquin, roulade de porc pannée, de la province de Cordoue ; etc. Et partout griller est un art.
On trouve dans de grands restaurants une cuisine nouvelle assez sophistiquée. Coup de génie ou repoussoir, la cuisine moléculaire de Ferran Adrià est emblématique de cette gastronomie pionnière.
Les restaurants ordinaires servent des plats du jour (cazuelas). Parmi les plus populaires sont les boulettes de viande hachée, le poulpe, le calamar frit. Les plats combinés (platos combinados) ont pour base standard les œufs, le jambon et les pommes de terre.
La paella est désormais mondialisée. À l’origine, c’est un plat de riz valencien, l’une des nombreuses recettes d’arroz espagnoles. Il y entre donc du riz rond, des haricots blancs secs de Lima, des haricots plats, tomate, lapin, safran, huile d’olive, sel, eau. À la rigueur, on ajoutera des artichauts ou des escargots. Le reste, qui peut s’avérer bon, là n’est pas la question, est hétérodoxe. Ou c’est un autre plat. Bien, mais lorsqu’un plat vous échappe, vous ne pouvez rien faire pour le rattraper.
Les charcuteries. À tout seigneur tout honneur, il faut commencer par le jambon. Il en existe des variétés nombreuses. Il pend un peu partout. Sec, bien entendu, mais on trouve aussi de magnifiques jambons cuits entiers. Trop vieux ou trop dur, on l’utilise pour parfumer la potée (cocido) ou le bouillon (caldo). Le chorizo est un classique plus modeste : saucisson de porc, parfumé et coloré au piment, plus ou moins épicé. Les variantes régionales sont multiples : celui de Pampelune est haché gros ; celui de Salamanque, fin. Le lomo est moins répandu. C’est un filet de porc, séché et légèrement fumé. Très populaire servi avec des œufs frits. La cecina de Leon est comparable à la viande des Grisons. La morcilla de Burgos ressemble à du boudin ; elle contient du riz, dosage délicat.
Le poisson et les fruits de mer. Ils sont une seconde religion et de nombreux transporteurs acheminent quotidiennement le poisson dans les villages les plus reculés. Les berberechos de Cantabrie sont des coques au naturel. On n’imagine pas un bar espagnol sans une assiette de berberechos (ou de navajas, les couteaux) posée sur le comptoir. Les chipirones de Gipuzkoa sont de petits calmars farcis et cuits à l’encre. Les Espagnols ont une grosse tendresse pour le poulpe. On le mange frit au piment ; avec un filet d’huile d’olive aillée ; froid, en salade ou en escabèche. Les moules sont préparées de toutes les façons possibles. On ne dispute pas aux Portugais le rôle de chevaliers servants de la morue, mais on ne se fait pas faute de lui rendre hommage. Néanmoins, l’anchois est le poisson-roi. Il arrive dans le golfe de Biscaye en avril, où il annonce les sardines et les thons. D’avril à août, il est frit, mais les prises sont si énormes qu’il faut en mettre une partie en conserve ; légèrement salé, on le garde une semaine ou deux (ces anchois salés sont appelés boquerones) ; à la saumure, il reprend son nom d’anchois et sert à tout parfumer, des viandes aux salades.
Les légumes et les fruits. Grande tradition maraîchère dans la vallée de l’Ebre, en Navarre et Rioja, ainsi que dans la région de Valence. Les cogollos de Tudela, les sucrines de Tudela, se mangent à la croque-au-sel, avec un filet d’huile d’olive et deux anchois. Les guindillas d’Andalousie sont de petits piments verts, plus ou moins piquants, mis au vinaigre. Les piquillos de Lodosa sont des poivrons doux que l’on peut farcir de morue. Les artichauts de Navarre sont tout petits. Les Navarrais les préfèrent sautés avec de fines lamelles de jambon. Les câpres d’Andalousie (caporones) sont assez rondelettes ; elles peuvent avoir la taille d’une olive. Il y a peu, c’était encore la nourriture de base des journaliers andalous, avec l’oignon blanc et l’ail. Les calçots sont une variété d’oignon blanc qu’en Catalogne on mange grillés à la braise avec une sauce tomate, piment, amande, ail, huile d’olive, vinaigre. Les calçotadas ont lieu entre janvier et mars. Les haricots grains entrent dans de nombreuses préparations.
Si le tout venant des tomates peut être le fruit de méthodes de production discutables, on trouve aussi de magnifiques variétés sorties de terre. L’Espagne est le premier producteur mondial d’olives. En Catalogne, mais surtout en Andalousie, les oliveraies s’étendent à perte de vue. Le voyageur qui traverse la province de Jaèn en voiture est surpris par l’entêtante odeur d’huile d’olive qui flotte partout. L’olive est consommée verte et, souvent, farcie d’un filet d’anchois ou d’un bout de piment. Les vergers fournissent aussi en abondance l’orange, la mandarine, citron, melcoton, abricot, tomate, amande.
Les fromages. Le manchego est le fromage de brebis traditionnel de la Manche (Cervantes en parle dans Don Quichotte). On le trouve partout en Espagne où il est devenu synonyme de fromage de brebis. L’idiazabal de Gipuzkoa est pourtant considéré comme le nec plus ultra. Tous les ans, en septembre, les bergers basques se retrouvent dans le petit village d’Ordizia pour la fête Euskal Jaiak, afin d’élire le meilleur fromage de l’année, qui est ensuite mis aux enchères. Jadis, les notables se battaient pour acquérir ce champion et en honorer leurs invités. Aujourd’hui, ce sont les supermarchés qui se le disputent. Le cabrales des Asturies est fait d’un mélange de laits de vache, de chèvre et de brebis. Il est persillé et puissant.
Les pâtisseries. L’influence arabe se fait sentir dans la double utilisation du miel et de l’amande. Là-dessus, les conquistadors ont apporté le chocolat, dont les Espagnols sont d’impénitents consommateurs. Les tartes de Santiago réconfortent les pèlerins depuis longtemps. Le touron renvoie au début du paragraphe.
Street food : considérons que la street food se mange plutôt debout, elle peut alors être nourriture au comptoir. Et, à ce titre, les tapas sont la street food n°1. Ces plats riquiquis sont innombrables, mais certains sont récurrents, comme les patatas bravas, le poulpe à la galicienne, le jamon, les anchois et les sardines, le chorizo au cidre, les croquettes de morue. Ces tapas, ou pintxos au Pays basque, ne sont pas seuls néanmoins à combler les petits creux. Le bocadillo de calamares, sandwich au calamar frit, est un classique plantureux. La tortilla aux pommes de terre tout autant. Ou le bikini sandwich, à Barcelone. Il est à noter que l’on prend beaucoup de choses en sandwich. Pour des raisons qui se comprennent aisément, les préparations latino-américaines sont très présentes. Empanadas (chaussons), quesadillas (galettes au fromage) notamment. Les grandes villes espagnoles, mondialisées comme les autres, vivent à l’heure des burgers. On y trouve enseignes internationales et officines locales. Tout cela manquant un peu de légumes, évoquons les sévillans espinacas con garbanzos, qui sont des épinards aux pois chiches et cumin. Les churros accompagnent principalement le chocolat.
Boissons
La bière est ordinaire à tous les sens du terme.
Dans les Asturies, au Pays basque, en Galice, on boit un cidre sec et désaltérant.
Horchata, qui a donné le français orgeat, est l’une des plus vieilles boissons espagnoles, inventée, ou introduite, par les Arabes dans la région de Valence. Elle est élaborée à partir du broyage des tubercules du souchet comestible, qui pousse dans les canaux d’irrigation des huertas. C’est un breuvage d’aspect laiteux que l’on boit dans toute l’Espagne méridionale.
Cependant, avant tout, l’Espagne est un pays viticole : sols propices, soleil généreux, tradition et main d’œuvre qualifiée ont permis le développement de nombreuses zones de production : Duero, Valdepenas, Rioja, Navarre, Andalousie, etc.
Quelques pistes.
L’albarino de Galice. Albarino, en vieil espagnol, c’est le vin blanc du Rhin, issu de cépages bourguignons que des moines clunisiens plantèrent autour de Santiago. Une histoire satisfaisante du point de vue de celle du monachisme, mais vraisemblablement fausse. L’albarino serait autochtone, autant qu’on peut l’être. Les vignes sont palissées, exposées aux embruns océaniques. La culture n’est pas mécanisée et l’on comprend pourquoi lorsqu’on considère la taille et la situation des parcelles. Le canyon du Sil, dont les pentes abruptes sont aménagées en terrasses, est l’un des plus beaux paysages d’Europe. Chaque terrasse est occupée par un seul rang de vigne.
Le txakoli de Gipuzkoa. Ce vin blanc peu répandu, vert et perlé, est une vraie relique. Il est vinifié à partir d’un vieux cépage indigène proche du manseng, dont on fait par exemple le jurançon.
Le rioja. On trouve plusieurs types de vin en Rioja. Les rouges de garde sont issus des cépages tempranillo et grenache noir pour l’essentiel. Les meilleurs d’entre eux rivalisent avec bien des bordeaux. Pas très étonnant : lors des guerres carlistes, de nombreux viticulteurs de Rioja ont émigré dans le tout proche Bordelais. Et en ont adopté et adapté techniques de culture et de vinification. La vigne est cultivée non palissée, en buissons, afin de la protéger de l’effet desséchant du vent.
Le fino d’Andalousie. Xérès, manzanilla, montilla-moriles, il existe de nombreuses expressions du fino, le vin blanc sec andalous. Le xérès est la plus connue. Il vieilli bien et les Anglais ont fait sa réputation sous le nom de sherry.
On trouve, en général, trois types de vin : les primeurs (jovenes), les vins élevés (crianzas), résultant d’un mélange soigneusement conduit et avec un peu de garde, et les reservas ou gran reservas, avec une garde plus longue.
Les vermouths sont indissociables des bars espagnols. Il en existe des dizaines, cuits et aromatisés. Chaque producteur affirme hautement que sa recette est la meilleure, la plus ancienne, celle qui a le plus de vertus thérapeutiques. Le vermouth se boit al grifo, au robinet, coupé d’eau gazeuse, légèrement mousseux et très frais. La saveur dépend donc du producteur, de l’eau choisie par le bistro et du réglage de la pompe qui opère le mélange eau vin.
Enfin, car on ne boit pas que du vin, si vous ne précisez pas café solo, on vous servira d’autorité un café au lait.