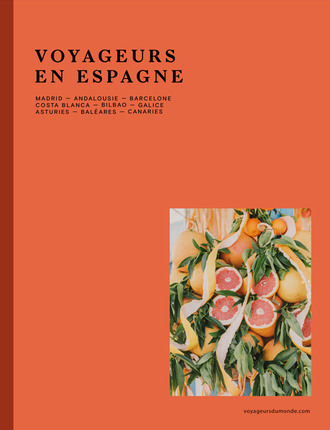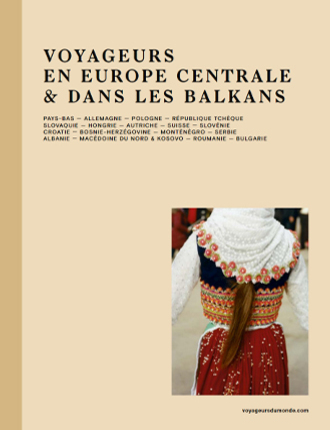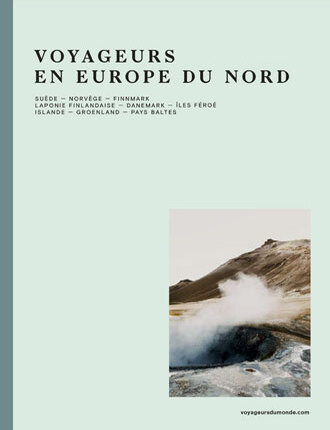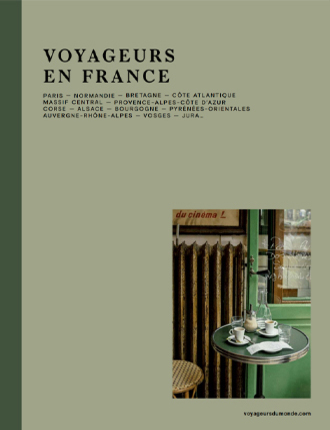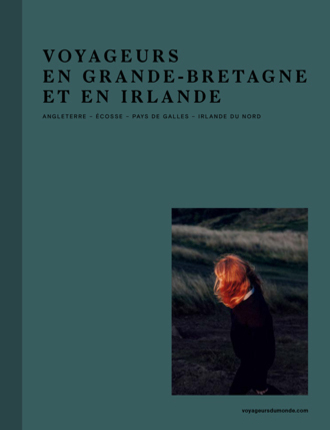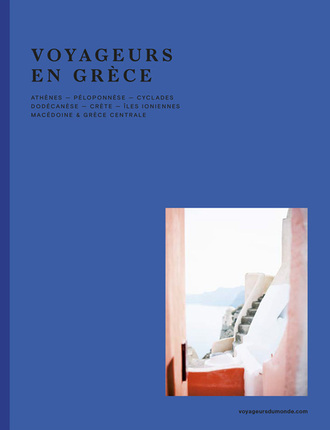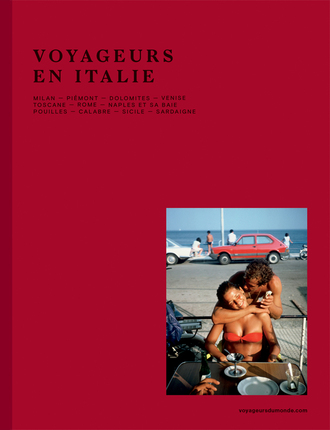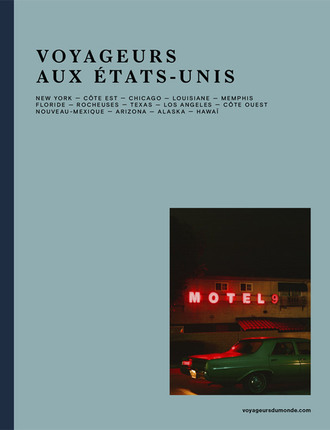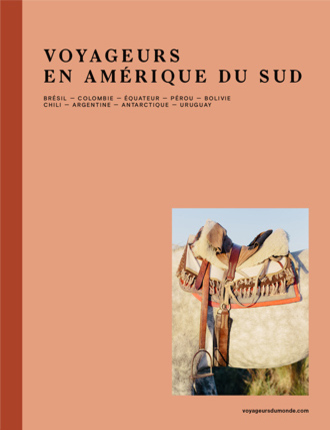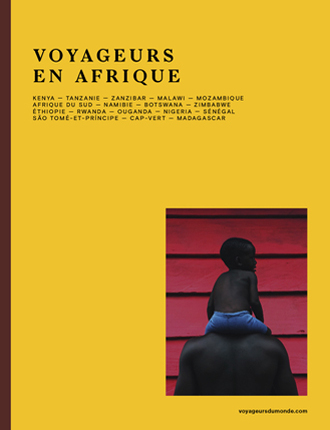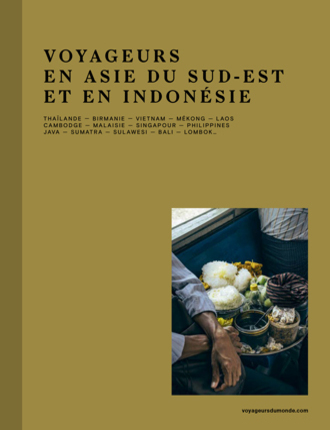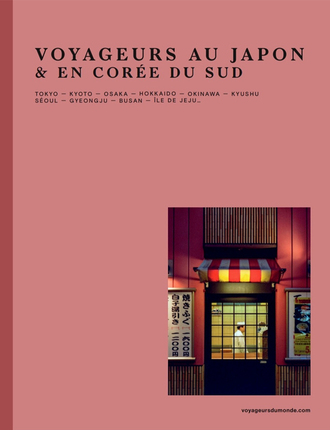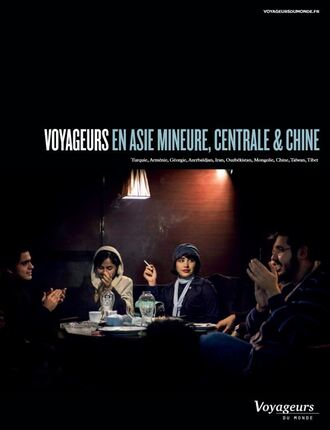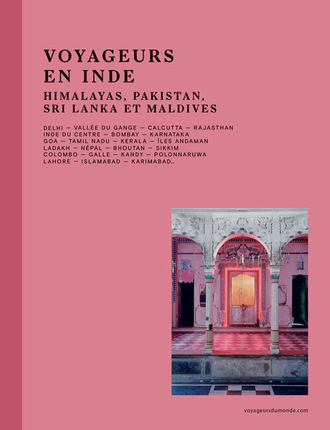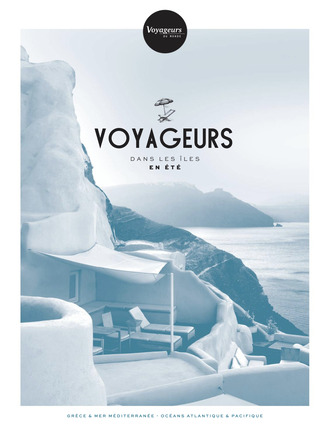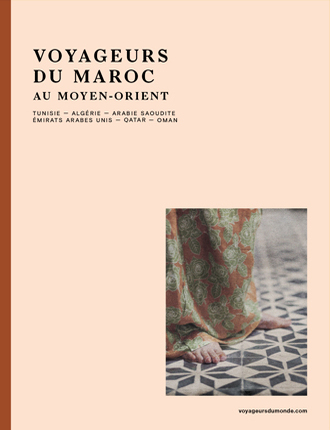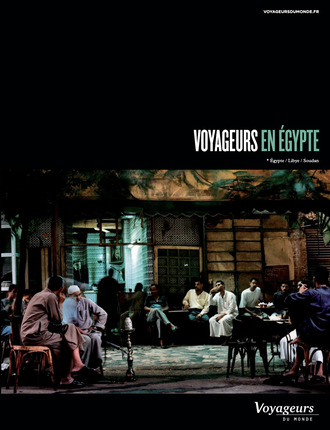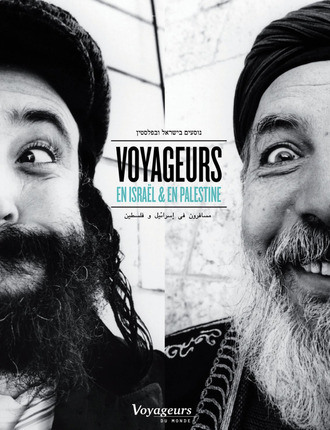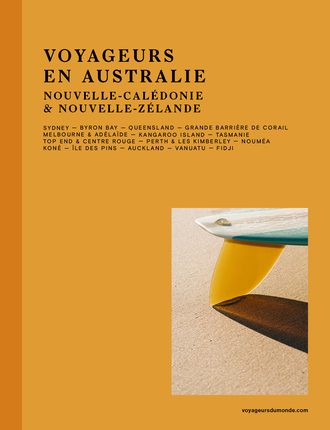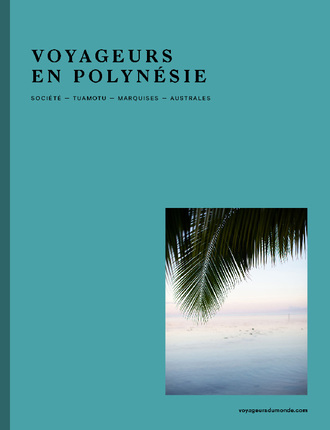Population
36 620 970, en 2024.
Langue officielle
Le polonais.
Langues parlées
97% des Polonais ont le polonais – langue slave occidentale, écrite avec l’alphabet latin – pour langue maternelle. Un niveau remarquablement élevé. En ce qui concerne les idiomes des minorités nationales ou ethniques, dont le droit d’usage est garanti, la notion de langue auxiliaire est mise en avant. Ces langues auxiliaires acquièrent un statut administratif dès lors qu’au moins 20% des habitants déclarés d’une commune appartiennent à une même minorité. Le cachoube, vieille langue slave poméranienne, est l’objet d’une valorisation patrimoniale. Parmi les langues étrangères que pratiquent les Polonais, l’anglais tient la première place, mais le niveau des échanges a boosté la germanophonie. Par contre, la pratique du français s’effondre.
Peuples
La population polonaise a atteint une espèce de pic d’homogénéité. L’histoire du XXe siècle s’étant chargée de simplifier la question. La Pologne reconnaît néanmoins des minorités nationales (Allemands, Biélorusses, Tchèques, Lituaniens, Arméniens, Russes, Slovaques, Ukrainiens et Juifs) et des minorités ethniques : Karaïtes (adeptes d’un judaïsme scripturaire non rabbinique), Lemkos de Ruthénie, Roms et Tatars. Dans la Pologne postsocialiste, l’immigration est abordée comme un phénomène nouveau. Ses origines sont essentiellement économiques. Ukrainiens et Vietnamiens constituent les deux plus importantes communautés immigrantes.
Religions
Le catholicisme est intégré à l’identité polonaise. À tel point qu’on peut se demander s’il en est le mortier ou si elle est son garant. En tout cas, la Pologne est un pays catholique. Sans que cela signifie d’ailleurs que le catholicisme soit la religion de l’État, ni que tous les Polonais se reconnaissent en lui. L’Église a un poids (religieux, social, politique) dans la société. Bien entendu, on n’en est plus à l’unanimisme conquérant des années 1980 et 90, mais il faut constater que la libéralisation n’a qu’écorné encore son influence. La Czarna Madona, la Vierge noire, de Czestochowa est un symbole national fort.
Fêtes nationales
3 mai et 11 novembre : jour de la Constitution de 1791 et Indépendance de 1918.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
6 janvier : Épiphanie.
Mars ou avril : Pâques (dimanche et lundi).
1er mai : fête du travail.
3 mai : jour de la Constitution.
Mai ou juin : Pentecôte ; Fête-Dieu.
15 août : Assomption.
1er novembre : Toussaint.
11 novembre : fête de l’Indépendance.
25 et 26 décembre : Noël.
Politique
La vie institutionnelle de la République de Pologne est réglée par la constitution de 1997. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il nomme le président du conseil (majorité parlementaire) et les différents ministres, sur proposition de celui-ci. Il détient un droit de véto, que la Diète peut lever, à une majorité qualifiée des trois cinquièmes. Il est chef des armées. Le président du conseil dirige l’exécutif, il met en œuvre la politique nationale et représente la Pologne à l’étranger. Il est responsable devant le parlement. Le pouvoir législatif est détenu par un parlement bicaméral. Une chambre basse, la Diète, Sejm, à 460 députés élus pour quatre ans. Une chambre haute, le Sénat, Senat, à 100 sénateurs élus pour un mandat de durée identique. La Diète détient seule la possibilité d’un vote de confiance ou de défiance envers le gouvernement. Un Trybunal Konstytucyjny veille à la constitutionnalité des lois. Quant au Conseil national de la magistrature voulu par la constitution, il a pour fonction de défendre l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Histoire
Au Ve siècle, les Polanes, une tribu slave occidentale, sont installés dans l’actuelle région de Poznan, entre l’Oder et la Vistule. Ils donneront leur nom à la Pologne. Au Xe siècle commence le temps des Piast. L’un d’entre eux, le duc Mieszko 1er, adopte le christianisme en 966. Son fils, Boleslaw 1er le Vaillant, fonde l’archevêché de Gniezno : Poznan, Cracovie, Wroclaw et Kolobrzeg. Boleslaw est sacré roi de Pologne le 18 avril 1025. Good to be the King, mais pas pour longtemps : il meurt le 17 juin suivant. Suit une longue période de conflits, qui voit le royaume morcelé. Les principautés silésiennes notamment reconnaissent la suzeraineté du roi de Bohême. En 1241, les Mongols mettent Cracovie (capitale depuis le XIe siècle) à feu et à sang. Joies de la féodalité. En 1226, le duc Konrad de Mazowie, ennemi acharné et nord-oriental des Piast, avait fait appel aux chevaliers Teutoniques pour contrer les Borusses, qui menaçaient ses arrières. Les chevaliers occupèrent le territoire de Chelmno, soumirent et baptisèrent les Borusses et fondèrent l’État des chevaliers Teutoniques de Prusse. Ayant occupé Dantzig (Gdansk) en 1308, ils furent au contact direct des Polonais.
Ce sont Wladyslaw 1er Lokjetek et, surtout, Kazimierz Wielki – Casimir III le Grand, 1333-1370 – qui rétablissent les fondements et l’unité de l’État polonais, élargi jusqu’à Lwow (Lviv) par Casimir. Celui-ci accueillit les juifs, auxquels il accorda de nombreux privilèges. En 1364 fut fondée l’université de Cracovie. La dynastie des Piast s’éteint sur un allegro ma non troppo. Louis 1er de Hongrie ceint alors la couronne. Pas un souvenir impérissable mais, ensuite, Jadwiga – Edwige d’Anjou, 1384-1399 – qui succède à son père, sera immensément populaire (et canonisée par Jean-Paul II en 1997). En 1386, elle convole avec le grand prince Jagellon de Lituanie, qui accède à la haute marche du podium sous le nom de Ladislas II. Les époux royaux gouvernent ensemble. Phase dynamique et brillante. Les Teutoniques font les frais de l’alliance entre Pologne et Lituanie ; en 1410, ils sont écrasés à la bataille de Grunwald-Tannenberg. Ils conservent une organisation militaire en trompe-l’œil, mais l’hégémonie polono-lituanienne dans la région est installée pour deux cent cinquante ans. Entre 1506 et 1572 – sous Sigismond 1er le Vieux et Sigismond II Auguste – la Pologne connaît un fort rayonnement. En 1569, l’union polono-lituanienne est définitivement scellée, donnant naissance au plus vaste État d’Europe : la République des deux Nations, Rzeczpospolita Obojga Narodow, s’étend jusqu’à Smolensk à l’est et passé Riga au nord. Varsovie en devient la capitale en 1596. Gdansk est le pivot d’un puissant essor économique. L’humanisme trouve un climat propice sur les terres des Jagellon. Si le catholicisme est majoritaire, la liberté religieuse est très large sous Sigismond II. Pourtant, le parlement nobiliaire sape l’autorité royale. La szlachta, la noblesse, qui confisque le corps politique du royaume, transforme sa capacité nominale d’élire le roi en instrument de pouvoir. En 1573, Henri de Valois, le futur Henri III de France, est le premier souverain sous tutelle. Un souverain d’ailleurs éclair.
Au XVIIe siècle, sous la pression, l’Église est moins encline à transiger. Les tensions religieuses se compliquent de troubles politiques. Néanmoins, les premières décennies du siècle sont à l’avantage d’une Union (certes batailleuse et expansive) qui parvient à éviter les horreurs de la guerre de Trente ans. La suite n’est pas aussi favorable : guerre contre la Russie de 1654 à 1667 ; occupation suédoise de 1655 à 1660 ; ralliement des Ukrainiens à Moscou en 1667 ; etc. En ces temps difficiles, le roi Jean II Casimir Vasa appelle sur le pays la protection de la Vierge, qui devient Notre-Dame, Reine de Pologne. En se retirant, les Suédois laissent le pays en partie ruiné. Les succès de Jean III Sobieski contre les Ottomans – en 1683 devant Vienne notamment – cachent mal l’état de délabrement du royaume et les lacunes de son action extérieure. Le liberum veto, blocage des débats à la Diète par une abstention seulement, provoque l’effondrement de l’État. Les libertés nobiliaires ont eu raison de lui. Lors des règnes des rois saxons – Auguste II le Fort, 1697-1733 et Auguste III, 1733-1763 – la Pologne est sous tutelle russe. À tel point qu’en 1764 la tsarine Catherine impose son candidat, Stanislaw August Poniatowski. Les ambitions de réforme ne font pas le poids : le pays est débité au gré des intérêts de la Prusse et de la Russie. Celle-ci annexe une bande orientale et abandonne la Galicie à l’Autriche. La Prusse fait main basse sur une portion de l’ouest. C’est le 1er partage de la Pologne, 1772. Il n’y a pas à se priver. Dans ce qui reste, on s’avise, mais un peu tard, de réformer le système. La Grande Diète de 1788-1792 adopte une Constitution, dite du 3 mai 1791. Courageux, indispensable mais casus belli pour Saint Pétersbourg et Berlin, qui apprécient peu ces relents de Révolution française à leurs portes. On réunit des armées. Et on dépiaute encore un peu : 2e partage, 1793. Cela ennuie les Polonais. Le général Kosciuszko – un ancien de la Révolution américaine, décidément ! – mène la révolte. En vain. Et 3e partage, 1795. Russie, Prusse et Autriche ramassent les restes. L’Union polono-lituanienne a vécu. La Pologne s’est évaporée.
En 1807, Napoléon la ressuscite un peu. C’est le Grand-Duché de Varsovie, pris à la Prusse. Les Polonais sont à l’honneur dans la Grande Armée. Les choses durent ce que dure un empire. Le Congrès de Vienne procède à un 4e partage et place une Pologne du Congrès sous suzeraineté russe. Après l’insurrection de 1830-31, qu’ils répriment brutalement, les Russes tentent d’éradiquer la culture polonaise. C’est l’époque de l’émigration des élites. Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Fryderyk Chopin font les beaux soirs des salons parisiens. Mickiewicz côtoie Jules Michelet au Collège de France. Cracovie, qui jouissait d’un statut d’autonomie, est annexée à l’Autriche après la révolte de 1846. La convulsion de 1863 peuple la Sibérie de Polonais. Dans Le général Dourakine, la comtesse de Ségur a laissé quelques paragraphes ambigus sur ces pauvres Polonais catholiques. La noblesse dispersée par le knout, la bourgeoisie prône une attitude politique pragmatique, en attendant. L’Église entretient les fidélités. La double monarchie austro-hongroise ménage quelques libertés à Cracovie et à la Galicie.
La 1ère Guerre mondiale, la Révolution russe, le démantèlement de l’Autriche-Hongrie ouvrent un nouvel espace à la Pologne. Le président américain Woodrow Wilson favorise la création d’un État polonais indépendant (7 novembre 1918) dans le cadre de la réorganisation de l’Europe. L’installation dans ses meubles de cette seconde république ne va pas sans mal : conflits armés avec l’Ukraine, l’URSS, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne. Le pays trouve un accès à la mer dans la région de Dantzig, ville libre. Le régime politique est un parlementarisme flottant, corrigé – sévèrement – par la personnalité du maréchal Pilsudski, qui instaure à partir de 1926 une espèce inédite de dictature morale. Sa mort en 1935 laisse la nation désemparée et à la merci de l’Allemagne hitlérienne. Ces difficultés n’empêchent pas l’intelligence polonaise de participer brillamment aux mouvements de l’avant-garde culturelle européenne : W. Gombrowicz, S.I. Witkiewicz, B. Schulz, K. Szymanowski, Jan Lukasiewicz, Alfred Tarski, etc.
Cependant, le pays est plus que jamais dans la tenaille : une clause secrète du Pacte germano-soviétique d’août 1939 prévoit le coutumier partage de la Pologne, entre de IIIe Reich et l’Union Soviétique cette fois. Le 1er septembre de cette année-là, l’armée allemande déclenche en Pologne la 2nde Guerre mondiale ; Staline envahit séance tenante l’est du pays. Début octobre, les forces polonaises sont balayées. Le Generalgouvernement Polen mis en place a pour fonction de réduire le pays à un vivier de travailleurs corvéables. Certaines régions sont brutalement germanisées. Les activités de la Résistance sont réprimées avec une impitoyable rigueur. Le territoire polonais sera le théâtre principal de la destruction des Juifs européens (ghetto de Varsovie, Auschwitz, Treblinka, entre autres). En zone soviétique, jusqu’en 1941, le sort n’est pas meilleur, que symbolise le massacre de quelque 4 000 officiers polonais à Katyn. Les Allemands tireront de ces charniers d’importants effets de propagande. Le 1er août 1944, Varsovie se soulève contre l’occupant ; l’arme au pied sur la rive orientale de la Vistule, l’Armée rouge attend que la Wehrmacht ait écrasé l’insurrection pour intervenir. La ville est rasée. À la fin de la guerre, la Pologne glisse vers l’ouest, jusqu’à la ligne Oder-Neisse ; elle est amputée d’une partie de ses territoires orientaux par l’URSS. La disparition de la Prusse orientale lui rend une façade maritime. Les conférences de Yalta et Potsdam en avaient ainsi disposé. Cela entraine le déplacement de neuf millions d’Allemands, dans des conditions qui ne font honneur à personne. Les soviétiques préparent l’intégration du pays à leur zone d’influence.
Manipulations, violence et avenir radieux du socialisme sont les ingrédients de l’après-guerre. La reconstruction fournit le cadre d’activité et le support idéologique dans un pays peu enclin au communisme. Avec les éléments disponibles, on crée en 1948 un Parti ouvrier unifié polonais, qui entreprend de collectiviser l’agriculture et d’ébranler l’Église catholique. La création du pacte de Varsovie (ou Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle des pays sous tutelle soviétique) – en réponse à celle de l’Otan : Organisation du traité de l’Atlantique nord – a lieu en 1955. L’année suivante (mort du secrétaire général Bierut, révoltes ouvrières), un assouplissement relatif du régime est amorcé. La collectivisation de l’agriculture est abandonnée, des aménagements sont consentis dans différents domaines. En revanche, la protestation étudiante de 68 (mars) donne un prétexte aux autorités pour s’attaquer aux intellectuels et, tous les prétextes sont bons, aux juifs. Nombreux départs. L’armée polonaise participe à l’invasion de la Tchécoslovaquie. Le parti communiste de l’époque n’aime pas beaucoup le printemps. Ensuite, il faut bien faire jouer la soupape de sécurité. E. Gierek, qui succède à W. Gomulka en 1970, met le pays sur la voie du développement avec des crédits occidentaux. Hélas, un démarrage réellement prometteur s’envase dans les méandres de la bureaucratie. Nouvelles grèves ouvrières en 1976, soutenues par les intellectuels du KOR (Comité de défense des ouvriers). L’économie patine sans repartir. Deux ans plus tard, l’élection d’un pape polonais – Karol Wojtyla / Jean-Paul II – change la donne de façon inattendue. Le mouvement ouvrier prend de l’ampleur et se donne un syndicat indépendant : Solidarnosc (Solidarité). Le gouvernement ne contrôle plus la situation. Il est contraint de signer les accords de Gdansk du 31 août 1981. Le 13 décembre suivant, la loi martiale est promulguée par le général Jaruzelski. Des chars polonais pour éviter les chars russes. De nombreux syndicalistes et opposants sont arrêtés. Solidarité entre dans la clandestinité. Ronald Reagan envoie des dollars. La police d’État tue le père Popieluszko. Le parti communiste songe sérieusement, mais un peu tard, à réformer l’économie. Gorbatchev donne de l’air et Jean-Paul II de l’Esprit-Saint. Tout cela aboutit à la table ronde d’avril 1989, qui réunit les représentants du PC, de Solidarité et de l’Église. On prépare des élections assez libres. Et Tadeusz Mazowiecki, né en 1927, arrive au pouvoir. Il est le premier dirigeant non communiste du bloc de l’Est. À l’automne, le bloc a vécu.
Le ministre des finances, L. Balcerowicz, impose au pays, en catatonie économique, un traitement de cheval : le passage au marché s’effectue sans gants ni états d’âme. La société est bousculée, mais les réussites ne parviennent pas à contrebalancer les effets sociaux éprouvants des réformes. En 1993, les communistes, dépoussiérés, reviennent aux manettes. S’ils ne remettent pas fondamentalement en cause le nouveau cours, ils changent de rythme et de ton. L’opportunisme et les vieux démons les usent en trois ans. En 1997, c’est le retour d’une coalition de centre droit. L’instabilité défait néanmoins la nouvelle majorité. En 2001, retour de la gauche. L’entrée dans l’Union Européenne, 2004, ouvre une nouvelle ère. De tensions. Les élections présidentielles de 2005 voient s’affronter les hérauts d’un clivage d’avenir, le libéral pro-européen Donald Tusk (Plateforme civique) et l’ultra-nationaliste Lech Kaczynski (Droit et justice). Ce dernier l’emporte. Les relations avec l’UE se tendent.
Personnalités
Kinga de Pologne, 1234-1293. Elle avait pour tante sainte Elisabeth de Hongrie, et pour grand-tante sainte Edwige de Silésie. La bienheureuse Yolande et sainte Marguerite de Hongrie étaient ses sœurs. Comment Kinga, épouse du roi Boleslas V le Chaste, eut-elle pu ne pas mourir elle aussi en odeur de sainteté ? Le catholicisme polonais est passé par ces archipels mystiques.
Stefan Wyczynski, 1901-1981. Le cardinal Wyczynski, primat de Pologne à partir de 1952, a incarné la résistance spirituelle du pays à un communisme dont Staline lui-même disait qu’il lui allait comme une selle à une vache. Sous bien des aspects, le « père » de Jean-Paul II.
Bronislaw Geremek, né Benjamin Lewertow, 1932-2008. Du ghetto de Varsovie au Parlement Européen, via le POUP, le PCF, le KOR, Solidarnosc, la prison, la Diète. Historien (Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, 1976), humaniste, homme politique : la mort de Geremek fut une perte pour la Pologne, mais aussi pour l’Europe.
Barbara Nowacka, née en 1975, aura été avec constance le poil à gratter de la politique polonaise. Elle préside le parti de gauche Inicjatywa Polska. En 2023, elle devient ministre de l’Éducation nationale du gouvernement Tusk III. Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes lui est remis en 2017, au titre de l’association féministe Ratujmy Kobiety.
Marie Curie, 1867-1934. Elle est née Maria Sklodowska à Varsovie. Y a-t-il des photographies de Marie Curie où on la voit sourire ? Mais ce n’est pas en s’amusant qu’on obtient deux prix Nobel : physique en 1903, avec son mari Pierre et Henri Becquerel, et chimie en 1911. Une scientifique d’exception, qui a trouvé en France les moyens de sa vocation. Et sans doute n’aimait-elle pas la photographie.
Aleksander Wolszczan, né en 1946, astronome, professeur à l’université d’État de Pennsylvanie, a découvert deux pulsars importants : PSR B1257+12 et PSR B1534+12. Un descendant de Copernic, né Mikolaj Kopernik, à Torun (ville hanséatique sur la Vistule), en 1473. Les Polonais ont encore la tête dans les étoiles.
Anita Wlodarczyk, née en 1985. Lorsque le basketteur Przemyslaw Zamojski a été nommé porte-drapeau de la délégation polonaise aux derniers JO de Paris, il a sans doute été flatté de partager cet honneur avec Anita Wlodarczyk. Laquelle a dominée quasi sans partage sa discipline de 2009 à 2021, lançant le marteau jusqu’à 82,98 mètres. Record du monde.
Wojciech Fangor, 1922-2015. C’est un inconnu connu. Artiste singulier dont le nom est associé à l’op art et au Color Field painting movement. Abstraction donc. Entre 1961 et 1999, il vit à l’étranger, aux USA en particulier, puis rentre en Pologne. Pour aborder son œuvre commodément, prendre la ligne de métro M2 à Varsovie. Il en a décoré sept stations.
Agnieszka Holland, née en 1948 à Varsovie, formée au cinéma à Prague, elle travaille d’abord avec Krzysztof Zanussi et Andrzej Wajda. Puis vole de ses propres ailes. En Pologne, en France, aux États-Unis et ailleurs. Réalisatrice, elle n’hésite pas à appuyer là où ça fait mal : L’Ombre de Staline, autour de la famine de 1932 en Ukraine, ou Green Border, sur la crise migratoire de 2021.
Nagra. En 1951, Stefan Kudelski – né à Varsovie en 1929 et mort à Cheseaux-sur-Lausanne en 2013 – crée un magnétophone à bande, le Nagra I. Depuis, ces appareils ont enregistré et restitué tous les bruits du monde pour la radio, le cinéma, la télévision, le disque, etc., justifiant une réputation de fiabilité technique exceptionnelle. L’une des machines du XXe siècle.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
Pour les chauffeurs, nous vous conseillons, au minimum, l’équivalent de 5 euros par jour et par personne. Le double pour les guides.
En ce qui concerne le personnel local - serveurs, porteurs, etc. - les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Dans les relations sociales, les Polonais apprécient un certain formalisme : on ne brise pas la glace en claquant des bises ni à coups de poing. La courtoisie à l’ancienne est toujours pratiquée.
Cuisine
Il est certes désagréable que vos voisins vous envahissent régulièrement. On peut néanmoins en tirer quelques avantages. Ainsi le fourneau polonais s’est-il assimilé des influences multiples. La cuisine est variée. Avec quelques traits distinctifs, comme par exemple l’utilisation de fruits comme légumes ou un art subtil de la fumaison. Elle a bien entendu aussi quelque chose de slave, qu’elle partage avec ses homologues tchèque, slovaque ou russe. La soupe est un élément de ce quelque chose. À commencer par barszcz czerwony, la soupe de betterave, ou krupnik, la soupe à l’orge, kapusniak, la soupe au chou fermenté et au cochon fumé, etc. Parmi les plats de résistance, retenons bigos, la « choucroute » polonaise, qui est, à plus proprement parler, un ragout au chou fermenté, additionné de viandes qui peuvent varier du porc au gibier, d’épices et de pruneaux. Le canard rôti aux pommes est un autre classique. Les golabki sont des feuilles de chou farcies à la polonaise. Quant aux pierogi, ce sont des ravioles, farcies en salé ou en sucré. On les trouve partout. C’est à la qualité de ses pierogi que l’on identifie le cordon bleu. Lorsqu’il se donne la peine de vous en préparer, c’est que vous êtes apprécié. Chaque famille étant en possession de la meilleure recette du monde. Bref, ils sont la pierre de touche de la cuisine polonaise. La mer Baltique procure encore du poisson, au moins aux régions littorales. Ailleurs, on mange volontiers le poisson d’eau douce que l’on tire des lacs. La carpe notamment. L’anguille se fume. Ne la manquez pas. La charcuterie se fume aussi. Les saucisses sont en grand nombre, spécialités régionales s’il en est. Parmi les fromages, golka est de lait de vache et a une forme de capsule, oscypek est de brebis et fusiforme. Le chou et les pommes de terre ont longtemps été la base alimentaire, auxquels il faut ajouter le gruau. Et les cornichons saumurés. Aujourd’hui, les légumes se taillent une place grandissante sur les tables. Et les grillades sont dans la note. En ce qui concerne le sucré, les Polonais ne sont pas en reste : makowiec est une génoise roulée au pavot ; sernik est un cheese cake ; les paczki sont des beignets à la confiture associés au jeudi gras (qui précède de quelques jours le mercredi des cendres) ; etc. Et à Torun, on fait de fameux pains d’épice.
Street food : No surrender. Les Polonais ne rendent pas les armes aux burgers, empanadas, kebabs ou bao qui ont essaimé chez eux comme ailleurs. Quoi qu’ils aient adopté la restauration rapide internationale, ils continuent de manger des zapiekanki. De quoi s’agit-il ? D’une rescapée des années socialistes : demi-baguette avec champignons et fromage gratiné, agrémentée d’un lacet de ketchup. Bien entendu désormais, cette formule se décline de cent manières. Le standing s’est élevé, mais le gratiné est resté. Bulka z pieczarkami, pain fourré d’un mélange champignons oignons, est d’esprit assez similaire. À Cracovie, on achète pour moins d’un euro, dans des édicules de couleur bleue, des obwarzanki, petits pains en forme de couronne torsadée, sur lesquels sont jetées des graines de pavot ou de sésame. C’est un en-cas tout à fait commode et savoureux.
Boissons
Partout où vous allez, on vous propose du thé, herbata. Ou de la vodka, wodka. Laquelle est un alcool de grain, parfumé ou pas, dont il est séant de boire le premier verre cul-sec. Ensuite, vous faites comme vous pouvez. C’est une institution ambigüe, qui participe de l’héroïsme et de la mélancolie. Il y aurait, entre la vodka polonaise et la russe, une différence un peu similaire à celle qu’il y a entre la whiskey irlandais et le whisky écossais. Quoi qu’il en soit, si la vodka fait partie des mœurs, elle n’est plus l’exutoire qu’elle a été. Une curiosité : le spirytus, alcool éthylique quasiment pur, qui titre plus de 90°. Déraisonnable. Les craft beers sont en Pologne comme ailleurs. Elles forment un contrepoint moderne. La viticulture polonaise est encore anecdotique, mais elle existe. Et le changement climatique pourrait lui donner sa chance. La limonade Hellena ou les sodas Tymbark sont les fleurons de l’industrie nationale de la boisson gazeuse. Kompot est un breuvage traditionnel, que l’on obtient en faisant bouillir des fruits dans de l’eau sucrée. Et puis, l’eau minérale n’est pas prohibée.