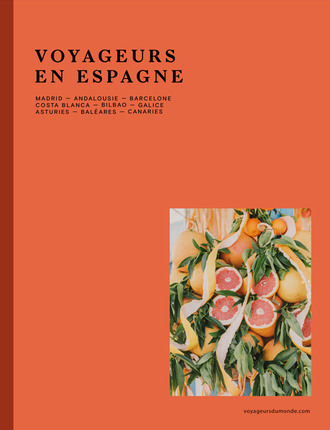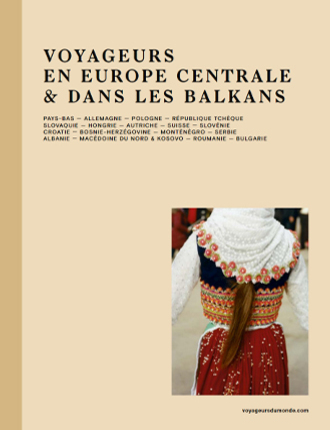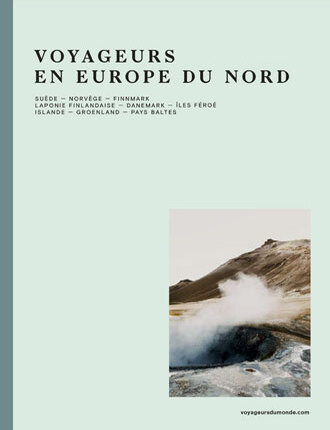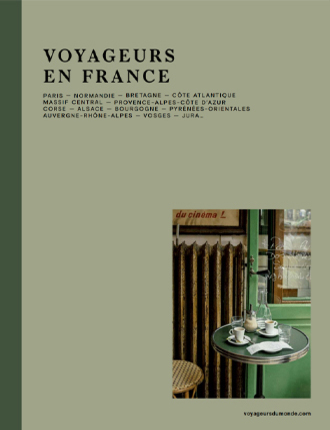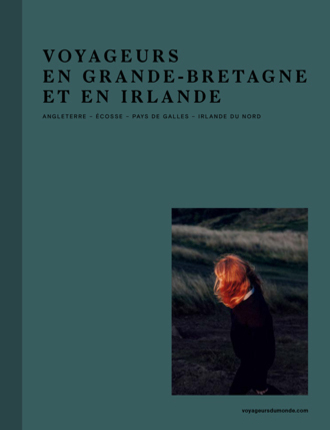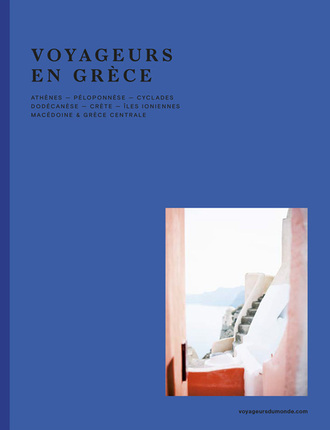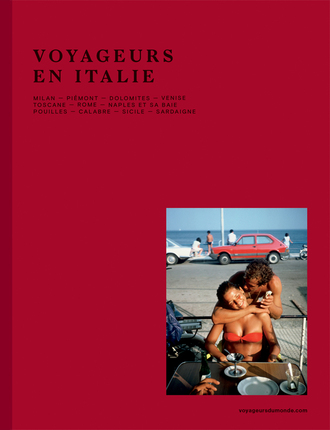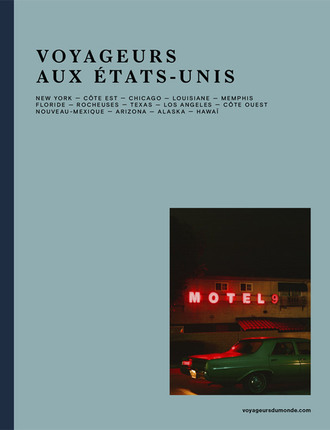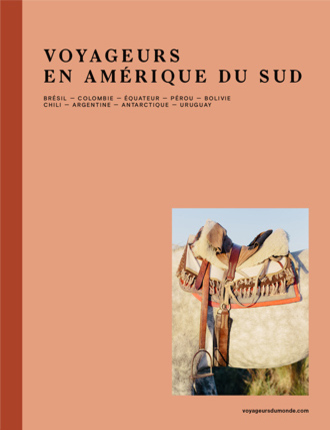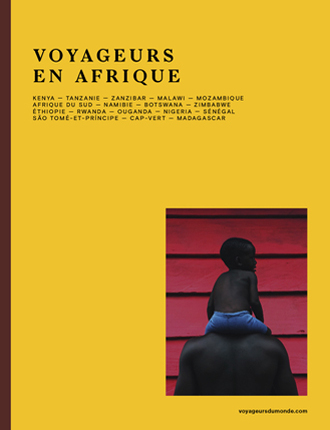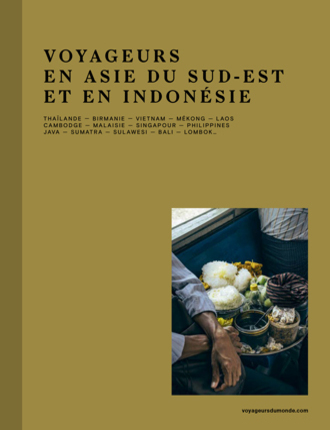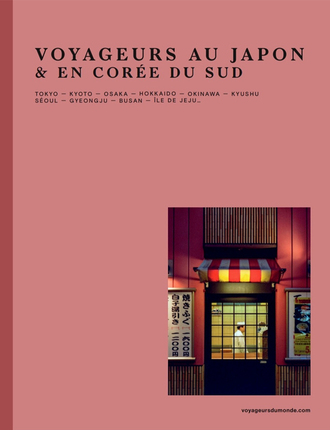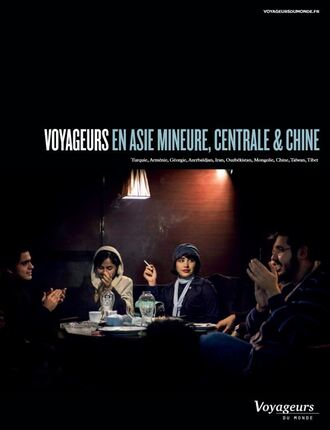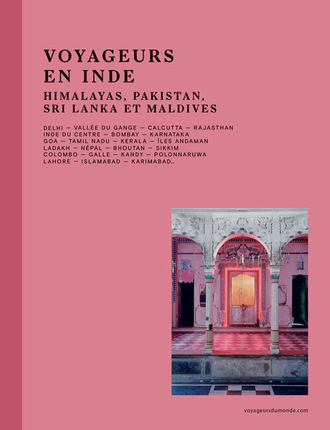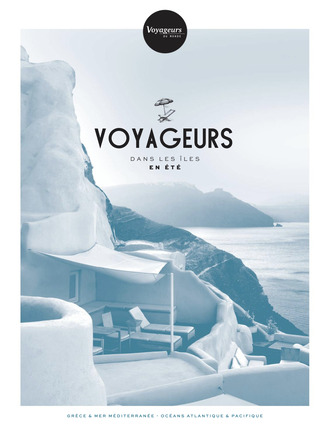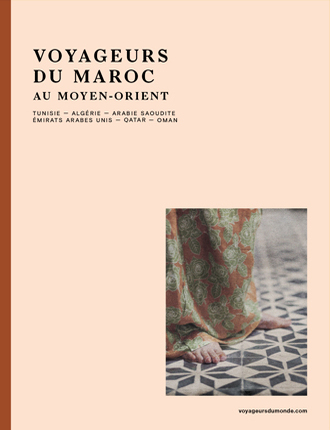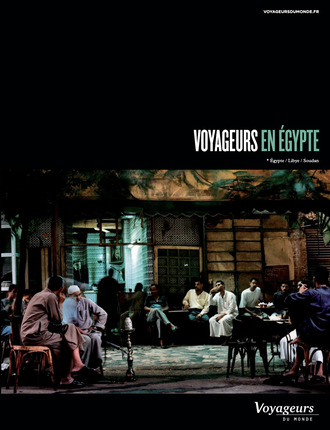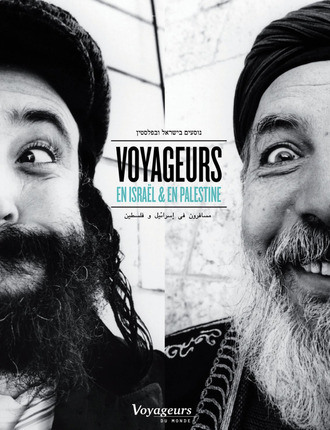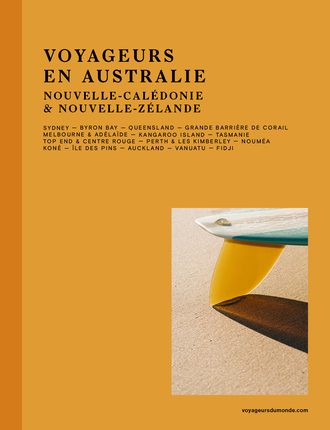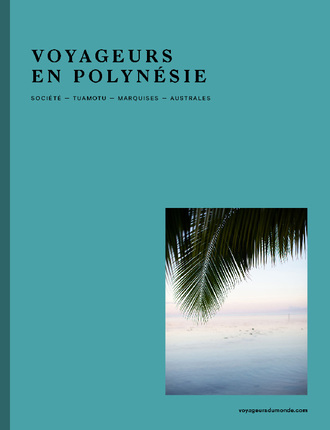Population
204 575, en 2024.
Langues officielles
Le samoan et l’anglais, de facto.
Langues parlées
87% des Samoans ont le samoan pour langue maternelle. Un peu plus de 10%, l’anglais, principalement des métis euronésiens. Les dernières générations sont en général bilingues, samoan et anglais. Dans la vie administrative, judiciaire et politique, l’une et l’autre langue sont utilisées. Au parlement, par exemple, on s’interpelle en samoan, mais on rédige la loi en anglais.
Peuples
Les Samoans sont donc nettement majoritaires. Les Euronésiens sont des métis d’Européens (ou assimilés) et de Samoans (ou autre peuple du Pacifique). De petites communautés japonaise, chinoise, maorie, vivent dans le pays. La diaspora samoane serait plus nombreuse que les habitants sur place.
Religions
Article 1 de la Constitution : les Samoa sont un nation chrétienne fondée de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Néanmoins, la tolérance religieuse est un fait. 97% des Samoans sont chrétiens, surtout protestants : Église congrégationaliste, 32% ; Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, 15% ; méthodistes, 14% ; etc. Les catholiques sont 19%. Hindouistes, bouddhistes, musulmans, baha’i n’ont pas de poids démographique. La religion traditionnelle est tout à fait résiduelle.
Fête nationale
1er juin : anniversaire de l’Indépendance, 1962.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
En mars ou avril : Pâques, du Vendredi saint au lundi.
25 avril : journée de l’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps).
2e dimanche de mai : fête des mères.
1er juin : fête nationale.
4 août : fête du travail.
Lundi suivant le 2e dimanche d’août : fête des pères.
2e lundi d’octobre : fête de l’enfance.
7 novembre : Arbor Day.
25 décembre : Noël.
26 décembre : Boxing Day.
Politique
L’État indépendant des Samoa est une monarchie constitutionnelle parlementaire, régie par la constitution de 1960 – inspirée par le système constitutionnel britannique. Le chef de l’État est élu pour cinq ans (mandat renouvelable une fois) par le parlement. Il est choisi parmi les tama ‘aiga, les familles dominant la noblesse samoane. Sa fonction est surtout honorifique ; il nomme le premier ministre sur présentation du parlement. Les pouvoirs législatif et de contrôle du gouvernement sont détenus par le Fono, l’Assemblée législative des Samoa. Il est constitué d’au moins cinquante et un parlementaires issus des matai, chefs de famille traditionnels, élus pour cinq ans. 10% des sièges étant par principe réservés à des femmes. Le mécanisme des meilleurs perdants permet d’augmenter le nombre des députés. Le gouvernement, responsable devant le parlement, ne peut compter plus de huit ministres. Le système judiciaire est dérivé de la Common Law britannique.
Histoire
Le peuplement des Samoa s’est vraisemblablement fait, il y a quelque trois mille ans, par des groupes d’origine fidjienne, via les Tonga. Intégrant ainsi l’archipel à l’aire de civilisation austronésienne Lapita. Ce sont probablement des pannes réseau affectant cet ensemble qui ont provoqué particularisation, notamment aux Tonga et aux Samoa, et développement culturel nouveau. Ainsi serait né le domaine polynésien, des Samoans et des Tongiens ayant amorcé le peuplement des îles orientales. Au Xe siècle de notre ère, les Tonga montent en puissance et étendent leur empire, Tu’i Tonga, sur (entre autres) les Samoa. La sujétion dure trois siècles. Tu’i Tonga décline alors et les Samoans recouvrent leur indépendance.
Longue période, au cours de laquelle l’histoire des Samoa ne défraie pas la chronique. En 1722, le navigateur hollandais Jakob Roggeveen, voguant sur la frégate Arend à la recherche de la Terra australis pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, note leur existence et poursuit. En 1768, Bougainville, lors de son tour du monde à bord de la Boudeuse, navigue dans les eaux de l’archipel qu’il nomme îles des Navigateurs, ébloui par les performances des pirogues samoanes. Engagé lui aussi dans un tour du monde, La Pérouse débarque à Tutuila (US Samoa) fin 1787. Les Samoans se font homicides en cette rencontre. La Boussole et l’Astrolabe appareillent précipitamment vers les Tonga, îles des Amis. Ce sont finalement les missionnaires des London Missionary Society et English Wesleyan Mission qui prennent pied pour de bon aux Samoa. Lesquelles ont ainsi intégré une forme de mondialisation.
À cette époque, la société samoane est dominée par quatre tama ‘aiga, grands chefs, dont alliances et conflits régulent les tensions de tous ordres. Les Européens s’installent en nombre croissant au cours du XIXe siècle. Pour le commerce et le coprah. Afin de s’approprier des terres, ils jouent les chefs les uns contre les autres. Ils leur fournissent des armes modernes. La Grande-Bretagne, l’Allemagne et les États-Unis regardent la situation d’un œil intéressé. Albert Steinberger, représentant les intérêts allemands, se fait nommer premier ministre par le chef Malietoa Laupepa. Provoquant l’ire des Britanniques et des Américains. Et une période d’instabilité. C’est un cyclone qui dénoue en 1889 la crise des Samoa en envoyant par le fond les navires américains et allemands qui se jaugeaient dans le port d’Apia. La même année, un traité de Berlin établit un condominium : les trois puissances garantissent l’indépendance des Samoa et surtout le respect des droits contractés sur place par les uns et les autres. Consuls et bases navales à la clé. Lesquels consuls intriguent à qui-mieux-mieux pour les intérêts de leurs nations. La situation se dégradant derechef, on en vient à se partager le pays : les États-Unis emportent la partie orientale – Tutuila, Aunu’u, Ofu-Olosega, Ta’u et Swains ; l’Allemagne, l’occidentale, contre Niue, Nauru et les Tonga cédées à Sa Gracieuse Majesté britannique.
En 1899 débute donc un épisode polynésien de l’histoire coloniale allemande. Il prend appui sur la tradition samoane – fa’a Samoa – pour la gestion des affaires des insulaires et sur une administration à l’européenne pour celles touchant aux colons et aux questions internationales. Les choses achoppent sur le foncier ; c’est par là que se heurtent les deux systèmes, le second interférant abusivement avec le premier. Le mouvement Mau naît à Savai’i de ces contestations ; il suscite d’abord une désobéissance fiscale locale. Les meneurs sont saisis et relégués aux Mariannes du Nord. Un nationaliste de l’autre bout du monde, Gavrilo Princip, met fin à la tutelle allemande sur les Samoa : la 1ère Guerre mondiale permettant à la Nouvelle-Zélande d’y supplanter le Reich (état de fait avalisé par la SDN au terme du conflit). Et de profiter du boom sur les fruits et le coprah. L’administration miliaire mise en place rabaisse les Samoans ; sévèrement touchés par ailleurs par la grippe espagnole. Les maladresses, à tout le moins, néo-zélandaises, provoquent la renaissance du Mau a Pule, le Mau Movement, rejoint cette fois par des métis influents et même quelques Européens. Les militants se rallient au mot d’ordre Samoa mo Samoa – les Samoa aux Samoans – et réclament le rattachement aux Samoa US. Camouflet pour la puissance mandataire, qui réagit sans ménagement. Le 28 décembre 1929, les onze morts du Black Saturday vont marquer la mémoire samoane. Terme malheureux d’une tentative d’apaisement manquée. Les opérations militaires reprennent. En 1936, néanmoins, l’arrivée d’un gouvernement travailliste à Wellington permet de débloquer la situation. Le Mau est reconnu. Les combats de la 2nde Guerre mondiale ne touchent pas les Samoa. En revanche, une présence importante de G.I.s dans l’archipel devait provoquer des changements, tant dans l’infrastructure que dans les mœurs.
Après-guerre, les Samoans attirent l’attention de la nouvelle Organisation des Nations Unies sur leur cas. Une commission fait le déplacement. À la suite duquel la Nouvelle-Zélande produit le Samoan Amendment Act, 1947. Les Samoans sont associés de façon formelle à l’administration du territoire, lequel reste néanmoins sous la tutelle de Wellington, des blancs et des métis d’Apia. Pour autant, le nouveau statut permet prise de conscience et promotion des Samoans de souche, qui précisent leur vision. Tant et si bien que, dix ans plus tard, il faut remettre tout cela sur le métier. Les organes d’un futur État sont esquissés. L’indépendance est dans tous les esprits. Pour les élections, les chefs coutumiers imposent un mode de scrutin double qui garantit leurs prérogatives : dans la partie samoane du corps électoral seuls les matai sont éligibles et électeurs. Second Samoan Amendment Act. Et constitution en bonne et due forme en 1960. Puis, référendum – au suffrage universel – sur celle-ci et sur l’indépendance le 9 mai 1961 : oui et oui. En conséquence de quoi, le 1er janvier 1962, l’indépendance des Samoa est proclamée. Première nation insulaire du Pacifique à y accéder au sens contemporain du terme. En 1970, le pays devient membre du Commonwealth of Nations.
Personnalités
Savea, XIIIe siècle. La figure du fondateur de la dynastie Malietoa est nimbée de légende et bordée de documents : son ascendance remonte à la fondation du monde ; sa descendance se prolonge jusqu’en 2007. C’est ainsi que se présentent les personnages tutélaires, ils assurent la transition entre le mythe et l’histoire. Avec ses frères, Savea aurait mis fin à la domination des Tonga sur les Samoa.
Malietoa Vainu’upo, mort en 1841. Après avoir conquis de haute lutte le statut de chef suprême – tafa ‘ifa – des Samoa, Malietoa Vainu’upo fit preuve de subtilité politique : il adopta le christianisme britannique et dispersa les titres justifiant son statut royal. Ainsi fit-il entrer les Samoa dans la modernité par un étonnant court-circuit. Cujus regio, ejus religio d’une part, mort du roi d’autre part. Le pays avait changé de pied.
Lauaki Namulau’ulu Mamoe, mort en 1915. Ce matai de Savai’i, premier leader du Mau a Pule, ferment du mouvement national samoan, fut d’abord un défenseur des prérogatives des chefs traditionnels que les empiètements de l’administration coloniale allemande remettaient en question. Un conservatisme qui, dans les conditions d’alors, allait se révéler paradoxalement révolutionnaire.
Fa’angase Su’a-Filo, XXe siècle. Elle est sans aucun doute la première étoile samoane de cinéma, illuminant le Moana de Robert J. Flaherty, en 1926. Cette histoire des mers du sud, documentaire fiction, ne reproduisit pas le succès de Nanouk l’Esquimau. Et, si elle n’atteint pas encore à la grandeur du Tabu de Murnau, 1931, elle est un témoignage élégant sur la Polynésie d’autrefois.
Dwayne Johnson. Né en 1972 de mère samoane et de père canadien, The Rock est l’héritier d’une lignée de lutteurs polynésiens. Avant de devenir un acteur dont les cachets sont proportionnels aux dimensions physiques – big – il fut un catcheur multi-titré. Du Retour de la momie à Fast and Furious et au-delà, son œuvre cinématographique ne recule pas devant une bonne louche d’autodérision.
Margaret Mead, 1901-1978. En réfléchissant et en écrivant – Coming of Age in Samoa, 1928 – sur la sexualité des Samoans, cette élève de Franz Boas à la Columbia University a secoué celle des Occidentaux. Le livre fut en effet un succès de librairie étonnamment large et durable. Et un sujet de controverse passionnée. Comme toujours en de tels cas, un certain emballement marquait l’affaire.
Robert Louis Stevenson, 1850-1894. L’auteur écossais de L’île au trésor et de L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde est enterré au sommet du mont Vaea près d’Apia. Après son installation aux Samoa, il acquit le respect des habitants, qui lui donnèrent le nom de Tusitala, le Conteur. L’archipel représentait sans doute cet ailleurs concret que l’écrivain opposait au naturalisme honni.
Brian Lima, né en 1972. Avec la lutte, le rugby est l’autre sport samoan. Le jeu agile, fantasque, pétulant des joueurs de l’archipel a conquis les stades à travers le monde. Parmi les joueurs ayant évolué en équipe nationale, l’ailier Brian Lima aurait été ce qu’on a fait de mieux. Le standing des clubs l’ayant accueilli (au nombre desquels le Stade français) semblerait confirmer cette opinion.
Albert Wendt, né en 1939. Ce sont les romans Sons for the Return Home, 1973, et Leaves of the Banyan Tree, 1979, qui ont assis la réputation d’écrivain d’Albert Wendt, né à Apia. Il fut aussi professeur d’université et éditeur. En somme, un intellectuel (dont le travail apporte une contribution importante à la culture polynésienne et mélanésienne). La Nouvelle-Zélande l’a distingué de façon éminente : Order of New Zealand.
Vaimasenu’u Zita Sefo-Martel, née en 1961. Première femme capitaine de fautasi – longue pirogue traditionnelle samoane – en compétition, elle finit par remporter des courses avec un équipage entièrement féminin. Comme quoi, le féminisme peut être un peu galère. Elle tire aussi brillamment à l’arc et, dans ce domaine encore, monte sur le podium. Une personne qui a l’œil.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Respecter le fa’a Samoa, la manière samoane, c’est agir selon un code de civilité connu de tous. Bien entendu, on n’exigera pas de vous que vous le sachiez par le menu, mais quelques règles sont saillantes qu’il serait malséant de ne pas appliquer.
À la plage, no topless. Hors de la plage, lavalava (sarong), pantalons, shorts, teeshirt, chemise, jupe, robe : bref, tenue décente. Dans le même esprit, pas de comportement extravagant le dimanche ou à l’heure quotidienne de la prière, annoncée à son de cloche ou de conque vers 18h / 19h : la religion se respecte. Et aussi la nécessité du repos.
La terre est appropriée, aussi demande-t-on la permission de s’y installer, même pour un bref moment. Il est possible qu’en certains endroits un petit droit d’usage soit réclamé.
Pas de photo d’une personne sans autorisation expresse.
Avant d’entrer sous un fale (abri sous chaume), on se déchausse. Si les personnes déjà présentes sont assises, on fait de même, sans jamais diriger ses orteils vers quiconque.
Cuisine
Le poisson (dorade coryphène, thon albacore, bonite, barracuda, vivaneau / red snapper, thazard noir / wahoo, etc.) et les fruits de mer, le taro et le fruit de l’arbre à pain sont, avec le lait de coco, les ingrédients de base de la cuisine samoane. Le plat national serait sans doute palusami, les feuilles de taro à la crème de coco, cuites dans le umu, le four souterrain. Celui-ci est creusé dans le sol et garni de pierres chaudes sur lesquelles les aliments (enveloppés dans des feuilles de bananier) cuisent à l’étouffée. Bonne saveur fumée à la clé. Oka, le poisson cru mariné au lait de coco, est un classique. Sapasui en est un autre : nouilles sautées aux légumes et poulet ou porc. On peut attaquer la journée avec un bol de supo esi, la soupe de papaye, additionnée de flocons de noix de coco. Ou koko alaisa, riz au lait de coco et chocolat. Le fin du fin de la cuisine samoane étant sans doute palolo, parties reproductrices en forme de vermicelle du ver de récif Palola viridis. Octobre et novembre étant les deux mois favorables à ce nanan. Les fruits sont délicieux : bananes, mangues, papayes, ananas, caramboles, etc.
Street food : un bol de frites du fruit à pain ne peut faire que du bien. Le biscuit keke saiga, ou biscuit chinois, s’emporte partout, une fois qu’on en a acheté un sac au supermarché. Les panikeke, boules de pâte frites, sont simples, nourrissantes et bonnes lorsqu’elles sortent du bain. Le baozi chinois est certainement à l’origine de keke pua’a, petit pain farci cuit à la vapeur. Néanmoins, si la situation requiert un shot énergétique, le chausson à l’ananas chaud paifala est tout indiqué.
Boissons
Pour éviter tout dérangement, on boit de l’eau minérale capsulée. Ou du soda. La marque samoane étant Taxi. Les Allemands ont importé la brasserie : Vailima est la mousse n°1. L’eau de coco est une évidence. Ainsi que toutes les formules de jus de fruit. Au jus de curcuma, les plus éminentes vertus sont reconnues. L’histoire du cacao aux Samoa n’est pas éclaircie, mais le chocolat fait partie des mœurs et passe pour une spécialité du pays. Kava n’est pas le café, encore qu’il y en ait, c’est un breuvage cérémoniel tiré de la racine de poivrier. Enfin, la Scientific Research Organisation of Samoa a créé un whisky de taro tout à fait original.