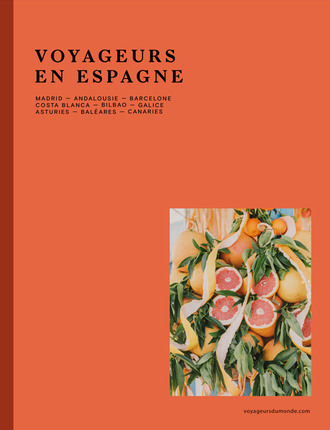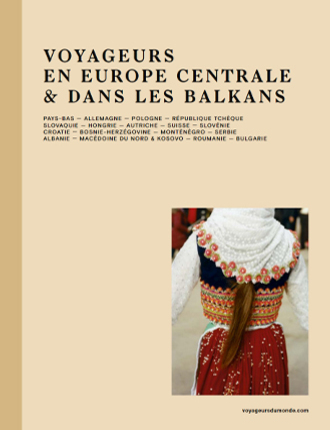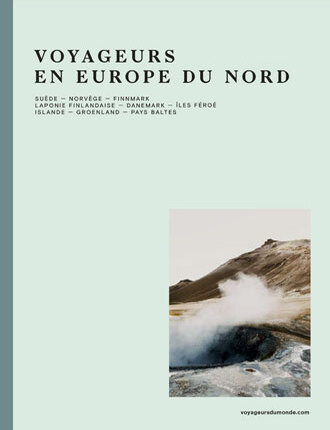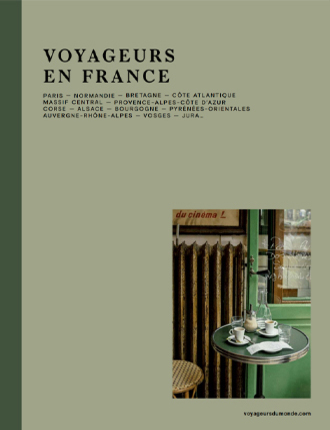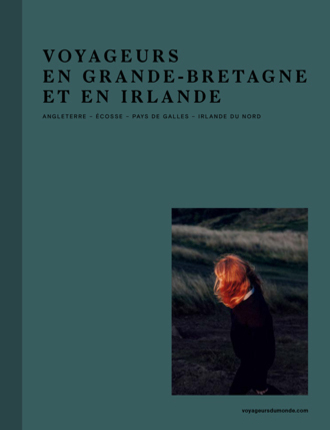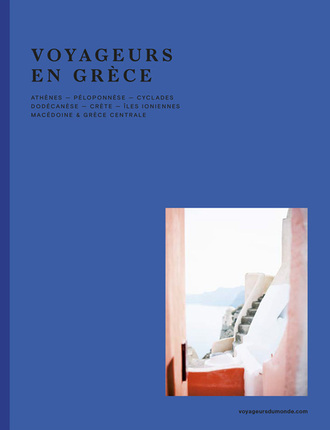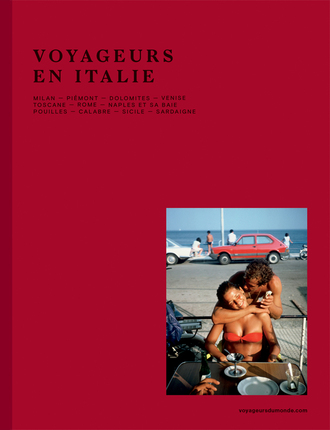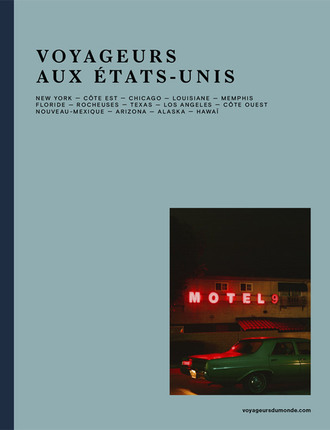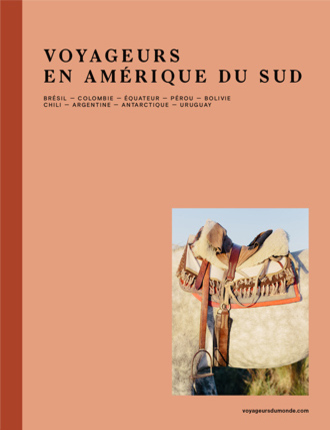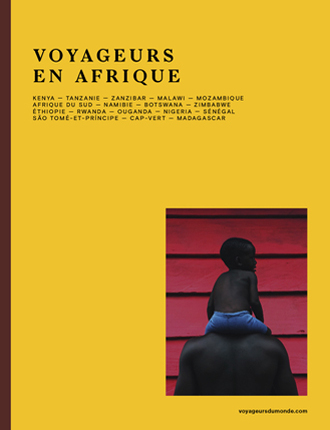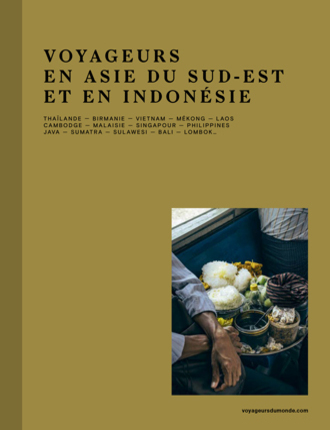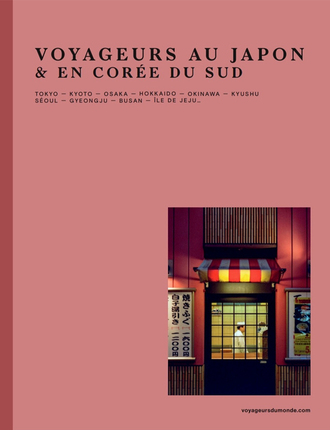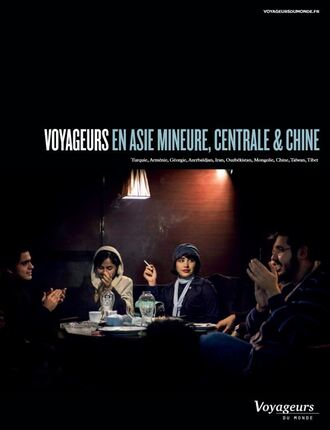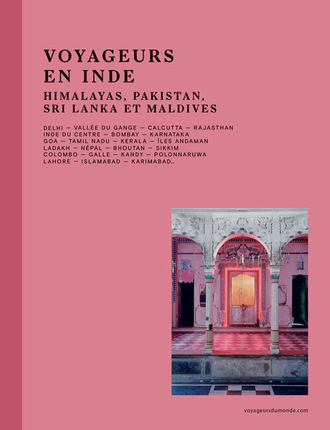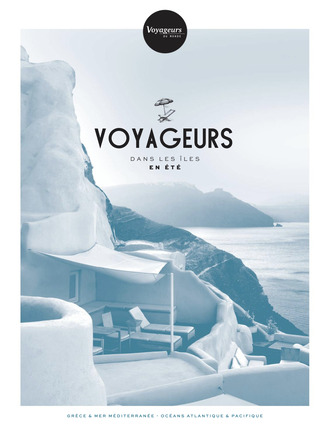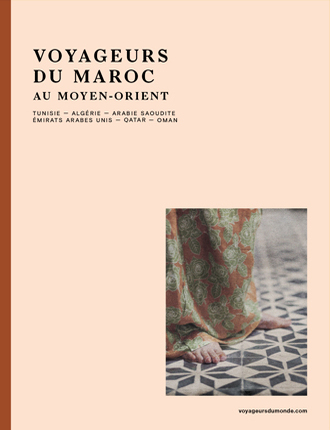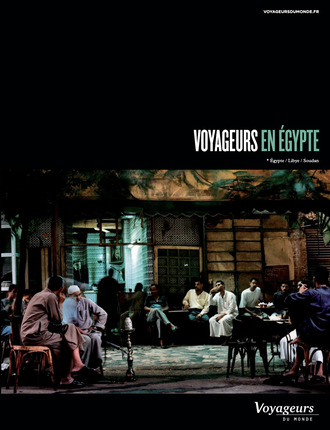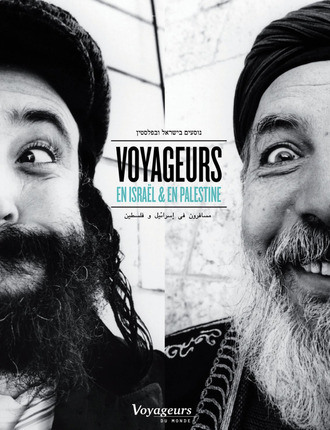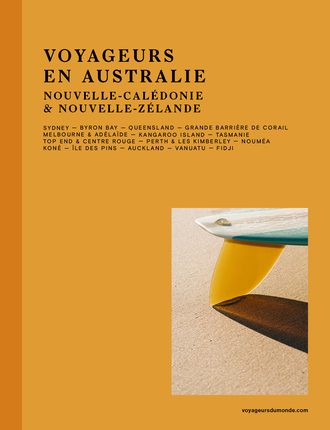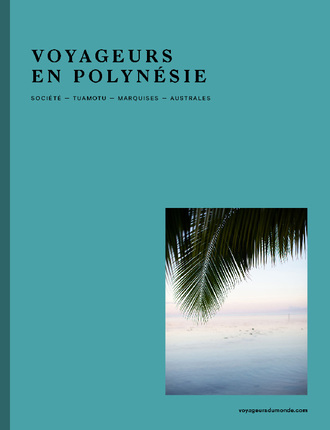Capitale
Tunis.
Climat
Le climat de la Tunisie est essentiellement méditerranéen, tournant désertique dans le sud saharien. Ce qui signifie, sans tenir compte de possibles variations locales, été sec et chaud (jusqu’à 35°C) et hiver doux (jusqu’à 15°C et même 18°C à Djerba) et humide. Il pleut assez régulièrement d’octobre à avril. Le long des côtes, l’air marin tempère mais charge l’atmosphère d’humidité. À l’intérieur, les contrastes sont plus marqués. Comme dans le sud, l’été peut être torride. Le vent du désert, le sirocco, suscite régulièrement des épisodes de douceur hivernale ou de forte chaleur estivale. L’altitude exerce aussi une influence sur le temps qu’il fait. Le pays bénéficie d’un ensoleillement important.
Les températures moyennes à Tunis sont 12,3°C en janvier ; 28°C en juillet ; 17,2°C en novembre. Pour Djerba, ce sont respectivement 13,2°C ; 28,4°C ; 18,8°C. À Tozeur, on a 11,9°C ; 33,1°C ; 17,5°C.
Géographie
SUPERFICIE : 163 610 km².
POINT CULMINANT : le djebel Chambi, dans les monts de Tébessa (dorsale tunisienne), 1544 mètres.
PAYS LIMITROPHES : Algérie ; Libye.
Le relief – globalement orienté SO-NE – est marqué par l’Atlas tellien, qui court le long du littoral nord, et par la dorsale tunisienne, un peu plus au sud ; l’Atlas saharien se prolongeant à l’état de traces éparses jusque vers Hammamet. Entre l’Atlas tellien et la dorsale, la vallée fertile de la Medjerda (seul cours d’eau permanent du pays). L’est et le sud sont moins relevés. Hautes et basses steppes précèdent, à l’ouest et à l’est, la zone saharienne, qui représente environ 40% du territoire. Elle se compose de plateaux de faible altitude et de montagnes brèves, puis se prolonge dans le Grand Erg oriental. Avec les oueds, les lacs et lagunes, les sebkhas – dépressions salines inondables – sont un trait caractéristique de l’hydrologie tunisienne dans ses parties basses. Dans le centre du pays, le Chott el-Jérid, important pourvoyeur de sel, est la plus vaste sebkha du Maghreb.
Faune et flore
La flore tunisienne a un profil nettement méditerranéen. Néanmoins, les voyageurs ne manquent pas de remarquer les figuiers de Barbarie et les agaves. Qui sont d’origine américaine. Laurier-rose et palmier sont anciens. Le thuya de Barbarie est endémique. Les essences les plus régulières sont pins, chênes, cyprès, peupliers, tamaris, pistachiers, prunus. L’olivier se rencontre partout, c’est l’une des productions phares de la Tunisie (avec les dattes). La vigne est d’ancienne tradition. Tout comme le blé, que les Romains exploitèrent. Les orchidées fournissent une cinquantaine d’espèces. Quant à Jasminum sambac, le jasmin d’Arabie, c’est à la fois un élément du plaisir de vivre et un symbole.
Les mammifères sont encore nombreux, malgré des disparitions irrécupérables, comme le lion de l’Atlas ou le courlis à bec grêle. Le rat à trompe a une p’tite gueule bien sympathique. Les gerbilles et les goundis sont en nombre. Le chacal doré, le renard de Rüppell, le fennec ou la genette restent fréquents. Comme le sanglier. L’hyène rayée l’est moins. Le cerf de Barbarie, le mouflon à manchettes, les gazelles des sables et dorcas dépendent d’habitats à préserver. Parmi les oiseaux, le pic de Levaillant et le rougequeue de Moussier sont typiquement maghrébins. La marmaronette marbrée est menacée. Des oiseaux marins, comme le goéland d’Audouin, le puffin cendré ou l’océanite tempête se reproduisent en Tunisie. Les libellules sont encore communes, avec des effectifs variables. On peut citer les agrions nain, mercure ou délicat ; et l’anax empereur, l’orthétrum bleuissant, le sympètre rouge sang, le trithémis pourpré. Se maintiennent de façon précaire : la cistude et la tortue mauresque, la gazelle de Cuvier, le caracal.
En circulant à travers le pays, on croise sur les routes, ou sur les bas-côtés, moutons, chèvres et de petites vaches. Les premiers peuvent être l’arbi, à tête sombre et queue grasse, le petit noir thibar ou même le Jacob, pie et sérieusement encorné. Dans les villages, les chiens sont très présents. En ville, ce sont les chats. De nombreux amateurs élèvent pour son chant le beldi, le canari tunisien. Au sud, le dromadaire est une institution vivante ; même si maints travaux lui sont désormais épargnés, il appartient à la culture saharienne. Des cinq types tunisiens, le Gueoudi est le plus costaud et l’Ourdaoui Medenine le plus frêle.
Situation environnementale
Les questions économiques ont le pas sur les environnementales. Ou plutôt celles-ci ne sont pas intégrées à celles-là. L’État ne s’est pas doté de moyens légaux, administratifs, humains, suffisants pour intervenir de façon décisive dans ce domaine. Pollutions diverses, épuisement des ressources naturelles sont le lot des Tunisiens. Les premières sont symbolisées par la diffusion anarchique des déchets plastiques à travers tout le pays qui, secteur touristique ou pas, s’en trouve un peu défiguré. Le ramassage et le traitement des déchets est un problème non résolu. La vie quotidienne des Tunisiens en est affectée. Quant aux ressources naturelles, la disponibilité, la gestion et la qualité de l’eau sont des enjeux majeurs. Le changement climatique contribuant à intensifier le stress hydrique. Il faudrait donner les moyens à une agriculture qui consomme 70% des ressources de faire évoluer ses pratiques. Pour ne pas parler du secteur industriel. Ou du tourisme. Les associations attendent de l’État qu’il pose un cadre d’action crédible. Et qu’il remobilise à ce propos une population confrontée à des difficultés multiformes et largement désabusée.
Évoquons quelques-uns des dix-sept parcs nationaux tunisiens. Le parc national de Bouhedma se trouve au centre du pays, dans l’Atlas saharien oriental. Il est classé en réserve de biosphère par l’Unesco. On y a rétabli des espèces appartenant à la faune naturelle de la Tunisie, comme l’addax, l’oryx algazelle, la gazelle dama, l’autruche. Le potentiel touristique vert de ce domaine est important ; les points d’intérêt étant la flore et la faune, mais aussi les formations naturelles de la montagne et les vestiges d’aménagements antiques. Le parc de Boukornine englobe le djebel éponyme. Il est contigu à Hammam Lif, dans la banlieue sud de Tunis. Il abrite une faune caractéristique (sangliers, mouflons à manchettes, lièvres, caméléons, etc.) et quelques raretés, ainsi la tulipe sauvage ou le cyclamen de Perse. C’est le parc des Tunisois. L’écosystème saharien est la vocation du parc de Dghoumès, gouvernorat de Tozeur. Tamaris, genêt blanc, acacia faux-gommier, hérisson du désert, chat des sables, perdrix gambra sont donc au répertoire. Des programmes de réintroduction sont, ici aussi, en cours : gazelle dorcas, gazelle de Cuvier, oryx algazelle. Dans le gouvernorat de Bizerte, le parc d’Ichkeul est une autre réserve de biosphère. Au titre notamment de son importante avifaune de zone humide : lac Ichkeul et marais. On observe encore ici la marmaronette marbrée et la talève sultane, mais aussi bien le héron cendré, des flamants, l’oie cendrée ou le guêpier d’Europe.
Économie et tourisme
IDH en 2021 : 0,731 / France, 0,903.
PIB par habitant en 2023 : 3 977,70 dollars US / France, 44 690,90.
La Tunisie dispose de ressources naturelles non négligeables : un peu de pétrole, beaucoup de phosphates, du fer, du plomb, du zinc. Et du sel. De bonnes terres arables également, avec plusieurs zones bioclimatiques qui autorisent une agriculture variée. Les plaines à blé du nord (1,6 millions d’hectares) contribuent à l’économie depuis l’Antiquité. Les oliviers aussi (même surface que le blé). La vigne, dans une mesure un peu moindre. Les dattes et les oranges jouissent d’une renommée flatteuse. L’agroalimentaire est donc un secteur traditionnel solide. L’industrie exploite les ressources minières et les hydrocarbures disponibles. L’électromécanique est l’une de ses réussites. Le potentiel en termes d’énergies renouvelables est nettement sous-exploité. L’État demeure un acteur clé de l’économie tunisienne, même si un processus de libéralisation a été amorcé dans les années 1980 et poursuivi bon an mal an. Un accord de libre-échange a été conclu avec l’Union Européenne. Les transferts réalisés par les Tunisiens émigrés représentent autour de 5% du PIB et constituent un apport bienvenu de devises. La croissance marque le pas ces dernières années pour des raisons sociales (chômage élevé, spécialement parmi les jeunes), budgétaires et financières.
Le tourisme est un secteur majeur de l’économie tunisienne, qui dispose d’atouts importants, comme le littoral, une part de désert ou des sites archéologiques et artistiques de valeur. Néanmoins, le passage d’un modèle quantitatif à une approche plus qualitative (que relaient de nombreuses initiatives désormais) ne se réalise pas comme cela. Le tourisme de masse va sur son erre encore longtemps après qu’on a décidé de couper les gaz. C’est vrai de la Tunisie-même ; ça l’est aussi de la façon dont elle est perçue à l’étranger. Une question d’image, que l’on ne change pas en un claquement de doigts. Des efforts sont donc à consentir pour que le pays réponde clairement aux attentes renouvelées des voyageurs. En contrepartie, il faut aussi que ceux-ci consentent à leur part d’implication dans le processus de montée en gamme.